Le Code Le genre littéraire - le genre (convention) : l’écart et la conformité,
Le Code Le genre littéraire - le genre (convention) : l’écart et la conformité, trop romanesque/ trop grammatical ? - la gamme du genre. Dans Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? Jean-Marie Shaeffer définit le genre comme une convention discursive. Il y a : 1) des conventions constituantes : elles instaurent, instituent l’activité qu’elles règlent comme par exemple l’acte communicationnel. > le statut énonciatif du texte : s’agit-il d’un énonciateur fictif ou non ? > les modalités de représentation : mimesis ou diegesis. > l’acte illocutoire : expressif (lyrique), persuasif (sermon, essai), assertif (roman). > l’acte perlocutoire : la visée explicite, comme faire rire ou la catharsis. Critère de justesse/fausseté : des procédés linguistiques trop explicites/implicites : trop grammatical, la persuasion se transforme en oppression, l’expressif devient du dévoilement impudique et l’assertif devient suspect. Trop agrammatical, on ne cerne pas la visée du texte. 2) des conventions régulatrices : elles ajoutent des règles à une forme de communication pré- existante, elle donne une particularité qui se surimpose à l’acte communicationnel. > contraintes métriques, phonologiques, stylistiques, de contenu (unité d’action). 3) des conventions traditionnelles : elles portent sur le contenu sémantique du discours. > définition par critère thématique. > références relativement prescriptives, libres à des textes antérieurs. => grammatical/ agrammatical : problème que le pôle grammatical en soi est la gamme de référence, et par conséquent il faudrait s’en détacher. => conventionnel/ non conventionnel: idée d'usure et de défigement. En général, plusieurs conventions discursives jouent à différents niveaux. Et puis, la catégorie du genre est très perméable : s’il y a transgression, le texte est absorbé par une autre catégorie, ou elle est forgée. Puis, la violation d’une règle n’implique pas l’échec (par exemple, le sonnet inversé de Verlaine). Le classement des transgressions est relatif et fluctuant. Mais selon Jauss, le genre sert à modeler un horizon d’attente. Il fournit des éléments de reconnaissance, un fond sur lequel se détache la nouveauté, car sinon répétitif : si trop juste, ça perd l’intérêt. Il doit être dans le faux tolérable : dans la tension. Être trop juste, ce n’est pas ici un atout. Mais s’agit-il de justesse ? Ou autre chose ? On peut être juste en musique et que ce soit plat. I.3. Transgression des conventions discursives selon Schaeffer Selon Schaeffer, le respect des conventions discursives est plus ou moins contraignant en fonction de leur type. Si on ne respecte pas une convention constituante, on échoue à réaliser le genre qu'on visait. Par exemple si le contrat de vérité qui lie l'auteur au narrateur dans l'autobiographie est transgressé (l'autobiographe brode délibérément en faisant de celui qui dit Je un personnage de fiction aux aventures purement inventées), on sort du genre autobiographique à proprement parler. On a d'ailleurs inventé le terme d'autofiction pour baptiser ce type d'écart de l'autobiographie. Mais les effets sont différents si on ne respecte pas une convention régulatrice comme le sonnet. On peut imaginer de modifier la structure du sonnet en commençant par les tercets et en finissant par les quatrains. C'est ce que fait Verlaine dans son poème Résignation qui ouvre les Poèmes saturniens et qui est un sonnet inverti, dans tous les sens du termes (Verlaine y écrit Et je hais toujours la femme jolie, / La rime assonante et l'ami prudent.). Il y a alors violation des règles mais non pas véritablement échec à réaliser le genre. Enfin les conventions traditionnelles sont très peu contraignantes. Si l'on s'écarte d'un modèle archétypique par exemple, celui des Fables d'Esope ou de La Fontaine, pour écrire des fables dépourvues de moralités, on modifiera le genre mais on n'en exercera pas une violation comme dans le cas précédent. Une question serait de savoir si le Don Quichotte de Cervantès qui parodie ouvertement les romans de chevalerie est encore un roman de chevalerie. I.4. Relativité de ce classement des transgressions A vrai dire, les genres contemporains devenant beaucoup plus fluctuants, on peut se demander si la transgression des règles constituantes conduit nécessairement à l'échec. Comme je l'ai signalé, la frontière entre textes dramatiques et narratifs est assez floue chez Beckett, sans qu'on interprète pour autant cela pour un échec à réaliser l'un ou l'autre genre. De même, le poète Jacques Roubaud a pu proposer, dans son recueil , des ∈ sonnets en prose et des sonnets de sonnets, dont l'identification est d'ailleurs problématique. Je ne suis pas sûr qu'on interprète cela comme une violation des règles du genre. Il me semble plus vraisemblable d'admettre qu'on y voit une redéfinition radicale, quelque chose donc qui ressemble à la modification du genre qu'on trouve dans la transgression des conventions traditionnelles. http://www.fabula.org/atelier.php?Des_possibles_rapports_entre_la_po%26eacute%3Btique_et_l %27histoire_litt%26eacute%3Braire Conclura-t-on alors que l'histoire littéraire doit se dissoudre dans le champ de l'histoire sociale ou de l'histoire des mentalités ? Nullement, si l'on observe avec G. Genette qu'elle peut être une histoire non des fonctions mais des formes littéraires : " Des œuvres littéraires considérées dans leur texte, et non dans leur genèse ou dans leur diffusion, on ne peut, diachroniquement, rien dire, si ce n'est qu'elles se succèdent. la " période " ou le " genre " sont des objets de statut épistémologique comparables. L'œuvre elle-même ne répond pas à cette double exigence, et c'est pourquoi sans doute elle doit en tant que telle rester l'objet de la critique. Et la critique, fondamentalement (…), ne peut pas être historique, parce qu'elle consiste toujours en un rapport direct d'interprétation, je dirais plus volontiers d'imposition du sens, entre le critique et l'œuvre, et que ce rapport est essentiellement anachronique, au sens fort (et, pour l'historien, rédhibitoire) de ce terme. Il me semble donc qu'en littérature, l'objet historique, c'est-à-dire à la fois durable et variable, ce n'est pas l'œuvre : ce sont ces éléments transcendants aux œuvres et constitutifs du jeu littéraire que l'on appellera pour aller vite les formes : par exemple, les codes rhétoriques, les techniques narratives, les structures poétiques, etc. Il existe une histoire des formes littéraires, comme de toutes les formes esthétiques, du seul fait qu'à travers les âges ces formes durent se modifient. Le malheur, ici encore, c'est que cette histoire, pour l'essentiel, reste à écrire, et il me semble que sa fondation serait une des tâches les plus urgentes aujourd'hui. " (" Poétique et histoire ", texte corrigé d'une communication à la décade de Cerisy-la-Salle sur " l'enseignement de la littérature ", juillet 1969 ; dans : Figures III, Le Seuil, coll. " Poétique ", 1972, p. 17-18) Il lui faut donc bien admettre la nécessité, de plein exercice, d'une discipline assumant ces formes d'études non liées à la singularité de telle ou telle œuvre, et qui ne peut être qu'une théorie générale des formes littéraires — disons une poétique. " (" Critique et poétique ", dans : Figures III, éd. cit., p. 10-11) http://www.fabula.org/atelier.php?Genres_et_pragmatique_de_la_lecture D'une manière générale, la lecture procède par « reconnaissance », elle se fonde sur la mise en oeuvre de savoirs et de savoir-faire déjà constitués lors d'expériences précédentes. En d'autres termes, la lecture requiert un certain nombre de compétences. La référence à une situation qui exige une coordination de la part des participants est révélatrice: il y a entre eux un accord, même s'il n'y a pas de communication linguistique explicite. Cet accord résulte de l'intériorisation d'expériences antérieures semblables qui les préparent à des situations imprévues où une pareille coordination sera requise. En l'adaptant à la théorie des genres, la définition d'une convention par LEWIS peut se réécrire comme suit : A est une convention d'un genre x si : * chaque émetteur/producteur d'un texte appartenant au genre x se conforme à A ; * chaque récepteur/lecteur d'un texte appartenant au genre x s'attend à ce que chaque émetteur/producteur se conforme à A ; * chaque récepteur/lecteur préférerait que tout émetteur se conforme à A ; * A n'est pas nécessaire à partir du moment où l'émetteur/producteur et le récepteur/lecteur sont d'accord sur un autre principe respectant les conditions ci-dessus. C'est précisément le rôle des genres littéraires d'établir des conventions qui fondent des expectatives mutuelles, garantissent une certaine stabilité dans les échanges langagiers et assurent ainsi un contrôle plus strict du décodage du texte en réduisant son incertitude (S. Mailloux, 1982 : 127-139). On retrouve cette idée dans l'expression de « contrat » ou de « pacte » de lecture utilisée par Philippe LEJEUNE. Pour lui, le genre est « (...) une sorte de code implicite à travers lequel, et grâce auquel, les oeuvres du passé et les oeuvres nouvelles peuvent être reçues et classées par les lecteurs. C'est par rapport à des modèles, à des 'horizons d'attente', à toute une géographie variable, que les textes littéraires sont produits puis reçus, qu'ils satisfassent cette attente ou qu'ils la transgressent et la forcent à se renouveler. » 1975 : 311. Certaines « instructions », que l'on peut appeler « instructions génériques », établissent ce pacte en mettant par abduction le texte en relation avec un schème contextuel générique [i]. Celui-ci est un opérateur de cadrage qui permet la reconnaissance/identification du texte et qui uploads/Litterature/ code 3 .pdf
Documents similaires







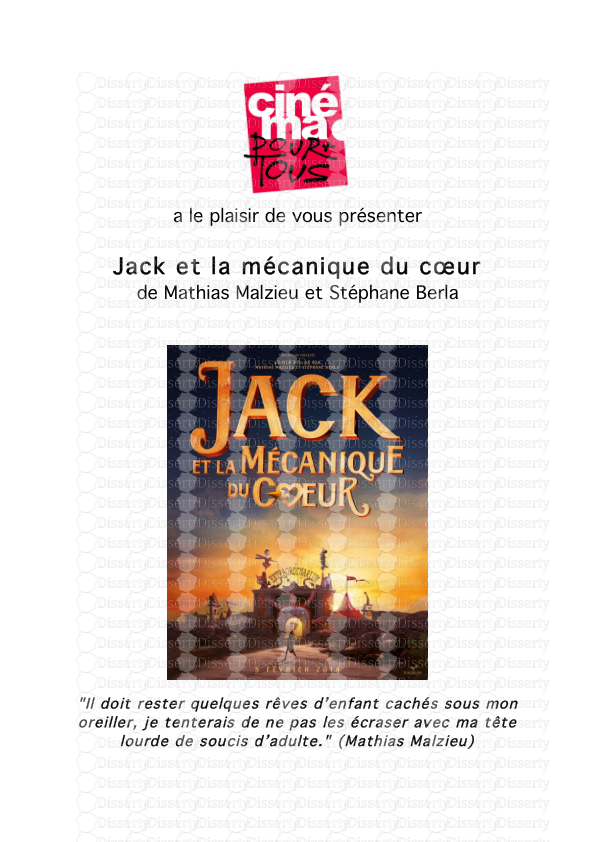


-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 27, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1431MB


