Langages Relations de cohérence et anaphores en contexte inter- phrastique : un
Langages Relations de cohérence et anaphores en contexte inter- phrastique : une symbiose parfaite Francis Cornish Abstract Francis Cornish : Cohérence relations and anaphora in an inter-sentential context : a perfect symbiosis The various types of semantic and pragma-semantic relations obtaining between either two or three successive or separated text sentences within a discourse are not without effect on the interpretation and the discourse functioning of anaphors occurring in the second and third members of such groups of sentences. The article attempts to pinpoint the exact influence of these relations on the character of the anaphoric relation(s) which may also connect them. The interpretation (or " resolution") of the anaphoric relation(s) at issue will flow from this integrative effort ; and in turn, the resolution of the anaphors in the non-initial sentences in the group will make it possible to satisfy one of the conditions for application of the cohérence relation selected itself. Citer ce document / Cite this document : Cornish Francis. Relations de cohérence et anaphores en contexte inter-phrastique : une symbiose parfaite. In: Langages, 40e année, n°163. 2006. Unité(s) du texte. pp. 37-55; doi : 10.3406/lgge.2006.2682 http://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_2006_num_40_163_2682 Document généré le 01/06/2016 Francis Cornish CNRS ERSS. UMR 5610 et Université de Toulouse-Le Mirail Relations de cohérence et anaphores en contexte inter-phrastique: une symbiose parfaite 1 1. INTRODUCTION Comme le titre de l'article l'indique, je vais traiter ici de l'înfluenœ des rela- tions de cohérence <Olllse-COIJséquellce, Contmste, ExplicntiOll, t./n/lom!ioll, Asse,.· fioll/FflÎt/Hypotllèsl!-llldice, etc.) sur le fonctionnement et l'interprétation des anaphores dans les textes; mais il s'agira tout autêmt de l'influence, en retour, de la résolution des anaphores SUT le choix et la mise en œuvre de telle ou telle relation de cohérenœ pour intégrer les propositions inférées à partir des suites de phrases en question. Comllle on va le voir, ces deux procédés discursifs sont en parfaite symbiose l'un avec "autre. On se propose donc de œrner l'influence exacte d'un sous-ensemble de rela- tions de cohérence sur la nature de la relation anaphorique qui pent également les relier. On se concentrera surtout sur le niveau et le type de cohérence qui, en contexte, permet l'intégration du \.-olltenu de deux phrases contiguës ou non, ou bien de deux propositions au sein d'une seule phrase complexe - qu'il existe ou non un connecteur indiquant le type de relation à invoquer pour les relier. L'interprétation (ou la « résolution ») de la ou des expression(s) anaphorique{s) cOllcernée(s) découlera donc naturellement de cel effort d'intégration <cf. Hobbs, 1979). Cepend<lllt, Hohbs ne traite pas la relation complémentaire: la contribution de la résolution des <lnaphoriques à la sélection et à la mise en œuvre de telle relation de cohérence pour intégrer les deux w)itês. 1. C~ texte est une version ~maniœ d'une COlllmunicalion préseflto!e lors dl' 1;, Joum~ scienli- fique *' Unité(s) du Texte .., organisée p;,r le Jaboratoi~ CRISCO dl' Uni\'ersi~de Caen, le 6 décembre 2002 (voir Comish, 2003 pour le texte de œlle oommuniationl. JI.' n.>nlCf'CÎe Michel Ch<\mllcs, Tcd Sander!> el Joselle Rebeyrolle d'avoir relu une version pnmmin.."li~ de cet arhi:le. La responsabilité pour les opinions exprinxiocs, ainsi que pour loute erreur qui subsister..il, n'incombe qu'~ moi. lan il es 37 Unilé(s) du lexlt> Je COlUmencerai par l'analyse de quelques exemples, d'abord construits, puis att~tés, permettant de cerner le fonctionnement des anaphores en liaison avec les relations de cohérence (§ 2); puis j'aborderai plus spécifiquemt.?nt certaines approches t1'K..~riquesde ce dernier phénomène (notamment celles du néerlandais Ted Sanders et ses collègues, puis celle de J.R. Hobbs>' en 1L>s affi· nanl (§ 3). Je tenninerni en analysant d'autres courts textes attestés (surtout des articles de presse de faits divers) en fonction de ces th&>ries (§ 4). 2. ANAPHORES ET COHÉRENCE : ANALYSE DE QUELQUES EXEMPLES CONSTRUITS ET ATTESTÉS Oe façon générale, on peul dire que l'existence d'expressions inde>.:icales dans une proposition, qu'elles ai"'~lt une valeur déictique ou anaphorique, sert à signaler le caractère pragmatiquement subordonné de cette proposition par rapport à une proposition contexhlelle - que cette proposition ait été explicite-- ment réalisée linguistiquement, ou qu'elle soit sous-entendue (cf. aussi Schauer &- Hahn, 200] : 230, 231). La. prédic<ltion anaphorique fonctionne dans tous les cas de figure pour étendre et maintenir la saillance de la situation évoquée t'ia cette proposition plus centrale (cf. Klei~r, 1994: ch. 3, Cornish, 1999: ch. 4). Il s'agira surtout dans cet article de prooicalions anaphoriques qui constituent des phrases indépendantes. D'ailleurs, ce SQlIt en premier lieu les éléments prédica- tifs des deux segments, conjointem~lltà la présence éventuelle de connecteul's, qui servent à fonder la nature de 1il relation de cohérence en fonction de laquelle le contenu des segments sera intégré (cf. à ce sujet surtout Asher & Lascarides, 1996). Voici quelques ~xemples(ici, constnlits) : (l) a Un chien, accourut ct s'assit Ilfuyamme/lt ':;lIr le CtlIUfpé. H, éMit (illigllé. b Un rhien nccouru! rI s·Qs.~it bruyammmt ,;ur Il' cnnap!j.llj élait cas..<;é. c IContL'Xte; un salon, où A et B sont en train de discuter l'llsemble. Soudain, un chien accourt dans la pièce el s'asseoil bruyamment sur le canapé à côté d'eux. A à B, ... 'l1 plaisantant:1 JI est /rlfiglU:! Ici, llOUS pouvons remarquer en (lA)! qu'en principe l'<ldjectif {(lNgué peut s'appliquer soit à un être animé, soit - avec un sellS " s... "COndaire", métapho- rique - à un artefact (Ull meuble, plus précisément). Si cet adjectif prend sa valeur de base" avoir sommeil », s'appliquant donc à un quelconque être animé, alors la prédication - ou plus eXact~llle)lt,la fonction propositionnelle - " X étilit filtigué " dans la seconde phrilse de (la) peut être comprise comme fournissant tlne explication (Hobbs, 1990) de l'état de choses décrit doms la première - qUÎ porte en premier lieu sur .. le chien qui a... -coumt et qui s'assit bruyamment sur le canapé ", plutôt que sur ... le canapé sur lequel le chien 2. Segment COI1\~de deux phrases qui pctJ\'t"nt se cOillpr..."Ildre COIllIl'll' f,us,'mt partie d'\lIl ,\.Iocit quclCOl"'lue. 38 Relations de cohérence et anaphores en contexte inter-phrastique s'assit bruyamment ,.3. Et la structure interprétative rendant possible l'intégrn- tion de ces deux propositions en un tout cohérent serait alors celle de Fait-Expli- cotiOIl, la reprise (par une sorte d'.. inertie référentielle ..) de l'entité sur laquelle porte en priorité la première phrase découlant naturellement de cette extension (i.e. « C'était parce qu'il était fi'lligué que le chien en question s'assit bruyalllment sur le canapé »). Le constituant spécifiimt la Raison Explicative - le second membre de ce couple de phrases - serait de ce fait pragmatiquemcnt dépen- dant, suoordonné, par rapport au premier. À noter également que la relation de discours pemlettant de relier les deux phrases ne peut pas êlTe ceUe de Narm- tioll (cf. Asher, 1993, Asher &: Lascarides, 1996), car le temps imparfaü de la deuxième, ainsi que le caractère" statif .. du prédicat fatigué, empêchent l'intro- duction d'un nouvel événement. Là où le pronom il est compris comme repre- nant J'entité inanimée .. le canapé ", ce type de relation entre les deux propositions ne serait pas de mise 4• Intuitivement, la relation de cohérence reliant le contenu des demc phrases avec ce type d'interprétation serait celle d'tlaoornlion, qui est d'une « force" cohésive plus lâche que celle de Cm/sc ou d'Explicatioll. Le compreneur aura toujours tendance à choisir la relation de cohérence la plus forte susceptible de relier deux propositions, là où plusieurs relations candidates sont disponibles - mais à condition que la nature de ce qui est prédiqué du référent ciblé le justifie~. Dans le cas du segment illustré par (lb), en revanche, le prédicateur de la seconde phrase oriente l'attention du lecteur d'une façon plus nette vers le réfé- rent .. le Glnapé sur lequel le chien vient de s'asseoir bruyamment ., car le sens de J'adjectif cassé restreint la classe des entités auxquelles il pourra s'appliquer à celles qui dénotent un objet partiellement rigide, ce qui exclut immédiatement le chien (bien vivant) évoqué vin la phrase initiale. Comme ici le référent est plus nettement ciblé par ce qui en est prédiqué pi'lr la prédication indexicale (<< le fait d'être cassé »), c'est la relation f..\1J1iœfion, et non celle plus fi'liblement cohésive d'llnbomtioll, qui sem choisie pour relier les deux représentations. Dans (le), l'emploi .. exophorique» du pronom sujet il de la prédication anaphorique dans son contexte prédicatif immédiat fonctionne exactement de la même manière que dans (la), en étend;mt la représentation de la situation qui aura été éVOI..luée ici Ilia la perception directe de la scène par A et B devant 3. En termes de lopicalîté, il n'y a pas encore de 'topique' ici, puisque nous avons affaire il un énoncé Ihf/iqll" Il l'initiale d'un ,liscours (ou bien d'Ull segment de discours) où l'information apporléeest présentée comme 'Ioute nouvellc· pour l'allocutaire. 4. S. ..uf si, bic:'l1 clltendu, la • fatigue _ du canapé est comprise conlme élimt unc 'c<lus(" du bruil crœ par le ch)ell ell s'asseyant dl!SSus! Mais dans œ cas, l'adjectif ftl/iSui devra assumer un sens dérivé, métaphorique, ce qui augmc:'llteraill'effort cognilif devanll!tre COllsenti uploads/Litterature/ cornish-anaphore-et-coherence 1 .pdf
Documents similaires


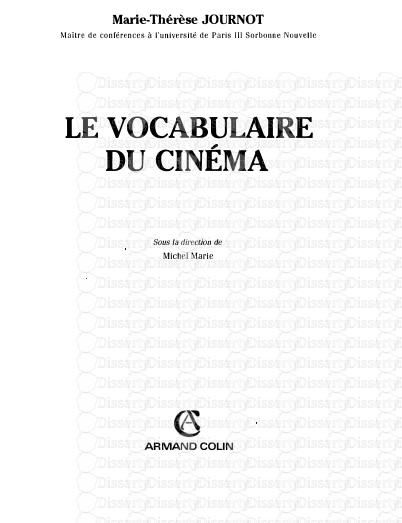







-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 16, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 7.3600MB


