LE TRAITÉ DU TATHÄGATAGARBHA DE BU STON RIN CHEN GRUB P U B L I C A T I O N S D
LE TRAITÉ DU TATHÄGATAGARBHA DE BU STON RIN CHEN GRUB P U B L I C A T I O N S DE L’ÉCOLE FRANÇAISE D’EX TRÊ ME-ORIENT VOLUME LXXXVIII LE TRAITÉ DU TATHÀGATAGARBHA DE BU STON RIN CHEN GRUB TRADUCTION De bzin gsegs pa’i sñih po gsal zih mdzes par byed pa'i rgyan PAR David Seyfort RUEGG ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT PARIS 1973 DAnnsifaire. * AHri#»n-M ai<snnnonvn 11 run P A R T Q f(\e\ s- orte— c w /m i 3 © École française d'Extrême-Orient, Paris, 1973 AVANT-PROPOS Le traité de Bu.ston.Rin.chen.grub traduit et commenté dans le présent travail consiste en grande partie en un recueil de textes canoniques relatifs au lalhâgalagarbha et tirés surtout des Sütra du Mahâyâna. Le mDzes rgyan constitue ainsi un complément précieux au traitement scolastique de la théorie qu’on trouve dans les Sâstra, et que nous avons étudié dans notre Théorie du lalhâgalagarbha el du golra: Éludes sur la solériologie el la gnoséologie du bouddhisme (Publications de l’École française d’Extrême-Orient, volume LXX, Paris, 1969). Composé au milieu du xive siècle par un docteur tibétain qui fut aussi l’un des principaux éditeurs des deux collections de textes canoniques bouddhiques en traduction tibétaine que sont le bKa’.’gyur et le bsTan.’gyur, le mDzes rgyan met donc à notre disposition un recueil de textes faisant autorité pour la théorie scripturaire du lalhâgalagarbha ; bien entendu, il ne s’agit que d’un choix de textes, car les passages canoniques traitant du lalhâgalagarbha sont très nombreux et auraient rempli un ouvrage beaucoup plus étendu que le mDzes rgyan, mais l’anthologie constituée par Bu.ston n’en fournit pas moins une collection fort utile de textes scripturaires sur ce thème. Pour ce qui est de la présente traduction, ce sont les versions des textes canoniques telles qu’on les trouve reproduites dans le mDzes rgyan qui ont été traduites ici ; car il s’agit en premier lieu de connaître, dans la mesure du possible, une version tibétaine de ces textes cano niques, perdus pour la plupart dans leurs versions indiennes originelles, qui était courante au Tibet plusieurs siècles avant la publication des éditions actuelles bu bKa’. ’gyur et du bsTan. ’gyur, et de comprendre l’interprétation qu’en a donné Bu.ston. (Il faut pourtant noter que l’édition du mDzes rgyan utilisée pour le présent travail, et qui est la seule accessible, date du xxe siècle.) Ainsi, dans les notes on a signalé des cas où la version tibétaine d’un texte cité dans le mDzes rgyan présente des différences d’importance doctrinale par rapport à la version correspondante des éditions actuelles du bKa’.’gyur ou du bsTan.’gyur (les circonsconstances nous ont obligé d’utiliser surtout l’édition de lHa.sa du bKa’.’gyur et l’édition de Pékin du bsTan.’gyur, sauf dans quelques passages présentant une importance VIII AVANT-PROPOS théorique toute particulière, pour lesquels d’autres éditions du canon tibétain ont pu être consultées). La comparaison des versions conte nues dans le mDzes rgyan avec celles du bKa’. ’gyur et du bsTan. ’gyur permet par ailleurs des constatations intéressantes concernant la formation de ces deux collections. En outre, lorsqu’il est accessible l’original sanskrit des passages cités par Bu.ston est reproduit en note. D’autre part, dans l’Introduction on a discuté quelques passages où les différences entre les versions connues revêtent une importance fondamentale pour l’interprétation de toute la théorie du lalhâgalagarbha. Lorsqu’un terme technique désignant une notion d’intérêt philo sophique et religieux figure dans le mDzes rgyan, l’équivalent sanskrit usuel du vocable tibétain est indiqué quand il est établi avec assez de certitude ; dans certains cas cependant, et surtout s’il existe plusieurs équivalents reconnus qui sont plus ou moins synonymes, l’équivalent peut être approximatif et est alors indiqué sous toute réserve vu qu’un terme synonyme aurait à la rigueur pu figurer à sa place. Pourtant, quand il s’agit de synonymes, il semble que l’équi valent employé doive en tout cas valoir quant au sens. Les termes sanskrits ont été ainsi employés dans la traduction de préférence aux termes tibétains parce que, en règle générale, le sanskrit doit sans doute être considéré comme la lingua franco des études mahâyânistes. Notre choix, commandé qu’il est par des considérations d’ordre pratique, ne doit naturellement pas être entendu comme mettant en question la spécificité des formes extra-indiennes du bouddhisme. On verra que les interprétations proposées par Bu.ston soulèvent parfois des problèmes délicats d’ordre philologique et philosophique, et que leur auteur n’a peut-être pas toujours réussi à fournir une exégèse satisfaisante des passages les plus obscurs et les plus difficiles. C’est probablement le cas pour la question assez complexe de la relation entre le lalhâgalagarbha, le lalhâgaladhàlu et le prakflisthagolra et de leur statut par rapport aux niveaux causal (gzi) et résultant (’bras bu). Mais pour l’historien du bouddhisme l’intérêt de l’ouvrage de Bu.ston n’en est pas nécessairement diminué ; car son importance réside précisément dans le fait qu’il peut ainsi témoigner de l’état des doctrines au Tibet au xive siècle, à une époque où les Tibétains, qui venaient d’avoir mis à leur disposition, sous la forme du bKa’.’gyur et du bsTan.’gyur, un corpus des textes canoniques du bouddhisme, étaient en mesure de tenter des interprétations systé matiques et compréhensives de la vaste littérature bouddhique. Et ces essais ont alors préparé la voie pour les grandes sommes élaborées dans les écoles des rNin. ma. pa, des bKa’. brgyud. pa, des Sa. skya. pa, des Jo.nan.pa et des dGe.iugs.pa. L’œuvre de Bu.ston marque l’un des grands points de départ de ce remarquable et puissant mouvement philosophique et religieux, qui est un des sommets dans l’histoire du bouddhisme aussi bien que de la pensée de l’humanité. En même AVANT-PROPOS IX temps, par le choix de textes classiques qu’il a fait, Bu.ston a rendu d’accès plus facile l’enseignement des Sûtra. Je tiens à exprimer ici ma gratitude à tous, maîtres et amis kalyânamilra, qui m’ont aidé dans la préparation de ce livre consistant pour l’essentiel en un travail fait il y a une dizaine d’années dans l’Himâlaya. D. S. R. LISTE DES ABRÉVIATIONS AA A AM S BBh BuCh Dft DzG GhV KD LAS M AV MBhS MMK M M S M PNS1 M PNS1 M S MSA RGV : Abhisamayâlamkarâlokâ de Haribhadra (S, éditions de U. Wogihara et de P. L. Vaidya). : Angulimâlïyasülra (H). : Bodhisallvabhümi attribuée à Asanga (S, éditions de U. Wogihara et N. Dutt). : bDe bar gsegs pa’i bslan pa’i gsal byed chos kyi 'byun gnas gsun rab rin po che'i mdzod, de Bu.ston.Rin.chen.grub (édition de lHa.sa). : Deb lher snon po, de ’Gos.lo.tsa.ba.g2on.nu.dpal (1392-1481). : De bzin güegs pa'i snin po gsal iin mdzes par byed pa'i rgyan (dit aussi bDe gSegs snin po gsal ba’i rgyan ou bDe snin mdzes rgyan), de Bu.ston.Rin.chen.grub (édition de lHa.sa). : Ghanavyüha (P). : gSun.’bum de Klon.rdol.bla.ma.Nag.dban.blo.bzan (1719-1794) (édition de lHa.sa). : Lankâvatârasülra (S, édition de B. Nanjô). : Madhyântavibhâga attribué à Maitreyanâtha (S, édition de G. N. Nagao, avec le Bhâsya de Vasubandhu ; cf. S. Yamaguchi, éd. de la Tïkâ de Sthiramati). : Mahâbherïsûlra (H). : Mülamadhyamakakârikà de Nâgârjuna (S, édition de L. de La Vallée Poussin). : Mahâmeghasûtra (H). : Mahâparinirvânasülra, version tibétaine traduite du sanskrit (H). : Mahâparinirvânasülra, version tibétaine traduite du chinois (H). : Mahâyânasarngraha d’Asanga (Ti, édition de É. Lamotte). : Mahàyânasülrâlamkâra attribué à Maitreyanâtha (S, édition de S. Lévi, avec le Bhâsya attribué tantôt à Asanga et tantôt à Vasubandhu). : Balnagolravibhâga-Mahâyânollaralanlrasâslra (S édité par E. H. Johnston). XII LISTE DES ABHEVIATIONS R G W RGV Dar : tllc RGV Tik : blo SMDSS : TGS : Th G : YG : Ralnagolravibhâga-Vyâkhyâ (commentaire du RGV, attri bué à Asanga). Theg pa chen po rgyud bla ma'i lïkka, de rGyal.tshab. Dar.ma.rin.chen (1364-1432) (édition de IHa.sa). Theg pa chen po rgyud bla ma’i bslan beos ’grel pa dan bcas pa’i dka’ ’grel gnad kyi zla ’od, de Pan.chen. bSod. nams.grags.pa (1478-1554). Srïmâlâdeuîsirnhanâdasülra (H). Talhâgalagarbhasülra (H). Grub milia’ sel gyi me Ion, de Thu’u. bkvan .Blo. bzaii. chos.kyi.ni.ma (1737-1802) (éd. de IHa.sa). De bzin gsegs pa’i sniii po gsal zin mdzes par byed pa'i rgyan gyi rgyan mkhas pa’i yid 'phrog (Yan rgyan), de sGra.tshad.pa.Rin.chen.rnam.rgyal (1318-1388) (édi tion de IHa.sa). C Ch 1 ) H K N P S T Ti : Édition de Co.ne. : Chinois. : Édition de sDe.dge. : Édition de IHa.sa. : bKa’.’gyur. : Édition de sNar.than. : Édition de Pékin. : Sanskrit. : bsTan.’gyur. : Tibétain. INTRODUCTION L e rnDzes rgyan Le rnDzes rgyan de Bu.ston.Rin.chen.grub (1290-1364) est un recueil de textes canoniques traitant d’un enseignement caractéris tique d’un groupe d’écritures mahâyânistes qui, selon une classifica tion traditionnelle remontant aux Sütra eux-mêmes, font partie du troisième et dernier Cycle de la prédication du Buddha : la doctrine de l’Embryon Essentiel — ou de l’Essence — de talhâgata (tathâgata- garbha = de biin gsegs pa’i sfiin po) existant chez tous les êtres animés sans exception1 . Deux siècles avant Bu.ston les docteurs tibétains avaient déjà commencé à composer des commentaires du âàstra fondamental sur cette doctrine : le Ratnagotravibhâga-Mahâyânottaralanlra (Utlara- tanlra) attribué à Maitreya et son commentaire, la « Vyâkhyâ » uploads/Litterature/ david-seyfort-ruegg-le-traite-du-tathagatagarbha-de-bu-ston-rin-chen-grub.pdf
Documents similaires







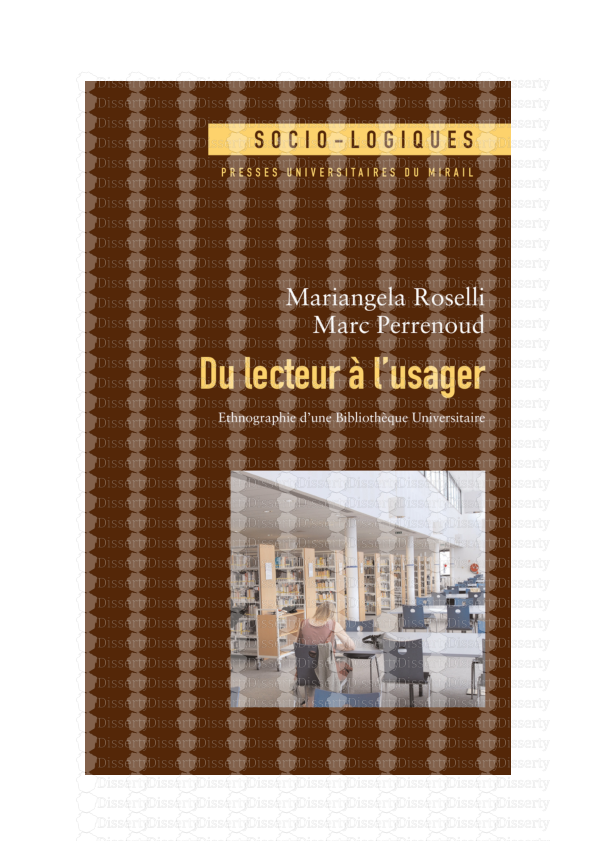


-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 20, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 27.8718MB


