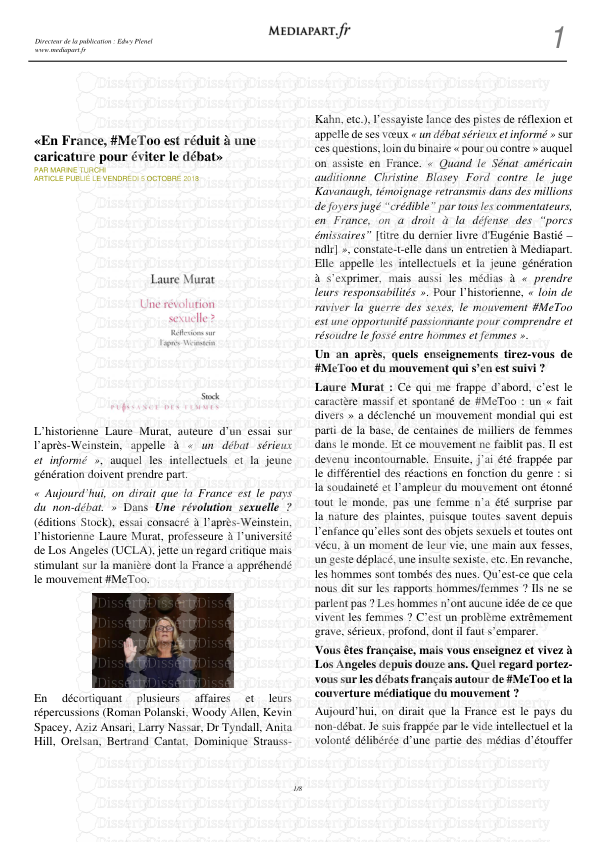Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 1 1/8 «En France, #M
Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 1 1/8 «En France, #MeToo est réduit à une caricature pour éviter le débat» PAR MARINE TURCHI ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 L’historienne Laure Murat, auteure d’un essai sur l’après-Weinstein, appelle à « un débat sérieux et informé », auquel les intellectuels et la jeune génération doivent prendre part. « Aujourd’hui, on dirait que la France est le pays du non-débat. » Dans Une révolution sexuelle ? (éditions Stock), essai consacré à l’après-Weinstein, l’historienne Laure Murat, professeure à l’université de Los Angeles (UCLA), jette un regard critique mais stimulant sur la manière dont la France a appréhendé le mouvement #MeToo. En décortiquant plusieurs affaires et leurs répercussions (Roman Polanski, Woody Allen, Kevin Spacey, Aziz Ansari, Larry Nassar, Dr Tyndall, Anita Hill, Orelsan, Bertrand Cantat, Dominique Strauss- Kahn, etc.), l’essayiste lance des pistes de réflexion et appelle de ses vœux « un débat sérieux et informé » sur ces questions, loin du binaire « pour ou contre » auquel on assiste en France. « Quand le Sénat américain auditionne Christine Blasey Ford contre le juge Kavanaugh, témoignage retransmis dans des millions de foyers jugé “crédible” par tous les commentateurs, en France, on a droit à la défense des “porcs émissaires” [titre du dernier livre d'Eugénie Bastié – ndlr] », constate-t-elle dans un entretien à Mediapart. Elle appelle les intellectuels et la jeune génération à s’exprimer, mais aussi les médias à « prendre leurs responsabilités ». Pour l’historienne, « loin de raviver la guerre des sexes, le mouvement #MeToo est une opportunité passionnante pour comprendre et résoudre le fossé entre hommes et femmes ». Un an après, quels enseignements tirez-vous de #MeToo et du mouvement qui s’en est suivi ? Laure Murat : Ce qui me frappe d’abord, c’est le caractère massif et spontané de #MeToo : un « fait divers » a déclenché un mouvement mondial qui est parti de la base, de centaines de milliers de femmes dans le monde. Et ce mouvement ne faiblit pas. Il est devenu incontournable. Ensuite, j’ai été frappée par le différentiel des réactions en fonction du genre : si la soudaineté et l’ampleur du mouvement ont étonné tout le monde, pas une femme n’a été surprise par la nature des plaintes, puisque toutes savent depuis l’enfance qu’elles sont des objets sexuels et toutes ont vécu, à un moment de leur vie, une main aux fesses, un geste déplacé, une insulte sexiste, etc. En revanche, les hommes sont tombés des nues. Qu’est-ce que cela nous dit sur les rapports hommes/femmes ? Ils ne se parlent pas ? Les hommes n’ont aucune idée de ce que vivent les femmes ? C’est un problème extrêmement grave, sérieux, profond, dont il faut s’emparer. Vous êtes française, mais vous enseignez et vivez à Los Angeles depuis douze ans. Quel regard portez- vous sur les débats français autour de #MeToo et la couverture médiatique du mouvement ? Aujourd’hui, on dirait que la France est le pays du non-débat. Je suis frappée par le vide intellectuel et la volonté délibérée d’une partie des médias d’étouffer Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 2 2/8 les questions sous de fausses polémiques. Au lieu de poser les bonnes questions, on ravive la guerre des sexes, les clichés sur les « féministes hystériques » et les « pauvres hommes », on invoque la virilité, la liberté d’importuner, on s’apitoie sur les frotteurs dans le métro, on discute des dérives et possibles ambiguïtés de #MeToo alors qu’on n’a pas commencé à parler du cœur du problème. On oppose X à Y, gauche à droite, pour à contre. Mais la dialectique, ce n’est pas la binarité. Pourquoi les philosophes ne s’emparent-ils pas de cette question ici ? Pourquoi est-ce toujours le fait de féministes – qui font un travail fondamental, par ailleurs ? Plus grave selon moi, ce traitement médiatique ne reflète pas ce qui se passe dans la société. Je ne suis pas sociologue, je n’ai pas fait d’enquête de terrain, mais j’observe ce décalage en posant systématiquement la question autour de moi : « Comment les gens de votre entourage réagissent ? Vos enfants ? Vos parents ? Votre compagnon, votre compagne ? » C’est une conversation démocratique qui se poursuit chaque jour dans la société, et les gens, y compris les hommes, sont beaucoup plus subtils que ce qu’on lit dans la presse. Les médias ont une responsabilité énorme là-dedans. Loin de raviver la guerre des sexes, le mouvement #MeToo est au contraire une opportunité passionnante pour comprendre et résoudre le fossé entre hommes et femmes, les hiatus du consentement et les souffrances d’une sexualité mal comprise, la logique de domination et d’abus de pouvoir qui empoisonnent les rapports personnels et professionnels. C’est la promesse d’un dialogue renouvelé pour les jeunes générations. J’aime beaucoup cette proposition de Gloria Steinem [féministe américaine devenue l’emblème de la lutte pour la libération des femmes dans les années 1970 – ndlr] : eroticize equality, érotiser l’égalité – sous-entendu : plutôt que la violence et l’oppression. La France a tout à gagner à lancer un débat sérieux et informé sur ces questions et les intellectuels, dont on déplore la disparition, à se saisir d’un enjeu vital pour l’avenir de la société. Ce débat doit inclure les hommes, qui ne doivent pas se sentir mal à l’aise, les jeunes entre 15 et 30 ans, car c’est cette génération qui a quelque chose à dire sur la zone grise, sur la façon dont envisager la vie sexuelle, amoureuse. C’est un problème passionnant, stimulant, qu’on est en train de réduire à une caricature qui a pour but d’éviter le débat. Aux États-Unis, à l’inverse, on peut débattre des limites de #MeToo, par exemple reprocher que cela reste d’abord un mouvement d’élites, mais le principe lui-même n’est plus l’objet de débats ? Oui, cela a infusé dans la société. Un exemple : dans la même semaine, les ouvrières de McDonald's – qui sont parmi les plus exploitées du pays et pour la plupart des femmes noires – se sont mises en grève, ce qui est historique, et le juge Brett Kavanaugh – proposé par Trump à la Cour suprême, la plus haute fonction – est sérieusement déstabilisé par une affaire de tentative de viol (sur ces deux sujets, lire les articles de Mathieu Magnaudeix ici et là). Pour ce qui est de la critique « mouvement d’élites », une précision importante : si l’affaire Weinstein est partie d’Hollywood, Time's Up a été lancé grâce à une solidarité entre les actrices d’Hollywood et le syndicat des agricultrices, qui rassemble 700 000 femmes aux États-Unis. Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit. Qui fait figure d’exception : la France ou les États- Unis ? Ce mouvement aurait-il été le même sans la présidence Trump, lui-même accusé d’agressions sexuelles ? Il est évident que si Hillary Clinton avait été élue, les choses auraient été très différentes. Et cela a un impact d’autant plus grand que l’on a Donald Trump au pouvoir. Les États-Unis sont une exception. Ou disons qu’ils sont spécialement proactifs et que la France est, par contraste, spécialement à la traîne. Aux États-Unis, il y a eu réactivité, en France, il y a eu réaction. Là-bas, on réagit parce qu’on prend conscience de l’enjeu : un problème apparaît, on ne met pas la couverture dessus, on s’en empare comme un sujet de société qu’il va falloir traiter, et on prend cela au sérieux – même s’il y a des options idéologiques contestables, des hypocrisies, etc. Ce n’est pas simple, mais au moins, cela existe. Quand le Sénat américain auditionne Christine Blasey Ford Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 3 3/8 contre le juge Kavanaugh, témoignage retransmis dans des millions de foyers jugé « crédible » par tous les commentateurs, en France, on a droit à la défense des « porcs émissaires » [titre du dernier livre d'Eugénie Bastié – ndlr]. Quand on sait la difficulté qu’ont les femmes à déposer plainte, c’est consternant. Nous faisons face à une lame de fond réactionnaire, née de la Manif pour tous, qui n’est pas nouvelle – la France reste un pays profondément de droite –, mais qui a sédimenté. « Le mythe de la galanterie à la française est un écran de fumée pour éviter l’impensé du sexisme » Comment expliquez-vous ce retard français ? Cela fait partie d’une logique historique ancienne et d’un problème récurrent en France. Combien de temps a-t-il fallu pour faire reconnaître le rôle de la France dans la déportation des juifs vers l’Allemagne ? Jusqu’au discours du vélodrome d’Hiver par Chirac, en 1995, il était d’usage de distinguer « l’État français » de la France, façon commode d’éviter d’exposer la responsabilité nationale. Parlez d’études postcoloniales et de la nécessité de reconnaître les crimes de la colonisation et on hurlera aux méfaits dommageables de la « repentance ». Parlez d’études de genre – qui se proposent d’interroger les normes et la façon dont se construisent le uploads/Litterature/ en-france-metoo-est-reduit-a-une-caricature-pour-eviter-le-debat.pdf
Documents similaires










-
146
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 18, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1684MB