DU C LES LANGUES ROMANES OUVRAGES DU MEME AUTEUR. Loi des finales en espagnol^
DU C LES LANGUES ROMANES OUVRAGES DU MEME AUTEUR. Loi des finales en espagnol^ in- 8°. Nogent-!e-Rotrou. 1872. sous PRESSE : Essai snr le patois normand du Bessin. FOUR PARAÎTRE PROCHAINEMENT : Goethe et Herder et la période d'orage. Du rhotacisme dans les langues germaniques. La littérature allemande en France avant la Révolution. ?t t-Zi' BIBLIOTHEQUE DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES PUBLIEE SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SCIENCES PHILOLOGIQUES ET HISTORIQUES SEIZIÈME FASCICULE DU G DANS LES LANGUES ROMANES, PAR CH. JORET, ANCIEN ÉLÈVE DE l'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES, PROFESSEUR AGRÉGÉ AU LYCÉE CHAKLEMAGNE. PARIS LIBRAIRIE A. FRANCK F. VIEWEG, PROPRIÉTAIRE RUE RICHELIEU, 67 iS7Zl DO '1.S/S' DU C DANS LES LANGUES ROMANES Charles JORET, ANCIEN ELEVE DE L ECOLE DES HAUTES ETUDES, PROFESSEUR AGREGE AU LYCÉE CHARLEMAGNE. PARIS LIBRAIRIE A. FRANCK F. VIEWEG, PROPRIÉTAIRE 67, RUE RICHELIEU 1874 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa http://www.archive.org/details/bibliothquedel16ecol A MESSIEURS Emile LITTRE, MEMBRE DE L INSTITUT, Gaston PARIS, PROFESSEUR AU COLLIiGE DE FRANCE. PRÉFACE On sait généralement aujourd'hui que l'italien et le roumain, l'espagnol et le portugais , le provençal et le français , qui constituent ce qu'avec quelques dialectes moins importants on désigne ordinairement sous le nom de langues romanes, sont sortis, non de l'idiome classique des anciens Romains, mais du latin vulgaire, transporté par la conquête dans les provinces situées entre les Balkans et le Danube et dans les divers pays qui compo- saient l'empire d'Occident. Ce parler populaire toutefois fut long- temps tenu en échec par la langue littéraire; les choses changèrent au V® siècle. L'invasion des barbares, la destruction de l'empire d'Occident qui en fut la suite, la suppression de toute centralisation politique et littéraire, en arrêtant subitement la civihsation latine, portèrent à la langue savante un coup mortel, et le parler \Tilgaire qui avait toujours subsisté, mais dédaigné et comme asservi, à côté d'elle, s'affranchit définitivement des entraves qu'elle lui impo- sait, et, recouvrant son indépendance native, finit par devenir prédominant. Cette première révolution fut suivie d'une autre encore plus importante. Au milieu de la division de l'empire, dans la confusion de toutes choses où vivait le monde romain, la langue ne pouvait échapper à ce double travail de décomposition et de recomposition dont les sociétés modernes devaient sortir ; elle se transforma à la fois et se reconstitua sur d'autres bases. C'est ainsi que les formes — X — complexes^ quelelatinvulgairepossédait en commun avec la langue savante, finirent par s'oblitérer, que ses terminaisons encore nombreuses se perdirent en partie ou se simplifièrent, et que l'idiome synthétique des anciennes peuplades du Latium, dépouillé peu à peu de ses flexions, prit le caractère analytique propre aux langues modernes de l'Europe occidentale. Mais en même temps qu'il se simplifiait et, à certains égards, qu'il s'appauvrissait ainsi, le roman créait de nouvelles formes et se reconstituait à nouveau. Désormais et pour longtemps, libre de toute règle et de toute contrainte, abandonné à l'action inconsciente de populations sans culture et ramené par là en quelque sorte à l'état de natm^e, il obéit à ce travail incessant de transformation auquel est soumis, surtout dans ces conditions qui semblent en augmenter la force végétative, tout langage humain. Il était impossible qu'au milieu de cette œuvre de décomposi- tion et de lente reconstitution les voyelles et les consonnes conservassent toujours leur valeur primordiale ^ aussi ont- elles été souvent modifiées; mais les changements qu'elles ont subis ont varié suivant les idiomes auxquels elles appar- tiennent. Comment, en effet, tant de races différentes, habitant sous des latitudes et dans des climats si divers, auraient- elles altéré de la même manière les sons qu'elles trouvaient dans le latin? Cependant, quelque grands et variés que soient les changements que ces sons ont éprouvés, on peut tenter de remonter à leur origine et d'en retrouver les lois qui ne sont autres que les lois générales du langage. L'étude de ces trans- formations est la base de la grammaire comparée des langues sœurs sorties du latin vulgaire ; elle constitue dans son ensemble la phonétique romane. Mais quelque avantage qu'il y ait à étudier simultanément les différents sons dont elle s'occupe, on peut aussi considérer isolément, pour en faire l'historique, l'un quelconque d'entre eux; c'est ce que je me propose d'essayer pour la gutturale c. 11 m'a semblé, en effet, qu'il ne serait peut-être pas sans intérêt, — afin de montrer, par l'étude complète d'un son particulier, de quelles ressources variées, de quelle force de transformation est doué le langage , — de rechercher quelles modifications cette lettre, qui en a incontestablement le plus éprouvé, avait subies dans le passage du latin au roman, et jus- qu'au moment de la constitution définitive des idiomes néo-latins. Je n'ai pas besoin de faire remarquer quelles difficultés offre cette étude : suis-je parvenu à en résoudre quelques-unes et à èclaircir plusieurs des points obscurs que présente la théorie des — XI — gutturales? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, et je reconnais par avance que, si j'y ai réussi, le mérite en revient en partie à ceux qui se sont occupés avant moi de ce sujet. J'ai cité, avec tout le soin possible, les ouvrages où j'ai puisé quel- ques renseignements dans le cours de mes recherches ; mais c'est un devoir pour moi de mentionner d'une manière toute spéciale la Grammaire comparée des langues romanes de Fr. Diez, ce livre qui est et restera longtemps le point de départ de la connaissance des idiomes issus du latin. Je dois aussi de précieuses indications à M. Paul Meyer, professeur à l'Ecole des chartes, et surtout à M. Gaston Paris, professeur au Collège de France, qui m'a même suggéré l'idée de cette étude. D'utiles corrections m'ont également été indiquées par MM. A. Darme- steter et L. Havet, mes anciens condisciples à l'Ecole des hautes études. Qu'Os veuillent bien recevoir ici l'expression de ma reconnaissance. Paris, 15 mars 1873. ABRÉVIATIONS. mod. LISTE DES PRINCIPAUX AUTEURS CITES DANS CET OUVRAGE. Abhandlxingen der Berliner Akademie der Wiszenschaften. Academy (The), a record of literature, Learning, Science and Art. A. N. Actes normands, v. Léop. Delisle. Adam, drame anglo-normand dti, XII'' siècle, p.p.Luzarche,in-8,Tours, 1854. Adam de la Halle. V. Théâtre français. Adenes li Rois, v. Berte aux grans pies et Cle'omadès. Aleb. Alebrant, cité par Littré. Al. Alexandre {El libre de), p. p. Janer in-8. Madrid, 1861. V. Poetas cas- tellanos. Alix. Alixandre {Li Romans d'), pub. p. H. Michelant. Stuttgard, 1846. Al. Alexis {La vie de saint), texte du XI' siècle, v. Gaston Paris. Altfranzœsische Lieder, berechtigt und erlxuterl von Ed. Mœtiner. Berlin, 1853. Altfranzœsische Lieder und Leiche v. W. Wackernagel. Amador de los Rios : Historia critica de la literatura espanola, 4 vol. in-8. Madrid, 1861. Anciens poètes de la France {les) p. sous la direction de M. F. Guessard. Andeer, P. J. Ueber Ursprungund GescMchte der RfiœtoromanischenSprache. In-12. Coire, 1862. A. N. Anthonii Nebrissensis Diccionarium. in-4. 1574, Ap. Apollonio {El Libre de) p. p. Janer, in-8. Madrid, 1861. V. Poetas cas- tellanos. Appendix Probi. V. Grammatici latini. H. Arc. Archiv. fur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. p. p. L. Herrig. Arcipreste de Hita {Poesias del). V. Poetas castellanos. Ascoli, G. I. Archivio glotiologico italiano. I. Saggi ladini, in-8. Roma, 1873. id. Lezioni di fonologia comparata, in-8. Firenze, 1870. id. Studji critici, in-8. Milano, 1861. Barlaam et Josaphat. Franzœsisches Gedicht des Xlllten Jahrhunderts, von Gui de Cambrai p. p. Herm. Zotenberg und Paul Meyer, in-8. Stutt- gard, 1864. B. Chr. Bartsch, k. Chrestomaihie de l'ancien français, in-4. Leipz. 1866. id. Chrestomathie provençale, 2' édit. in-4. Elberf. 1868. • id. Grundriss zur GescMchte der provenzalische Literatur, in-8. Elberf. 1872. Bataille d'Aleschans, v. Chansons de geste du XII" et XIII' siècle. Baudry, F. Grammaire comparée des langues classiques, in-8. Paris, 1868. Beauchet-Filleau : Essai sur le patois poitevin, etc., in-8. Melle, 1864. — XIV — Berceo : Del sacrificio de la Missa. V. Poetas castellanos. \. XV. B. M. id. Milagros de niiestra senora id. B. SD. id. San Domingo de Silos id. B, SM. id. San Millan {Vida de) id. Bernard, Aug. Geoffroy, Tory, peintre et graveur, in-8. Paris, 1863. Berte ans grans pies {Li romans de), p. p. Paulin Paris, in-8, 1836. Bestiaire v. Philippe de Thaon. Biondelli : Saggio dei dialetti gallico-italiani, in 8. Milano, 1853. Bibliothèque de l'Ecole des chartes. Bibliothèque de l'École des Hautes-Etudes. Blanc, D' L. G. : Grammatik der italienischen Sprache. ln-8, 1844. Blancandin et l'Orgueilleuse d'amour, p. p. Michelant. In-8, Paris, 1872. Bodel (Jehan) : Li jus Saint Nicholas, v. Théâtre français au Moyen-Age. id. La Chanson des Saxons, v. Saxons. B. Boece, p. p. P. Meyer, in-8, Nogent-Ie-Rotrou, 1872. Boehmer, Ed. Romanische Studien, in-4. Halle, 1871, 1872. Bopp. Fr. Vergleichende Grammatik der indergermanischen Sprachen, in-8, Berlin, 1833. Bouillii (Car.) Samarobrini liber de differentia vulgarium linguarum et gal- lici sermonis varietate. Par. Ex off. Rot). Stephani, 1533^ in-4. Brachet : Dictionnaire étymologique de la langue française, in-12, 1868. Brambach, Wilh : Die Neugestaltung der uploads/Litterature/ joret-charles-du-c-dans-les-langues-romanes-1874 1 .pdf
Documents similaires







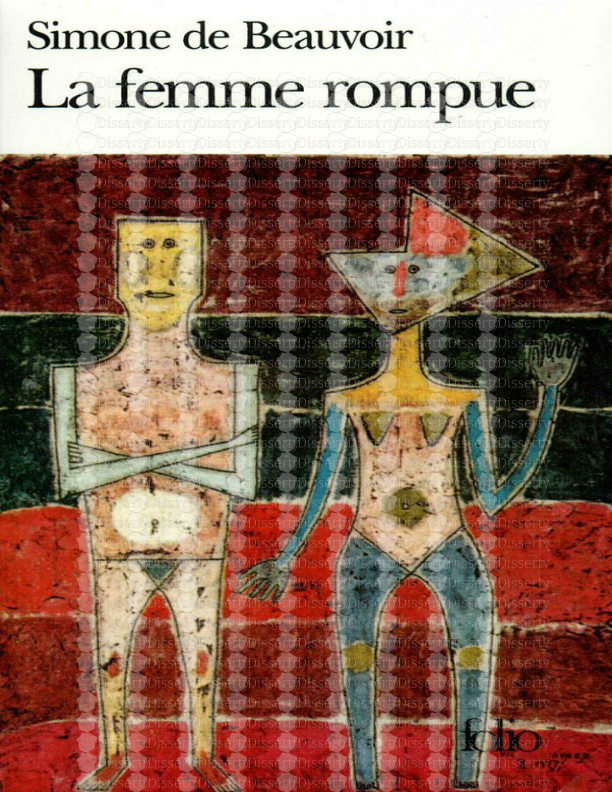


-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 28, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 19.5682MB


