Judith Schlanger Kleist . « l.'idée vient en parlant » In: Littérature, N°51, 1
Judith Schlanger Kleist . « l.'idée vient en parlant » In: Littérature, N°51, 1983. Poésie. pp. 3-14. Citer ce document / Cite this document : Schlanger Judith. Kleist . « l.'idée vient en parlant ». In: Littérature, N°51, 1983. Poésie. pp. 3-14. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/litt_0047-4800_1983_num_51_3_2200 Judith Schlanger. KLEIST : « L'IDEE VIENT EN PARLANT » Raconter pour savoir « Si tu ne trouves pas en réfléchissant ce que tu veux savoir, parles-en. » C'est le début d'un court essai de Kleist qui a pour titre « Ùber die allmâhliche Verfertigung der Gedanken beim Reden » (« Sur la constitution progressive des pensées à travers la parole »). Pour trouver ce que tu veux savoir, raconte- le. Adresse-toi à la première connaissance venue. Il n'est pas nécessaire que l'interlocuteur soit intelligent ou compétent; il ne te donnera pas l'information; ne lui pose pas de questions. Explique-lui, au contraire, ce que tu ne sais pas encore. Pour instruire les autres il ne faut parler que de ce qu'on comprend déjà; mais pour s'instruire soi-même il en va autrement. Tout comme l'appétit vient en mangeant, l'idée vient en parlant : Kleist donne ainsi (en français) la formule de son conseil. Le conseil suppose un but : savoir, comprendre; une difficulté : l'impuissance de la réflexion seule; et une solution : raconter ce qu'on ne sait pas mais qu'on voudrait savoir. Pour parler il faut s'adresser à quelqu'un : ce sera un interlocuteur quelconque, un pur auditeur. Situation A : ma table, ma sœur « Souvent je suis assis à ma table... » Le texte est continu mais passe d'une facette à une autre. Ces quelques pages qui ne sont pas divisées en paragraphes déroulent une succession de situations, de scènes, d'explications. La première vignette est celle du travail intellectuel. Elle met en scène l'expérience solitaire de l'étude et de la réflexion, cette même expérience que Kleist nomme aussi la méditation. C'est un effort de clarification. Plongé dans un litige compliqué, je cherche le point de vue qui permettra de l'éclairer et de le juger. Face à une question d'algèbre, je cherche le premier principe, l'égalité qui commande la solution. Table, livres, effort, concentration. Mais voici que la vignette s'élargit, se décentre, ajoute un arrière-fond essentiel à la scène : « Mais voici que lorsque j'en parle à ma sœur, qui est assise derrière moi et travaille... » La présence de la sœur, jointe à l'occupation de Kleist, permet de dater la scène. Ulrike, sa demi-sœur, est venue rejoindre en 1805 Heinrich von Kleist à Kônigsberg, où il travaille un certain temps comme fonctionnaire. H. Sembdner, l'éditeur des œuvres de Kleist, estime que cet essai a été conçu en 1805-1806, bien que la copie, qui porte les corrections de Kleist et peut- être celles d'Adam Millier, n'ait été établie qu'en 1807-1808 à Dresde. A Kônigsberg, Kleist, juriste, étudie ses dossiers en présence de sa sœur assise un peu en retrait. En lui parlant de ce qui le préoccupe, il perçoit ce que des heures d'incubation ne lui auraient pas appris. Comment l'aide-t-elle? assurément elle n'énonce pas la solution. Non seulement elle n'est pas compét ente en droit ou en mathématiques, mais encore elle ne joue pas non plus de rôle maïeutique. Il peut arriver que ses questions aiguillent la démarche, mais c'est accidentel. Entre le frère et la sœur, ce n'est pas le dialogue qui est heuristique. Il expose et elle écoute. Et comme le rôle de l'auditrice n'est pas directement intellectuel, elle aide tout particulièrement lorsqu'elle dérange. « Rien ne m'est plus salutaire qu'un geste de ma sœur, comme si elle voulait m'interrompre. » Clarification, délai Comme ce sera le cas tout au long de cet essai, l'analyse vient en contrepoint de la scène. J'ai une représentation obscure qui est liée de loin à ce que je cherche. Si j'ai la hardiesse de commencer, il faudra bien que mon propos aboutisse. A mesure qu'il se déroule la représentation se clarifie, et « à ma surprise, la connaissance est prête quand la période prend fin ». Quand je termine je sais. Pour gagner à la pensée le temps dont elle a besoin, l'improvisation tend à étirer le discours. Quelques sons inarticulés, des mots de liaison, des appositions inutiles, tout cela laissera plus de temps à ce que Kleist nomme la fabrication de l'idée. On sera naturellement tenté de ralentir renonciation et de surcharger la syntaxe. Mais aussi, inversement, dans le même laps de temps la pensée peut se faire plus intense et plus rapide. C'est justement ce qui arrive lorsqu'un mouvement de la sœur fait craindre une interruption. Menacé de se voir arracher la parole, l'esprit déjà tendu s'excite davantage encore, tout comme un grand général devient plus efficace sous la pression des circonstances. Quand l'auditrice fait mine de vouloir intervenir (couper pour coopérer), sa menace est bénéfique et, indirectement, féconde. Pourtant elle introduit le danger au cœur même de la communication idyllique. Celui qui détient la parole se sent agressé. D'où l'image militaire, qui est ici toute positive et même, si l'on veut, sportive. Mais qui signale dans la scène de l'étude et dans l'exposé de la connaissance la pointe du conflit. Situation A' : le visage de la servante La scène a un doublet un peu décalé, dans lequel la situation homme didactique-femme destinataire glisse de l'aveu à l'allusion littéraire, de Kleist à Molière, et de la sœur à la servante. C'est parce que l'auditeur n'a qu'une fonction intellectuelle indirecte que la servante de Molière lui est utile. Molière, lorsqu'il lui lit ses pièces, ne lui demande pas son avis ou son jugement; mais son visage attentif, sa disponibilité, son regard. « II y a une exaltation singulière, pour celui qui parle, dans un visage humain qui lui fait face »; et le regard qui paraît comprendre ce qui est à moitié exprimé nous offre, du même coup, l'expression du reste. C'est ici la situation idéale de la communication : un visage à qui parler, pour qui parler, un visage qui écoute, regarde et comprend. La servante est un peu plus anonyme et plus passive que la sœur : purement attentive, sans questions, sans menaces d'intervention. Mais aussi dans son cas la communication a écarté les dossiers à traiter et les problèmes à résoudre. S'agit-il encore de connaître? Quand le tableau change à nouveau, ce n'est en tout cas plus de comprendre qu'il s'agit. Situation B : le discours de Mirabeau « Je crois que plus d'un grand orateur, au moment d'ouvrir la bouche, ne savait pas encore ce qu'il allait dire. » S'il a pu trouver la hardiesse de commencer, c'est qu'il savait que le plein des idées lui viendrait des circons tances et de l'excitation d'esprit. Suit l'exemple de la fameuse réponse de Mirabeau le 23 juin 1789, réponse que Kleist analyse comme l'engendrement du thème dans la courbe du souffle, la position conçue à travers renonciation. Cette analyse est le passage le plus connu de l'essai de Kleist. L'analyse part du moment où Dreux-Brézé rentre dans la salle des États et demande aux députés s'ils ont entendu l'ordre que leur a donné le roi de se séparer. « Oui, répondit Mirabeau, nous avons entendu l'ordre du roi » (je suis sûr que dans ce début modéré il ne pensait pas encore aux baïonnettes de la fin) « oui, monsieur, répéta-t-il, nous l'avons entendu » (on voit qu'il ne sait pas encore bien ce qu'il veut) « mais qui vous autorise », continua-t-il (et brusquement surgit en lui une source d'idées grandioses) « qui vous autorise à nous parler ici d'ordres? Nous sommes les représentants de la nation » (voilà ce qu'il cherchait!) « la nation donne des ordres et n'en reçoit pas » (pour s'élancer au faîte de la témérité) « Et pour m'expliquer tout à fait clairement avec vous » (et c'est seulement là qu'il trouve ce qui exprime toute la résistance vers laquelle son âme se tend) « allez dire à votre maître que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes » - Sur quoi, satisfait, il se rassied ». Électricité Dans son interprétation de la scène, Kleist englobe aussi les moments de moindre tension qui suivent. Le Maître des cérémonies, tout d'abord, sort annulé, en pleine banqueroute mentale. A peine est-il sorti que Mirabeau se relève et propose de déclarer la personne des députés inviolable; proposition que Kleist perçoit comme une mesure pratique de prudence. L'orateur au départ ne savait pas à quoi il allait aboutir; la dynamique orale l'a poussé au- delà de sa hardiesse propre; elle l'a déporté vers un excès d'audace qui le dépasse. Mais cette audace dépensée, il retrouve la prévoyance et la peur du Châtelet. L'acuité de l'audace a créé une nouvelle situation, qui appelle à son tour des précautions concrètes. Du point de vue du discours, Mirabeau prenant la parole est dans une situation assez semblable à celle de Kleist entreprenant d'expliquer à sa sœur ce qu'il ne comprend pas encore. L'un et l'autre sont pris dans la uploads/Litterature/ judith-schlanger-kleist-l-x27-idee-vient-en-parlant 1 .pdf
Documents similaires








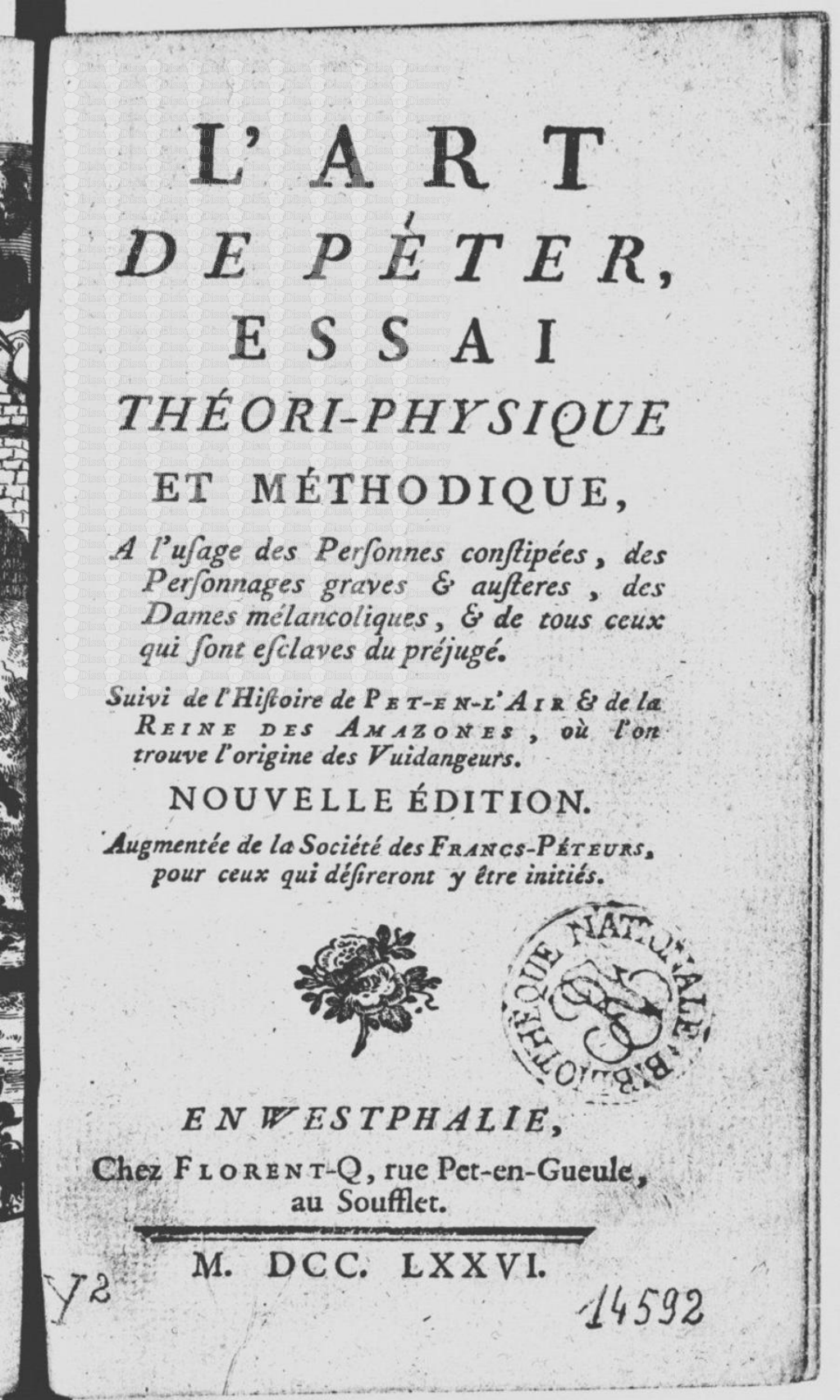

-
78
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9214MB


