Tous droits réservés © Collectif Liberté, 2001 Ce document est protégé par la l
Tous droits réservés © Collectif Liberté, 2001 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 26 avr. 2022 08:46 Liberté L’Expérience mystique en son lieu au-delà de toute connaissance Fernand Ouellette L’expérience mystique Volume 43, numéro 2 (252), mai 2001 URI : https://id.erudit.org/iderudit/32734ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Collectif Liberté ISSN 0024-2020 (imprimé) 1923-0915 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Ouellette, F. (2001). L’Expérience mystique en son lieu au-delà de toute connaissance. Liberté, 43(2), 63–75. L'Expérience mystique en son lieu au-delà de toute connaissance Fernand Ouellette Il n'y a rien de plus admirablement unique que l'expérience mystique, même si les textes qui s'efforcent d'en rendre compte, se recoupent et convergent vers une même impossibilité : dire d'une rencontre ce qui ne peut être dit, ce qui appartient au mys- tère de Dieu - d'où l'origine du mot mystique -, tout en rêvant de le dire avec des mots qui seraient taillés dans la lumière même de Dieu. Vivre d'une manière mystique, c'est se perdre, laisser l'âme aller « au-delà d'elle-même », dans le « nuage de l'inconnaissance », mourir à soi, se laisser habiter par Dieu, l'Inconnaissable, par le Présent-Absent, selon le mode de relation choisi par le Christ ressuscité. En soi le discours mystique, si intensément, personnellement organisé soit-il, ne peut être qu'une traduction faisant son chemin dans le nous du langage dirait de Certeau1. Mais bien plus qu'une pratique de langage, il est le recours extrême d'un « je » pour ne pas se désancrer de la Présence absente. « La loi de l'authentique n'interdit rien, écrivait Maurice Blanchot, mais n'est jamais satisfaite2. » Il lui faut toujours produire sa vérité. 1 L'Absent de l'histoire, Paris, Marne, 1973, p. 44-45, cité par Sylvain Destrempes, In « L'Altérité dans le discours mystique selon Michel de Certeau », thèse inédite, 15 mai 1998, p. 15. 2 Le Livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1971, p. 71. 61 Ainsi le discours mystique nous guide-t-il au-delà de lui-même en s'efforçant de faire passer en langage, affaibli par ses contraintes, la Présence ressentie, entraperçue dans la fente du rocher, la Présence manquante, mais toujours possible de l'Autre, transcendant. Il ne reste, d'une forte expérience d'union, qu'un être transmué, exténué, et un langage qui s'efforce de communi- quer le cri de celui qui ressent la perte du Disparu. C'est du lan- gage après la Présence. Une épreuve de « deuil impossible ». Comment le discours pourrait-il échapper à « la blessure que le Silence de Dieu fait dans le langage3 », dit magnifiquement Michel de Certeau, et s'adapter au langage insaisissable de l'Esprit Saint ? D'où, par conséquent, l'impossibilité d'un pareil langage, d'une pareille connaissance qui est tendue vers l'Inconnaissable, vers le Non-Objet. D'où son impasse. Le lan- gage ne peut que travailler, c'est-à-dire souffrir, progresser jusqu'à l'épuisement, d'autant que l'Autre qui l'attire est en soi Lui-même inépuisable. L'expérience mystique consume l'âme désirante qui pénètre dans le champ d'attraction du Présent- Absent, plus qu'elle ne l'éclairé, dirait saint Bonaventure. Elle tient plus du feu que de la lumière. Il suffit d'entendre les lamen- tations d'Angèle de Foligno découvrant les trahisons de son tra- ducteur. Comment un tel discours qui s'avance en effet au-delà de toute connaissance, avec un intellect impuissant, dans une tension constante entre l'expérience vécue et le langage, comment pourrait-il déboucher sur une méthode ou un système, comment pourrait-il être objectivable ? Lorsque moi-même j'essaie de l'appréhender, à vrai dire, je le fais glisser hors de sa constellation dense et singulière, je le relè- gue au sein de mes expériences les plus déterminantes, en elles- mêmes si pauvres, tout en m'efforçant d'écouter ses harmoni- ques. Tout se passe au cœur d'un être qui se situe tellement en deçà de la haute expérience. Mais voilà, comment le faire sans ce que soit une simple translation, comment le garder vif sans « en- trer dans le mensonge », dirait Blanchot ? Un tel discours si élevé, si déroutant, ne peut frayer sa voie en nous que dans la mesure où nous sommes nous-mêmes en quête de la même Présence et que nous nous sommes quelque peu rapprochés de La Fable mystique, 1, X V - X V f siècle, Paris, Galllimard, coll. «Tel », 1987, p. 207. 62 Sa Lumière. Sinon, avec quelque détracteur de Fénelon qui n'avait rien compris à la mystique, nous pourrions dire que le mysticisme « subordonne la raison au sentiment », alors que la voie mystique me paraît, au contraire, le sentier sur le sommet d'une raison embrasée, bien qu'elle soit douloureusement cons- ciente de ses limites, en bref une voie qui s'avance dans « l'inconnu de Dieu » et se donne à l'Amour. Jean Baruzi écrit : « la pensée mystique, en ses plus hauts moments, se complaît en un silence lui-même créateur, mais dont le mystique, au plus profond de la contemplation, est le seul témoin [...] [elle] est une nouvelle façon de penser l'absolu4 ». Saint-Cyran, sur un autre plan, avait eu une vue semblable en exaltant la métaphore et le paradoxe qui servaient mieux le lan- gage mystique que la précision d'un travail spéculatif. Enfin, pour nous rapprocher quelque peu de notre sujet, le sulpicien Michel Dupuy propose une définition de la mystique à partir du Pseudo-Denys : « La mystique serait une expérience, située dans un itinéraire spirituel comportant un certain nombre d'étapes, et qui entraîne au-delà de tout savoir et de toute connaissance ». En somme, si nous pouvons dire que c'est dans un silence créateur, dans la grâce de la contemplation que le mystique atteint ses états les plus subtils, et qu'il se risque dans ce lieu indicible qu'est l'au-delà de toute connaissance, c'est tout de même dans le fond de l'âme qu'il se prépare à l'union, comme à l'anéantissement, et qu'il commence son itinéraire avec Dieu, en Dieu, car là habite Dieu, et là se produit l'union, dit La Perle évan- gélique. Voilà son espace de travail et d'ouverture à l'Amour. Voilà le sens de l'expérience du mystique. Celui-ci s'efforce de nous communiquer, en transmutant les mots, en les ouvrant, quelques éclats de la lumière indescriptible ou de la nuit inéluctable, et cela à travers un texte qui a le ton d'une confidence ou la forme d'une lettre, d'un poème ; mais un écrit, le plus souvent, que l'obéissance commande au mystique, et surtout une écriture qui 4 Cf. L'Intelligence mystique, textes choisis et présentés par Jean-Louis Vieillard- Baron, Paris, L'île verte/Berg International, 1985, p. 56. Dans sa communication au Congrès international de philosophie, à Rome, en 1946, Jean Baruzi fait la critique de « l'usage illégitime » du mot mystique, tout particulièrement dans ses déviations vers le collectif. 63 lui paraît désespérément utopique. « Est mystique, écrit Michel de Certeau, celui qui ne peut s'arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici ni se contenter de cela. [...] Il faut aller plus loin, ailleurs. Il n'habite nulle part. » Que la rencontre avec Dieu ait lieu dans le « fond de l'âme », conception propre aux Flamands, ou bien à la « pointe de l'es- prit », vue plus proche de celle de François de Sales, elle a lieu là où Dieu établit « son trône et son ciel », dans un « va-et-vient de montée et de descente », dans un abîme qui oscille de l'abaisse- ment à l'illumination, de l'annihilation à l'abandon au sein de la Présence dévorante, selon l'expérience même qu'un mystique a de la rencontre essentielle*. Comme si notre Dieu, pour agir, choisissait l'espace de l'intimité profonde de l'être, de son for in- térieur, de son repli le plus silencieux - ce qui ne peut se conce- voir, certes, sans que l'être fasse le vide en lui pour que la Plénitude divine l'occupe, ni sans s'abaisser, s'anéantir, ni sans surrection de l'âme, ni sans tensions, ni sans une expérience de dévoration -, à moins que l'âme elle-même, « introvertie hors de soy », dit La Perle évangélique, soit déportée en Dieu. Mais là en- core la nuit l'enserre, la dénude, et le vertige et le dépaysement ne peuvent que l'imprégner. Nuit vécue avec de grandes plages de purification, de sécheresse intense où l'âme doit apprendre à se désencombrer, à se simplifier, à se tenir paisible dans une adhésion parfaite à la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'abandon. Et cela même lorsque le mystique, non sans force ten- sions d'ailleurs, s'oriente vers le Christ, contemple sa Passion dans un mouvement uploads/Litterature/ l-x27-experience-mystique-en-son-lieu-au-dela-de-toute-connaissance.pdf
Documents similaires


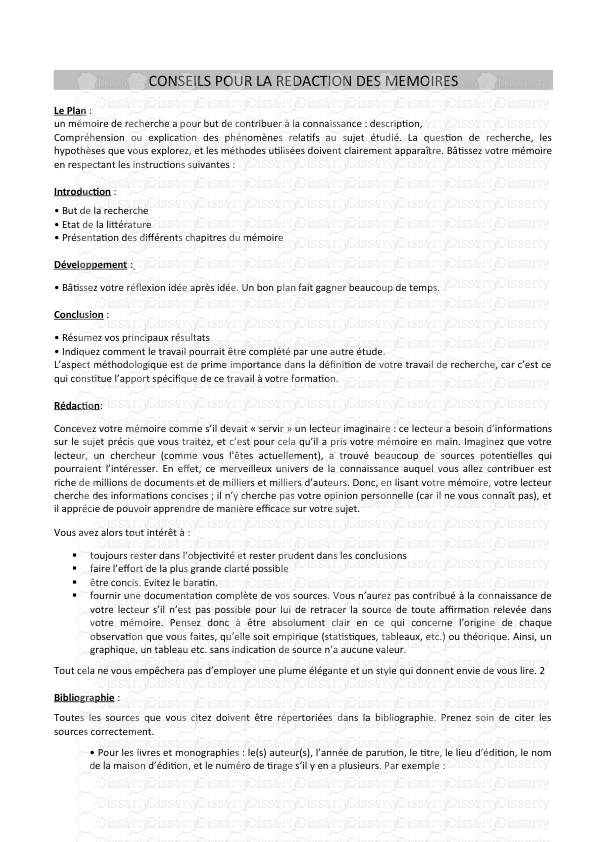







-
145
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 31, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 2.9228MB


