Tous droits réservés © Faculté de droit de l’Université Laval, 1997 Ce document
Tous droits réservés © Faculté de droit de l’Université Laval, 1997 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 22 mai 2021 09:32 Les Cahiers de droit La notion d'auteur et le droit d'auteur au cinéma : aperçu historique, juridique et sociologique Yves Laberge Volume 38, numéro 4, 1997 URI : https://id.erudit.org/iderudit/043468ar DOI : https://doi.org/10.7202/043468ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Faculté de droit de l’Université Laval ISSN 0007-974X (imprimé) 1918-8218 (numérique) Découvrir la revue Citer cette note Laberge, Y. (1997). La notion d'auteur et le droit d'auteur au cinéma : aperçu historique, juridique et sociologique. Les Cahiers de droit, 38(4), 899–917. https://doi.org/10.7202/043468ar Résumé de l'article Le statut de l'auteur au cinéma a longtemps fait l'objet de débats et de conceptions divergentes. À partir d'une étude historique montrant l'évolution et l'élargissement du statut de l'auteur d'un film et la reconnaissance progressive du metteur en scène à ce titre, nous comparerons les apports respectifs du droit du cinéma (conventions, lois, jugements), de la théorie et de la critique cinématographiques à la compréhension de ce phénomène. Nous conclurons en mettant en évidence quelques problèmes auxquels les auteurs (du milieu du cinéma) doivent maintenant faire face. NOTE La notion d'auteur et le droit d'auteur au cinéma : aperçu historique, juridique et sociologique Yves LABERGE Le statut de l'auteur au cinéma a longtemps fait l'objet de débats et de conceptions divergentes. À partir d'une étude historique montrant l'évolu- tion et l'élargissement du statut de l'auteur d'un film et la reconnaissance progressive du metteur en scène à ce titre, nous comparerons les apports respectifs du droit du cinéma (conventions, lois, jugements), de la théorie et de la critique cinématographiques à la compréhension de ce phénomène. Nous conclurons en mettant en évidence quelques problèmes auxquels les auteurs (du milieu du cinéma) doivent maintenant faire face. For many years conflicting debates and ideas have marked the subject of author status in the film industry. Based on an historic study showing the evolution and expansion of the status of a film's author and the growing recognition of the director in this respect, we compare respective contribu- tions from law applying to cinema (treaties, laws, legal decisions), theory and filmland critics in coming to terms with this phenomenon. To conclude, we review a range of recent problems with which cinematographic authors must cope. * Chercheur associé au Laboratoire Communication et politique, Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Paris. Les Cahiers de Droit, vol. 38, n° 4, décembre e997, pp. 899-917 (1997) 38 Les Cahiers de Droit 889 900 Les Cahiers de Droit (1997) 38 C. de D. 899 Pages 1. Le cinéma : art individuel ou industrie collective? 901 2. L'état de la question': la place de l'auteur 903 3. Trois essais historiques sur l'auteur au cinéma 905 4. À l'origine du débat : à qui appartient le film ? 907 4.1 Les premières années 909 4.2 L'entre-deux-guerres 910 4.3 La période contemporaine 912 4.4 Le cinéma comme phénomène de société 912 5. D'autres événements et prolongements 914 6. La transformation et la colorisation des œuvres au cinéma 914 Conclusion 916 Les questions touchant le droit d'auteur au Canada relèvent des lois fédérales. L'œuvre cinématographique y est définie de façon assez large, qui pourrait également inclure les œuvres tournées sur support vidéo (comme les téléromans) : « Y est assimilée toute œuvre exprimée par un procédé analoque à la cinématographie, à l'exclusion toutefois pour l'article 11.1, d'œuvres auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère original1. » Alors que les problèmes liés au droit d'auteur ont donné lieu à de nombreux débats en France, comme nous le verrons ci-dessous, cette ques- tion a provoqué relativement peu de discussions au Canada ; on note à ce propos que la paternité du droit d'auteur en matière de cinéma est réglée (du moins temporairement, au Canada) au moment de la signature du contrat entre le créateur (scénariste, musicien pour le film, réalisateur) et le produc- teur, lorsque ce dernier devient, par une clause, propriétaire de l'œuvre à être tournée. La loi canadienne définit le producteur de la manière suivante : « La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d'une œuvre cinématographique, d'une empreinte, d'un rouleau perforé ou autre organe à l'aide duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement2. » Comme nous le verrons plus loin, cette définition du producteur (telle qu'elle est décrite dans la loi canadienne) pourrait facilement être confon- due avec celle du réalisateur (metteur en scène au cinéma), ce qui a d'ailleurs été l'objet d'un long débat en France, à savoir : à qui appartient l'œuvre ? Au scénariste, au réalisateur, au producteur, ou aux trois ? Avant de répondre 1. Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42, art. 2. 2. Ibid. Y. LABERGE Droit d'auteur au cinéma 901 à cette question centrale, nous tenterons de définir les fonctions de chacun et de retracer les principales étapes de ce combat de plusieurs décennies. 1. Le cinéma : art individuel ou industrie collective ? Qui peut être considéré comme l'auteur légitime d'un film ? Le do- maine de l'industrie du cinéma implique des problèmes particuliers et com- plexes, que l'on ne rencontre pas dans d'autres formes artistique lorsqu'on examine des questions touchant le droit d'auteur et la propriété intellec- tuelle. Autrement dit, ce qui semble relativement clair pour déterminer le statut et l'originalité d'un artiste dans le domaine de la littérature, de la peinture ou de la musique ne paraît pas toujours évident dans le secteur du cinéma. Ainsi, la question de la paternité d'un livre, d'une toile, d'une œuvre musicale laisse habituellement peu d'équivoque et concerne normalement un seul créateur (en l'occurrence l'écrivain, le peintre, le compositeur). Empruntons un exemple au monde de la musique: telle symphonie de Beethoven, qu'elle soit dirigée par Karajan, Bernstein ou Boulez, demeure, malgré les variantes, les interprétations, l'orchestre et son chef, une œuvre authentique de Beethoven. Par ailleurs, on conviendra que le metteur en scène au théâtre ne s'approprie jamais la place de l'écrivain dramaturge, qui rédige le texte et les dialogues de la pièce : on dira une pièce de Molière ou de Shakespeare, peu importe la contribution—essentielle et personnelle— du metteur en scène et l'apport du scénographe à la matérialisation du texte théâtral. La question de déterminer qui pourrait légitimement être tenu pour l'auteur d'un film mérite cependant des considérations toutes particulières, du point de vue tant artistique ou thématique que juridique. En fait, le statut de l'auteur au cinéma a beaucoup changé selon les époques et les pays3. De Voir J.C. TACCHELLA, J.-J. MEUSY, V. PINEL, J.-P. JEANCOLAS et L. HEYNEMANN, L'auteur du film—Description d'un combat, Paris, Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Éditions Actes Sud, Institut Lumière et Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, 1996, 181 p. Les cinq auteurs du livre sont cités dans l'ordre de succession des articles. Tacchella est réalisateur de films et membre actif de la SACD ; Meusy est chercheur attaché au CNRS ; Pinel est écrivain et historien du cinéma ; Jeancolas est critique de films (pour la revue française Positif). De plus, les deux derniers sont respectivement trésorier et président de l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma et membres du comité de rédaction de la revue française 1895 Revue de llAssociation française de recherche sur l'histoire du ccnéma, spécialisée en histoire du cinéma. Dans ce livre, ceux-ci se penchent sur l'évolution du statut d'auteur au cinéma et retracent les principales étapes de la reconnaissance du réalisateur en tant que véritable auteur de films. Cet ouvrage collectif, extraordinairement coédité par quatre éditeurs ou organismes français est identifié non pas par celui qui est à l'origine du projet Laurent Heynemann (qui signe modestement la postface du livre) mais bien par ses trois principaux auteurs (par l'ampleur relative de leurs articles 3. 902 Les Cahiers de Droit (1997) 38 C. de D. .89 plus, le cinéma, à la fois art et industrie, semble obéir à des règles parfois rigides, parfois insaisissables, à l'intérieur des mécanismes de production institutionnalisés résultant habituellement d'un travail collectif. Dans son ouvrage majeur intitulé Movies and Society, le sociologue canadien Ian Jarvie pose dès le premier chapitre cette question devenue fondamentale pour la sociologie du cinéma : « Qui fait les films, comment et pourquoi ? », et souligne (tout en y répondant) la quasi-impossibilité pour une seule personne de réaliser un film complet sans aucune aide extérieure ni d'autres collaborateurs4. En fait, le caractère inévitablement collectif de certaines formes de création artistique, dont le cinéma, a été souligné par d'autres chercheurs. uploads/Litterature/ la-notion-d-x27-auteur-et-le-droit-d-x27-auteur-au-cinema-apercu-historique-juridique-et-sociologique.pdf
Documents similaires


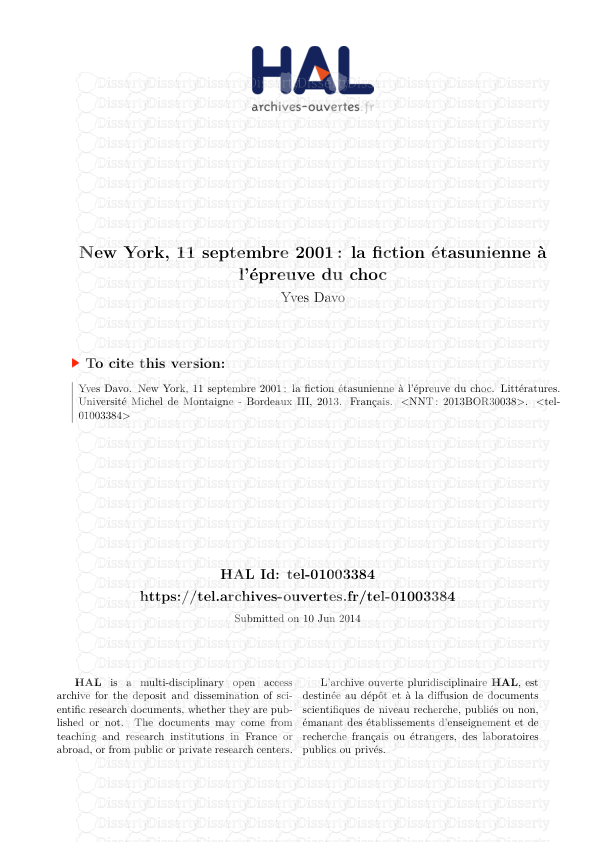







-
55
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1559MB


