MAURICE MERLEAU-PONTY a prose du monde TEXTE ÉTABLI ET PRÉSENTÉ PAR CLAUDE tEFO
MAURICE MERLEAU-PONTY a prose du monde TEXTE ÉTABLI ET PRÉSENTÉ PAR CLAUDE tEFORT GALLIMARD Tous droits de t1~aduc~ion, de reproduction et d'adaptation reserves pour tous les pays. ©Éditions Gallimard, 1969. AVERTISSEMENT L'ouYrage que Maurice Merleau-Ponty se proposait d'intituler La prose du monde ou Introduction à la prose du monde est inacheYé. Sans doute deYons-nous même penser que l'auteur l'abandonna délibérément et qu'il n'eût pas souhaité, YiYant, le conduire à son terme, du moins dans la forme autrefois ébauchée. Ce liYre demit constituer, lorsqu'il fut commencé, la première pièce d'un diptyque -la seconde reYêtant un caractère plus franchement métaphysique - dont l'ambition était d'offrir, dans le prolongement de la Phénoménologie de la perception, une théorie de la yérité. De l'intention qui commandait cette entreprise nous possédons un témoignage, d'autant plus précieux que les notes ou les esquisses de plan retrouYées sont d'un faible secours. Il s'agit d'un rapport adressé par l'auteur à M. Martial Gueroult, à l'occasion de sa candidature au Collège de France 1, Merleau-Ponty énonce, dans ce document, les idées maîtresses de ses premiers traYaux publiés, puis signale qu'ils' est engagé depuis 1945 dans de nouYelles recherches qui sont 1. Un inédit de Merleau-Ponty. Revue de Métaphysique et de Morale, no 4, 1962, A. Colin. II LA PROSE DU MONDE destin~es « à fixer définitivement le sens philoso- phique des premières ))' et rigoureusement articulées à celles-ci puisqu'elles reçoiYent d'elles leur << itinéraire )) et leur « méthode )), « Nous avons cru trouver dans l'expérience du monde perçu, écrit-il, un rapport d'un type nouveau entre l'esprit et la vérité. L'évidence de la chose perçue tient à son aspect concret, à la texture même de ~es qualités, à cette équivalence entre toutes ses propnétés sensibles qui faisait dire à Cézanne qu'on devait pouvoir peindre jusqu'aux odeurs. C'est dev.ant not~e existence indivise que le monde est vrai ou existe; leur unité, leurs articulations se confondent et c'est dire que nous avons du monde une notion globale dont l'inventaire n'est jamais achevé, et que nous faisons en lui l'expérience d'une vérité qui. transpar~î~ ou nous en~lobe plutôt que notre esprit ne la detient et ne la mrconscrit. Or si maintenant nous considérons, au-dessus du perçu: le champ de la connaissance proprement dite, où l'esprit veu~ poss~de~ l~ vrai, défi~ir lu~-même des objets et acceder ams1 a un savmr umversel et délié des particularités de notre situation, l'ordre du perçu ne fait-il pas figure de simple apparence, et l'entende- ment pur n'est-il pas une nouvelle source de connais- sanc.e en regard de laquelle notre familiarité per- ceptive avec le monde n'est qu'une ébauche informe? Nous sommes obligés de répondre à ces questions par une théorie de la vérité d'abord, puis par une théorie de l'intersubjectivité auxquelles nous avons touché dans différents essais, tels que Le doute de Cézanne, Le ro~an et fa mét~p~ysi.que, ou, en ce qui concerne la philosophie de l histmre, Humanisme et AVERTISSEMENT III terreur mais dont nous d~vons élaborer en toute rigueu; les fondements philosop~iques. La théorie de la vérité fait l'objet de deux hvres auxquels nous travaillons maintenant. >> Ces deux liYres sont nommés un peu plus loin : Origine de la vérité et Introduction à la prose du monde. Merleau-Ponty définit leur commun propos qui est de fonder sur la découYer~e du corps co~rm~e corps actif ou puissance symbohque « une theorie concrète de l'esprit qui nous le montrera dans un rapport d'échange avec les instruments q~'il s~ donne )) ... Pour nous refuser à tout commenlatre qut risquerait d'induire abusiYement les pensées du lecteur, bornons-nous à indiquer que la théorie concrète de l'esprit deYait s' m·donner autour d'une idée neuye de l'expression qu'il y aurait à déliYrer et de l'analyse des gestes ou de l'usage mimique du corps et de celle de toutes les formes de langage, jusqu'aux plus sublimées du lan ga ge mathématique. Il import~, en reYanche, d'attirer l'attention sw· les quelques lLgnes qui précisent le dessein de La prose du monde et font état du traYail accompli. « En attendant de traiter complètement ce pro- blème (celui de la pensée formelle et d,U ~~~gage) dans l'ouvrage que nous préparons sur Al ?ngme. de la yérité nous l'avons abordé par son cote le moms ' .. , , . abrupt dans un livre dont la mOitie est ecr~te e.t qui traite du langage littéraire. Dans ce ~om~me, !1 est plus aisé de montrer que le lang~ge n est ~ama~s le simple vêtement d'une pensée qm s~ pos~ederalt elle-même en toute clarté. Le sens d un hvre est premièrement donné non tant par l.es idées, que par une variation systématique et msohte des modes du ry LA PROSE DU MONDE langage et du récit ou des formes littéraires exis- tantes. Cet accent, cette modulation particulière de la parole, si l'expression est réussie, est assimilée peu à peu par le lecteur et lui rend accessible une pensée à laquelle il était quelquefois indifférent ou même rebelle d'abord. La communication en litté- rature n'est pas simple appel de l'écrivain à des significations qui feraient partie d'un a priori de l'esprit humain : bien plutôt elles les y suscitent par entraînement ou par une sorte d'action oblique. Chez l'écrivain la pensée ne dirige pas le langage du dehors : l'écrivain est lui-même comme un nouvel idiome qui se construit, s'invente des moyens d'expression et se diversifie selon son propre sens. Ce qu'~n appelle poésie n'est peut-être que la partie de la httérature où cette autonomie s'affirme avec ostentation. Toute grande prose est aussi une recréa- tion de l'instrument signifiant, désormais manié selon une syntaxe neuve. Le prosaïque se borne à toucher par des signes convenus des significations déjà installées dans la culture. La grande prose est l'art ?e capter un sens qui n'avait jamais été objectivé Jusque-là et de le rendre accessible à tous ceux qui parlent la même langue. Un écrivain se survit quand il n'est plus capable de fonder ainsi une universalité nouvelle et de communiquer dans le risque. Il nous semble qu'on pourrait dire aussi des autres insti- tutions qu'elles ont cessé de vivre quand elles se montrent incapables de porter une poésie des rapports humains, c'est-à-dire l'appel de chaque liberté à toutes les autres. Hegel disait que l'Etat romain c'est la prose du monde. Nous intitulerons Introduc- tion à la prose du monde ce travail qui devrait, en AVERTISSEMENT v élaborant la catégorie de prose, lui donner, au-delà de la littérature, une signification soci?logique. » , Ce texte constitue assurément la meûleure des pre: sentations de l'ow)rage que nous publions. Il a aussL le mérite de jeter quelque lumière sur les dates de sa rédaction. Adressé à M. Gueroult peu de temps arant l'élection du Collège de France- laquelle se déroula en féyrier 1952 -,.nous ne douton~ pas qu'il se ré~ère aux cent soixante-dtx pages retrouyees dans les papwrs du philosophe après sa mort. Ce .sont hie'!' ces pages ui forment la première moitié du lw re alors mterrompu. Jvotre conYiction se fonde en effet sur deux obseryatwns complémentaires. La première est. qu'en ~oût 19?2 Merleau-Ponty rédige une note q~u porte, l tnYe~.tatr,e des thèmes déjà traités j or, celle-ct, mal~re sa bneYete, désigne clairement l'ensemble des chapttres que ~ou.s possédons. La seconde est qu'entre le moment ou tl fait connaître à M. Gueroult l'état d'.aYancemen,t .de son traYail et le mois d'août, le phtlosophe dectde d'extraire de son ouYrage un chapitre. important. et de le modifier sensiblement pour. le. publt~r en ~s~at dans Les Temps modernes : celut-ct pa.ra~t en ]Utn et en juillet de la même année, sous le tttre Le langage indirect et les voix du silence. Or nous a~ons la preuYe que ce dernier t~aYai! ne, f~t pas entrepns Man~ le mois de mars, car tl fatt reference en son. ,dé,but ~ un lirre de M. Francastel, Peinture et societe, qut ne sortit des presses qu'en férrier. Certes, ces quelque~ éléments ne permettent pas de fixer la date exacte a laquelle le manuscrit fut interrompu. Ils nous ~uto risent toutefois à penser qu'elle ne fut pas posténeure au tout début de l'année 1952. Peut-être se situe-t-elle quelques mois plus tôt. Mais comme nous sarons, VI LA PHOSE DU MONDE d'autre part, par une lettre que l'auteur adressait à sa femme, lors de l'été précédent, qu'il consacrait en ~acances. le pr~n~ipal de son tra~ait à La prose du monde, d est leg~t~me de supposer que l'arrêt eut lieu à l'automne 1951, ou au pLus tard au commencement de l'hi~er 1951-1952. , Moir:s fermes, en. re~anche, sont les repères qui d~terrn_ment les P.r?~wrs mor:zents de l'entreprise. La redactwn du trms~eme clwp~tre - dont l'objet est de comparer le langage pictural et le langage littéraire- ne put être commencée a~ant la publication du dernier ~olume de la Psychologie de l'art, soit a~ant juil· let 1950 : les références à La monnaie de l'absolu ne laissent pas de doute sur ce point. A considérer le tra~ail e.ffectué sur l' ou~rage d'André Malraux, dont nous a~ons retrou~é la trace dans un long résumé- commentaire, uploads/Litterature/ la-prose-du-monde 1 .pdf
Documents similaires





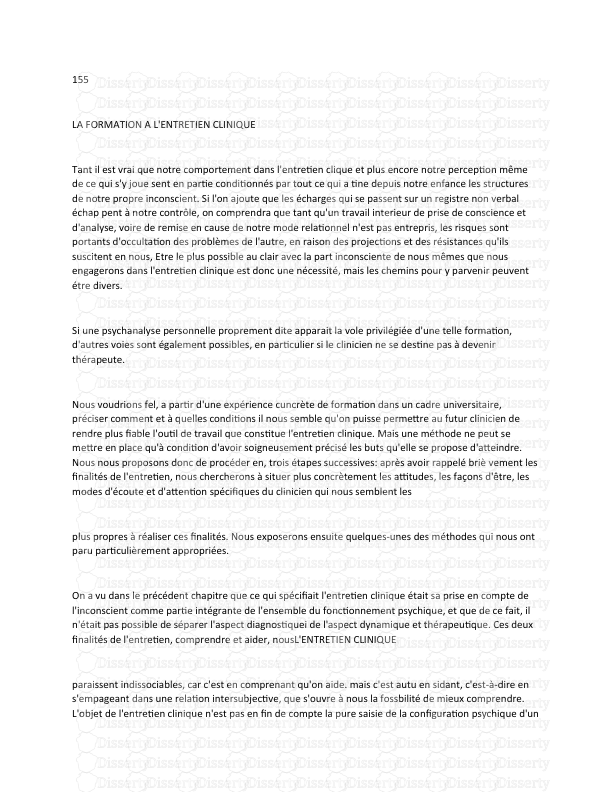




-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 31, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 13.0385MB


