CHARLES MOPSIK LES GRANDS TEXTES DE LA CABALE o - LES RITES QUI FONT DIEU wy oa
CHARLES MOPSIK LES GRANDS TEXTES DE LA CABALE o - LES RITES QUI FONT DIEU wy oa eee | Go gle LES GRANDS TEXTES DE LA CABALE LES RITES QUI FONT DIEU EDITIONS VERDIER 11220 LAGRASSE Google DU MEME AUTEUR Aux Eprmons VERDIER Le Zohar Traduction et commentaires, trois volumes sur la Genése : 1981, 1984, 1991, et Le Livre de Ruth, 1987. Moise Cordovéro. Le Palmier de Débora Traduction et commentaires, 1985. Lettre sur la sainteté Le secret de la relation entre l'homme et la femme dans la cabale Traduction et commentaires, 1986. Le Livre hébren d’Hénoch Traduction et commentaires, 1989. L’Ecclésiaste et son double araméen Traduction et commentaires, 1990. Aux EDITIONS JACQUES GRANCHER La Cabale Collection « Ouverture », 1988. COLLECTION « LES Dix PAROLES » PUBLIFE SOUS LES AUSPICES DE L’ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE Google . _ CHARLES MOPSIK LES GRANDS TEXTES DE LA CABALE LES RITES QUI FONT DIEU Pratiques religienses et efficacité théurgique dans la cabale des origines an milien du Xvir siecle Collection « Les Dix Paroles » ve INDIANS UNIVERSITY VERDIER B. edgiwe (ON Google PUBLIE AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DES LETTRES Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’opération de recherche intitulée « Exégéses et systémes de pensée dans le judaisme, de la destruction du Temple a Emancipation », entreprise par une équipe attachée au Centre d’Etudes des Religions du Livre (URA 152), qui dépend du CNRS et de PEPHE, 5° section. Au sein de cette équipe, je suis particulitrement redevable 4 Cyrille Aslanoff, AMN & luniversité de Lille, qui a collaboré a !’élaboration de cet ouvrage en me faisant profiter de ses vastes connaissances de l’histoire de !a langue grecque. Je ne saurais dire assez tout ce que je dois aux séminaires de recherche de Monsieur Michel Tardieu auxquels j’ai assisté 4 I’Ecole Pratique des Hautes Etudes puis au Collége de France. Son enseignement consacré au néoplatonisme tardif, 4 la théurgie chaldaique et plus généralement a la pensée paienne et au syncrétisme de la fin de l’Antiquité a joué un rdle décisif dans l’orientation de mes recherches. II m’est un devoir agréable de lui exprimer ici ma profonde gratitude. © Editions Verdier, 1993. ISBN : 2-86432-161-0 ISSN : 0243-0541 Google AVANT-PROPOS La confusion des mots entraine la confusion des idées ; la confusion des idées entraine le mensonge et la malversation. ConFUCIUS La religion juive s'est perpétuée par des pratiques concrétes plutét qu’au moyen d’une doctrine religieuse établie. Cette prééminence so- Giale des rites sur les représentations, sans cesse réaffirmée, n’entrava nullement, comme un cliché largement répandu le laisse croire, des élaborations intellectuelles nombreuses, fécondes et d’une ample por- tée historique. Si les systémes de pensée qui se formérent a partir d’elles ne se fixérent jamais sous la forme de doctrines théologiques telles qu’on les rencontre dans le christianisme et I’islam, c'est peut- étre parce que ces systémes devaient nécessairement accorder une place essentielle aux pratiques religieuses, qu’ils devaient en traiter sous peine de nullité, et cette position critique de la question des rites tendit a relativiser, de fagon quasi mécanique, toute autre considéra- tion. Mais cette relativisation des croyances par rapport aux pratiques fit de celles-ci un enjeu idéologique capital. A cdté des discussions ju- ridiques se développa un discours spirituel nourri par une réflexion ap- profondie sur les normes cultuelles. Ces derniéres furent la matiére et le ferment de spéculations riches, étendues et variées. Le domaine du rite fut un extraordinaire laboratoire d’idées. II joua un réle heuris- tique de premier plan et fut a l’origine d’une immense littérature reli- gieuse. Ceux qui tentaient de découvrir la signification des rites, étaient aussi ceux qui en avaient une expérience pratique quotidienne. Google 10 LES GRANDS TEXTES DE LA CABALE Comme ce n’était pas la foi qui sauvait mais les ceuvres, il fallait com- prendre pourquoi et comment celles-ci, et chacune d’entre elles pour sa propre part, pouvaient apporter le salut. La question préjudicielle de leur efficacité ne pouvait se poser, ou quand elle fut posée, elle dé- clencha une grave crise qui mit en péril l’équilibre de la société juive et provoqua de gigantesques polémiques '. Une fois admis le postulat de leur efficacité, il restait 4 établir sa nature et ses formes. Un travail systématique fut entrepris dans ce sens par un courant de pensée ap- pelé cabale, qui, parti du sud de la France a la fin du xr siécle et sur la base de traditions anciennes, plaga dés le début la question des commandements religieux au centre de ses préoccupations. Une im- mense littérature s’accumula au fil des siécles et porte le témoignage d'une activité intellectuelle a la fois centrée sur la signification et la fonction des rites et amenée, par la considération de ce probléme, a réviser constamment les systémes de pensée qu'elle élaborait. Question vitale pour une religion comme le judaisme, la nature de lefficacité des observances avec ses multiples champs d’application trouva dans les développements de la cabale des réponses qui n’étaient plus seulement ponctuelles, mais participaient de plein droit a une structure doctrinale qui concevait les pratiques religieuses comme une partie essentielle de sa propre substance et non comme de simples appendices offrant quelques débouchés concrets a ses spé- culations. Composantes structurelles et structurantes d’un discours spirituel qui se voulait total et s’identifiait avec 1a religion juive dans tous ses aspects, les « raisons des commandements » concernaient aussi bien l’eschatologie céleste de l’Ame, ses migrations terrestres, limitation de Dieu et des symboles divins, l’union de l’individu et de la société a la divinité, l’exaucement des priéres, le respect des lois de la création et de l’ordre cosmique, la sauvegarde de la forme humaine créée a |’image de Dieu et sa reproduction a travers les générations, la protection contre les forces du mal et leur élimination, et enfin et surtout I’action sur la divinité méme. 1. Je fais allusion aux polémiques déclenchées dans le sud de la France et en Espagne par la publication de l’ouvrage philosophique de Matmonide, Le Guide des Egarés. Google AVANT-PROPOS 11 Bien que notre intention premiére fOt de traiter l'ensemble de ces sujets, il nous apparut trés vite que leur étude exigerait plusieurs vo- lumes. Nous décidAmes de nous orienter vers une analyse approfondie du dernier theme évoqué, qui a la propriété de toucher tous les autres et qui met sans doute le mieux en valeur le caractére décisif des ré- flexions sur les pratiques religieuses pour la construction des systémes du monde et de Dieu chez beaucoup de cabalistes. A travers l’effi- cience des observances religieuses sur le monde divin, celui-ci n’appa- rait plus comme une structure figée, mais comme un syst¢me relationnel interactif dont le dynamisme est réglé par les actes des hommes. Cet ouvrage est la premiére monographie entitrement consacrée a l'étude de cette composante singuliére de la religion juive : la croyance dans le pouvoir d’action sur Dieu des ceuvres humaines. Encore n’y étudiera-t-on que quelques-uns de ses aspects. La généa- logie de cette conception, de ses représentations, des exégéses sur les- quelles elle s’appuie et des discours qui la systématisent, est un chapitre important de l’histoire de la pensée juive. Longtemps délais- sée par les modernes a cause de son caractére théologiquement scan- daleux et irrationnel, cette croyance fut rejetée dans le domaine ténébreux de la magie et du mythe, quand elle ne fut pas mise sur le compte d’une dérive paganisante. Ignorée ou sous-estimée par ceux qui ont écrit l'histoire du judaisme, elle apparait de plus en plus comme un élément majeur du discours que ses principaux respon- sables et autorités spirituelles ont tenu pour expliquer, justifier et va- loriser ses nombreuses pratiques. Si c’est la cabale médiévale qui donne pour la premiére fois 4 cette croyance une solide assise concep- tuelle, elle est déja présente dans la Bible hébraique, la littérature rab- binique et divers écrits qui évoluent dans sa mouvance. A plusieurs égards, cette conception présente des similitudes avec la théurgie néoplatonicienne de I’ Antiquité finissante. Aussi a- t-on pris ’habitude d’utiliser le terme de théurgie pour la désigner. On connait le jugement trés sévére que Kant portait 4 son endroit : « La théurgie est cette folie mystique qui se figure avoir le sentiment d’étres supra-sensibles et de pouvoir agir sur eux ?. » Mais depuis, 2. Critique du Jugement, Vrin, Paris, 1952, p. 252. Google 12 LES GRANDS TEXTES DE LA CABALE plusieurs travaux importants ont montré lintérét de la théurgie pour les études concernant la pensée des derniers philosophes paiens, les premiéres réflexions philosophiques sur les sacrements chrétiens, et le gnosticisme. L’intérét de la théurgie antique est éga- lement grand pour l’investigation des courants du judaisme que nous qualifierons, pour une raison que nous allons expliquer, de mystagogiques. Nous avons voulu écrire quelques chapitres de I’his- toire de ce qui deviendra une doctrine professée par les plus hautes autorités rabbiniques. Jusqu’a la fin du xvu* siécle, et dans cer- taines contrées jusqu’a la fin du x1x* siécle voire jusqu’au milieu du xx*, la croyance uploads/Litterature/ les-grands-textes-de-la-cabale-charles-mopsik.pdf
Documents similaires




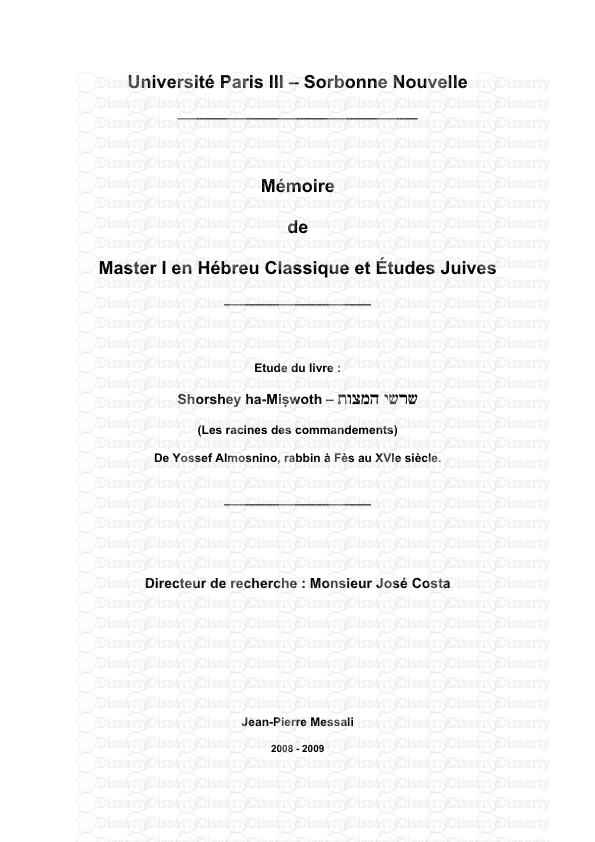





-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 77.2200MB


