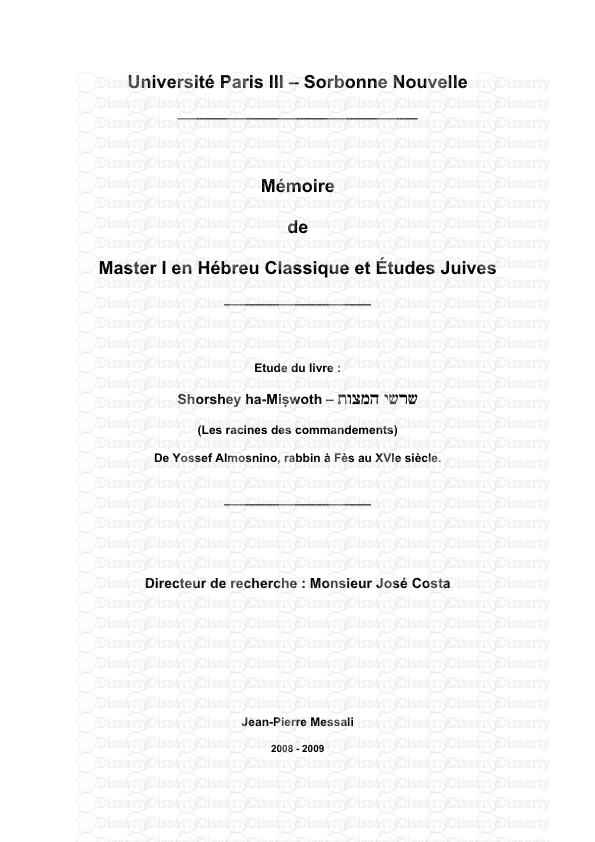Université Paris III – Sorbonne Nouvelle ____________________________________ M
Université Paris III – Sorbonne Nouvelle ____________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives ______________________ Etude du livre : Shorshey ha-MisҖwoth – ĭĘĩġė ĜĬīĬ (Les racines des commandements) De Yossef Almosnino, rabbin à Fès au XVIe siècle. ______________________ Directeur de recherche : Monsieur José Costa Jean-Pierre Messali 2008 - 2009 ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page I Table des Matières REMARQUES METHODOLOGIQUES III INTRODUCTION 1 1 – YOSSEF ALMOSNINO. 2 1.1 – La communauté juive de Fès au XVIe siècle. 2 1.1.1 – Le statut des juifs en d'Islam : la Dhimma. 2 1.2.2 – Les Toshavim ou juifs autochtones. 3 1.2.3 - Les Megorashim ou Expulsés (d'Espagne). 4 1.2 – Abraham Almosnino, père de l'auteur. 6 1.3 - L'auteur : Yossef Almosnino. 7 2 - LE DECOMPTE DES MIS̪WOTH. 8 2.1 – La tradition des six cent treize mis̪woth. 8 2.2 – Les débats sur le décompte des mis̪woth. 10 2.3 – Quelques ouvrages sur les six cent treize mis̪woth. 13 3 - L'OUVRAGE : LES RACINES DES MIS̪WOTH. 16 3.1 – Présentation de l'ouvrage par l'auteur. 16 3.2 – Enoncé et argumentation des règles de décompte selon Yossef Almosnino. 18 3.2.1 - Les règles proches de celles de Maïmonide. 18 3.2.1.1 – Première racine. 18 3.2.1.2 – Deuxième racine. 20 3.2.1.3 – Troisième racine. 21 3.2.1.4 – Sixième racine. 22 3.2.1.5 – Huitième racine. 25 3.2.1.6 – Neuvième racine. 26 3.2.1.7 – Onzième racine. 29 3.2.1.8 – Douzième racine. 32 3.2.1.9 – Treizième racine. 33 3.2.2 - Les règles originales. 35 3.2.2.1 – Quatrième racine. 35 3.2.2.2 – Cinquième racine. 36 3.2.2.3 – Septième racine. 37 3.2.2.4 – Dixième racine. 39 3.3 – Conclusion de l'auteur. 41 ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page II CONCLUSION 43 ANNEXES 45 Annexe 1 : Couverture du livre. 45 Annexe 2 : Les 13 racines de Yossef Almosnino (hébreu). 46 Annexe 3 : Les 13 racines de Yossef Almosnino (traduction). 48 Annexe 4 : Les 14 racines de Maïmonide (hébreu). 50 Annexe 5 : Les 14 racines de Maïmonide (traduction). 51 Annexe 6 : Tableau comparatif des racines. 53 BIBLIOGRAPHIE 56 I - Sources juives 56 I.1 – Ecrits de l'antiquité 56 I.2 – Ecrits rabbiniques 56 I.3 – Ecrits post-rabbiniques 56 II - Sources non juives 57 III - Etudes 57 III.1 – Les penseurs juifs, de l'époque talmudique au Moyen Age 57 III.2 – Les juifs d'Espagne 58 III.3 – Les juifs du Maroc 58 III.4 – Autres études. 59 INDEX DES CITATIONS 60 INDEX DES NOMS 62 ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page III Remarques méthodologiques Transcription. Concernant l’hébreu, nous avons adopté les conventions de l’ouvrage de Madame Mireille Hadas-Lebel, L’Hébreu, 3000 ans d’histoire1. Ainsi les correspondances suivantes seront utilisées : • le bet sans daguesh sera rendu par v. • le khaf par kh. • le shin par sh. • le tsadé par ٿ. • le فet par ف. • le 'ayin par ' et le `alef par `. • le qof par q et le kaf par k. • le pé sans daguesh par f. • u rendra le son français ou. Les mots hébreux sont transcrits en italique, ainsi que les quelques mots en arabe. Pour les noms propres, nous avons repris soit les orthographes les plus communément admises, soit celles de la Bible du Rabbinat, soit celles adoptées dans les documents sources. Citations. Toutes les citations de versets bibliques (en italique) sont faites, par souci d'homogénéité, dans la traduction du Grand Rabbinat (même si celle-ci n'est pas toujours satisfaisante). Quelques rares citations sont reproduites en hébreu, avec transcription. Traduction et vocabulaire. Le texte, en hébreu rabbinique, pose les problèmes habituels de traduction : phrases très longues et sans ponctuation, parsemées de nombreuses abréviations. La difficulté est de restituer les idées de l'auteur, dans un langage intelligible, sans le trahir ni perdre le fil du raisonnement. 1 Editions Verdier, Paris 1992. ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page IV Pour cela, nous nous sommes efforcés de faire une traduction la plus littérale possible, mais en adaptant, autant que possible, les tournures inhabituelles et en supprimant parfois des passages, pour éviter les redondances. Nous avons aussi supprimé presque toutes les abréviations traditionnelles dans ce genre d'écrit ("sa mémoire est bénie" ou "que son souvenir vive dans le monde futur", etc.). Les termes mis̪wah ou mis̪woth ont été soit gardés en hébreu (en transcription), soit traduits par commandement(s), et les uns ou les autres sont employés indifféremment, pour éviter des répétitions qui pourraient lasser le lecteur. Pour la même raison, les termes "racine" et "règle" seront considérés comme synonymes. Pour les mots hébreux qui ne doivent pas être traduits par "commandements", nous avons utilisé plusieurs équivalents : ordre, prescription, interdiction, injonction, impératif, obligation, etc. ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page 1 Introduction Faisant des recherches sur les origines de la branche maternelle de ma famille, la branche Almosnino, j'ai pu consulter à la Bibliothèque Nationale, l'ouvrage de Yossef Almosnino, Les racines de commandements (Shorshey ha-Mis̪woth) et en obtenir une copie. Il s'agit d'un petit opuscule d'une vingtaine de pages environ, en hébreu, qui entend donner les moyens de détecter, dans la Torah, les commandements qui s'imposent au peuple juif en respectant le nombre de six cent treize. De nombreux auteurs juifs sont restés méconnus pendant des siècles, car leurs manuscrits n'ont pas été imprimés et ont été perdus pour la plupart. Si on en connaît l'existence, c'est le plus souvent grâce à une citation faite par un auteur qui a eu la chance de pouvoir être imprimé ou dont les manuscrits ont été retrouvés. Le but de cette étude, en accord avec le directeur de recherche, Monsieur José Costa, est de faire connaître un auteur juif du XVIe siècle qui a marché sur les traces de son illustre prédécesseur à Fès, Maïmonide2, et d'étudier son ouvrage. Ce mémoire comporte trois parties : La première partie est consacrée à l'auteur, resitué dans son contexte géopolitique et familial, avec les trop rares éléments biographiques qui ont pu être rassemblés sur son père et sur lui-même. La deuxième partie évoque le décompte des mis̪woth pour permettre une meilleure compréhension de l'ouvrage. La troisième partie, la plus importante, accordera la plus grande place à la traduction des règles classées en deux catégories et assorties d'un bref commentaire. 2 Rabbi Moshe ben Maïmon (1138 - 1204) ou RaMBaM (acronyme pour les juifs, ou Maïmonide). Voir aussi : Dienstag Jacob I., "Maïmonides", Encyclopedia Judaica 1971, tome 11 col 754-781. ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page 2 1 – Yossef Almosnino. Avant de parler de l'auteur, il faut rappeler le contexte social, politique et culturel dans lequel il vivait, donc décrire la communauté juive de Fès et son histoire. Pour cela, après avoir défini la condition des juifs en terre d'Islam, nous ferons un bref rappel de l'histoire de l'installation et de l'existence des juifs au Maroc, et plus particulièrement à Fès, puis une description la communauté juive de Fès au XVIe siècle, avant d'évoquer la vie de l'auteur et de sa famille, pour lesquels, malheureusement, les renseignements sont extrêmement rares. 1.1 – La communauté juive de Fès au XVIe siècle. 1.1.1 – Le statut des juifs en d'Islam : la Dhimma. La Dhimma3 est une sorte de traité dont le respect s'impose aussi aux musulmans, c'est une charte discriminatoire des minorités qui établit une distinction nette entre l'honneur dû aux musulmans et les religions "tolérées". Le statut des dhimmis, institué au VIIe siècle par le décret d’Omar4, deuxième Calife de l'Islam, définit la "protection" assurée aux "Gens du Livre" que sont les monothéistes, chrétiens et juifs. L'Islam reconnaît la légitimité des autres religions du Livre et accepte de cohabiter avec elles (sans préconiser la conversion forcée) à condition de leur imposer sa domination au moyen de la discrimination, du mépris et de l'humiliation. Ainsi, contre un impôt individuel ou jizya, chrétiens, juifs, samaritains, et sabéens (mais aussi, en Orient, zoroastriens et en Inde, les hindous) d'un état musulman peuvent exercer leur religion. Les dhimmis ne sont pas (en principe) persécutés, comme l'ont été les juifs dans l'Espagne chrétienne par exemple, mais ils doivent percevoir leur situation comme 3 Chehata C., "Dhimma", Encyclopédie de l'Islam 1977, Tome 2, p 234-238. Voir aussi, Chouraqui A., La condition de l’Israélite marocain, Paris, 1950. 4 Ce décret est fondé sur le verset 29 de la sourate 9 (At-Tawba ou Bara'a, Revenir [de l'erreur] ou [l'] Immunité : "Combattez ceux qui ne croient point en Allah […] jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, directement et alors qu'ils sont humiliés.".(extrait de Le Coran, traduit de l'arabe par Régis Blachère, Paris, 1966). ___________________________________________________________________ Mémoire de Master I en Hébreu Classique et Études Juives Page 3 humiliante, en particulier au moment du paiement de la jizya, sans pour autant être soumis à des sévices uploads/Litterature/ les-racines-des-commandements-pdf.pdf
Documents similaires










-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 09, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6373MB