Représentations sociales de l’identité sourde La Surdité chez les parents franc
Représentations sociales de l’identité sourde La Surdité chez les parents franco- ontariens ayant un enfant malentendant : RESO, Centre Leger – étude de cas Mémoire de maîtrise, École de Service social, Université d’Ottawa, 2015 Gabriel Marin Table de matière Introduction : question de départ .................................................................................................... 4 Précaution nécessaire : le positionnement de l’auteur ................................................................ 5 Problématique ................................................................................................................................. 6 Mise en contexte de la problématique ............................................................................................ 6 Les objectifs de la recherche ......................................................................................................... 10 Cadre théorique ............................................................................................................................. 11 La théorie des Représentations sociales .................................................................................... 11 Pour un modèle social d’interprétation du handicap et de l’identité sourde aujourd’hui ......... 15 Les politiques de la Surdité : entre deux mondes, culture des Sourdes et norme médicale de la société ........................................................................................................................................ 17 Que veut dire représentations sociales sur l’« espace d’engagement »? ................................... 18 Le contexte minoritaire francophone et la surdité : familles, services et la langue de langue de signes ......................................................................................................................................... 19 Méthodologie ................................................................................................................................ 21 Approche et type de recherche .................................................................................................. 21 Échantillonnage ......................................................................................................................... 22 Recrutement .............................................................................................................................. 22 Collecte de données ................................................................................................................... 23 Analyse des données ................................................................................................................. 23 Limites ou plutôt au-delà les limites de la stratégie de recherche ............................................. 24 L’apport de connaissance .............................................................................................................. 27 Les résultats de la recherche...................................................................................................... 27 Que veut dire « communauté » et « communauté sourde » aujourd’hui? .................................... 27 L’apparition des institutions et politiques sociales du monde du handicap .............................. 31 Le discours des politiques de la Surdité : entre deux mondes, culture des Sourdes ou norme médicale? ................................................................................................................................... 32 Le contexte minoritaire francophone et la surdité : familles, services et la langue de langue de signes ......................................................................................................................................... 46 Libéralisme, invalidité et eugénisme social; politiques matière des Sourdes francophones en Ontario .......................................................................................................................................... 56 « Briser le silence entourant le monde des Sourds ». Comment on y est arrivé ici? ................ 58 La vie associative et la communauté Sourde ............................................................................ 59 « Bons » et « mauvais » usages des droits culturels sourdes ........................................................ 61 « Briser le silence entourant le monde des Sourds » .................. Error! Bookmark not defined. La vie associative et la communauté Sourde ............................. Error! Bookmark not defined. RESO - Rassemblement des parents francophones................................................................... 68 Conclusion .................................................................................................................................... 90 Bibliographie................................................................................................................................. 92 Annexe 1 - Canevas d’entrevue semi-dirigée pour les parents. .................................................... 98 Annexe 2 – Fiche représentations sociales ................................................................................. 101 Annexe 3 - Cahier de codage - NVivo ........................................................................................ 104 Annexe 4 – ANNONCE DE RECRUTEMENT ......................................................................... 107 Annexe 5 – Graphiques sur les ramifications sémiotique de la représentations sociale à travers une entrevue d’un parent ayant un enfant sourd: cas de figure .................................................. 108 « Votre passivité ne sert qu'à vous ranger parmi les oppresseurs » (Sartre, 1961). « On n’est pas mesuré de la tête aux pieds, mais de la tête au cœur » Enseignant Centre Léger – École francophones des Sourdes. Introduction : question de départ Ce mémoire s’interroge sur les représentations sociales (S. Moscovici, 1961) de l’identité sourde chez les parents franco-ontariens ayant un ou plusieurs enfants malentendants, et déployées au carrefour des engagements institutionnels (services publics, santé, école) et des échanges informels (familles, amis, réseaux virtuelles informelles de support, fratrie etc.). Mon étude s’insère dans un projet plus large réunissant les démarches comparatives interdisciplinaires d’une équipe de chercheurs en provenance des plusieurs pays francophones, Canada, France, Belgique et Suisse et mené principalement, par Charles Gaucher (chercheur principal, Université de Moncton)auquel s’ajoute aussi Lilian Negura (cochercheur, Université d’Ottawa), le directeur de recherche de ce mémoire de maîtrise, et d’autres chercheures et chercheuses des domaines scientifiques divers (anthropologie, sociologie, psychologie, science de la santé, linguistique). Ma recherche n’est qu’un « chapitre » (de la topographie sémantique de la culture sourde1 francophone, menant la situation minoritaire des francophones d’Ontario en perspective comparative) et qui s’insère dans les travaux d’un grand chantier de nature empirico-inductive ayant lui-même la question de départ comme suit: « Comment les parents francophones du Canada, de la France et de la Belgique négocient-ils un espace d’engagement avec les acteurs impliqués dans les services offerts à leurs enfants ayant des incapacités? ». Ce projet de recherche international se propose d’explorer« l’espace d’engagement dans les services investis par les parents francophones d’enfants ayant des incapacités auditives. Il a pour objectif de 1) décrire l’expérience de parents qui reçoivent des services pour soutenir l’inclusion de leur enfants vivant avec une surdité; 2) comprendre les facteurs qui facilitent l’engagement des parents dans les services que reçoivent leur enfant; 3) identifier les acteurs et leurs pratiques qui sont les plus susceptibles de créer un espace d’engagement respectueux du désir des parents de s’investir dans le processus d’inclusion sociale de leur enfant. 1 Nous distinguons ici la « culture sourde » comme une culture identitaire à part et, pour le dire de manière simple, il s’agit d’une culture qui est (com-)prise au même dégrée comme toute culture « ethnique »; on envisage ici la manière endogène dont les Sourds disposent pour se représenter socialement. Précaution nécessaire : le positionnement de l’auteur L’intérêt personnel et professionnel pour ce sujet découle justement de mon passé familial en Roumanie (j’ai grandi et j’ai dû m’adapter à vivre et communiquer avec mon grand-père qui a perdu son ouïe à Stalingrad, et suite aux tortures des prisons stalinistes) et de mon présent social et professionnel; une telle thématique me semble riche par son volet comparatif et surtout « exploratoire » pour un chercheur qui s’insère dans des postures identitaires qui témoignent eux- mêmes les contextes de production de son écriture2. Je suis un immigrant d’origine roumaine ayant récemment quitté et retourné au Canada (2013);depuis 1996, je vis à l’extérieur de mon pays (en Russie, Hongrie, France, Canada, États-Unis) ayant dû m’adapter à plusieurs milieux culturels et professionnels3. Un tel dévoilement – exposé ici à titre d’appropriation « théorique » - pourrait paraitre « étrange »; cette étrangeté (« anthropologique », « ethnographique », mais pas « culturelle »), par rapport à l’univers social de la francophonie « sourde » au Canada me semble, en effet, un atout. Bien que je ne sois pas « Sourd », bien que je n’aie pas une expérience « canadienne » d’intervention auprès les « Sourdes », j’approprie le sens de la culture sourde par l’empreinte de ma culture « ethnique » ou « migrante » ainsi que par une carrière « scientifique » qui commence en 1992 4 .Tel est aussi la « logique sociétale » dont plusieurs auteurs (Fougeyrollas, Saillant, Gaucher, Lachance) placent la condition des Sourdes : « une dyade » complexe où la construction de la surdité suit, dans sa composition, la « réalité ethnique et culturelle ». (Gaucher, 2005 :167). C’est pourquoi les catégories administratives (aussi des « sémantiques sociales » de notre temps ou des « filtres classificateurs », M. Douglas, 1971) ne sont parfois que des trompes œil face aux réalités complexes5et au vécu de l’individu ; c’est pourquoi, un tel positionnement stratégique que celui de l’auteur, le place dans « des passages d’entre cultures » (W. Benjamin, 1939) – lui facilitant, je pense, la compréhension de la lecture identitaire sourde. 2 Dominick LaCapra and Steven L. Kaplan, Modern European Intellectual History Reappraisals and new perspectives, Cornell University Press, 1982. (Aussi Ma) 3 Père-divorcé, avoir quitté et retourné au Canada pour pouvoir vivre à côté de mon enfant, j’ai dû embrasser plusieurs conditions et expériences, professions et passages humains à travers plusieurs pays. J’ai déjà obtenu deux maîtrises en histoire des mentalités, un doctorat et deux post-doctorats qui touchent le domaine de la construction identitaire au temps de l’éducation totalitaire (Mémoire, histoire et crise identitaire à la sortie du communisme. Le cas des manuels scolaires en Roumanie de Ceausescu, thèse de doctorat à l’Université Laval, Québec : 2004) et au sein des communautés immigrantes et minoritaires (Mémoires des chauffeurs de camion au Canada et aux États- Unis : franco-ontariens et est-européens (recherche postdoctorale FQRSC, Carleton University : 2005-2007). À partir des démarches d’histoire culturelle, nous nous sommes intéressé à l’apport de la mémoire (individuelle, collective, historique) dans la construction d’une dyade identitaire « ethnicité-profession », ainsi que aux dynamiques de précarisation et d’exclusion contemporaine, mais qui trouvent ses « déterminants » dans un passé qui « hante » souvent notre présent. Mon défi aujourd’hui est de m’insérer socialement et de construire une nouvelle identité professionnelle celle d’intervenant social, un enjeu qui suppose l’emprise d’un nouveau rôle social (institutionnel et existentiel) celui d’aider par ma voix, d’autres « sans voix ». 4De ce point de vue, je me considère « un chercheur itinérant », qui conçoit le travail scientifique à la fois comme une espèce littéraire (une égo-histoire, mais aussi une « biographie » au sens de Bourdieu), mais aussi une production validée par l’institution (universitaire, occidentale); voir Jeffery, D. (2005), « Le chercheur itinérant, son éthique de la rencontre et les critères de validation de sa production scientifique », Recherches qualitatives, Hors- série, no. 1, pp. 115-127. 5 Je m’aligne aussi au sens employé par Edgar Morin (rappelé par Marguerite Soulière dans son cours SVS6500, automne 2015) : complexus là où l’individuel et singulier sont tissés ensemble, uploads/Litterature/ memoire-maitrise-surdite-190816.pdf
Documents similaires


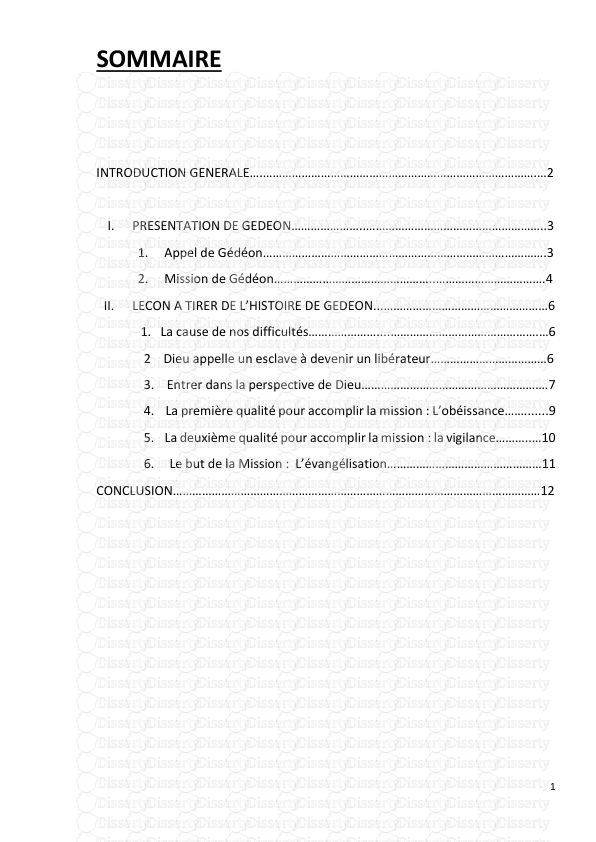







-
113
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 5.2671MB


