Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, traduit du russe par Daria Ol
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, traduit du russe par Daria Olivier Le plurilinguisme dans le roman Les formes compositionnelles d’introduction et d’organisation du plurilinguisme dans le roman, formes élaborées au cours du développement historique du genre romanesque sous ses divers aspects, sont fort variées. Chacune d’elles, rapportée à des possibilités stylistiques précises, exige une juste élaboration littéraire des différents « langages ». Nous ne nous arrêterons ici que sur les formes fondamentales et typiques pour la plupart des variantes du roman. Le plurilinguisme s’est organisé sous sa forme la plus évidente, et en même temps la plus importante historiquement, dans ce qu’on a nommé le roman humoristique. Ses représentants classiques sont Fielding, Smollett, Sterne, Dickens, Thackeray en Angleterre, Hippel1 et Jean- Paul Richter en Allemagne. Dans le roman humoristique anglais, nous trouvons une évocation parodique de presque toutes les couches du langage littéraire parlé et écrit de son temps. Il n’y a guère un seul roman de ces auteurs classiques qui ne constitue une encyclopédie de toutes les veines et formes du langage littéraire. Selon l’objet représenté, le récit évoque parodiquement, tantôt l’éloquence parlementaire ou juridique, tantôt la forme particulière des comptes rendus des séances du Parlement et leurs procès-verbaux, les reportages des gazettes, des journaux, le vocabulaire aride des hommes d’affaires de la City, les commérages des pécores, les pédantes élucubrations des savants, le noble style épique ou biblique, le ton bigot du prêche moralisateur, enfin la manière de parler de tel personnage concrètement et socialement défini. Cette stylisation, habituellement parodique, du langage propre aux genres, aux professions et autres strates du langage est parfois coupée par un discours direct de l’auteur (généralement pathétique, sentimental, ou idyllique), qui traduit directement (sans réfraction) sa vision du monde et ses jugements de valeur. Mais le fondement du roman humoristique, c’est le mode tout à fait spécifique du recours au « langage commun ». Celui-ci, communément parlé et écrit par la moyenne des gens d’un certain milieu, est traité par l’auteur comme l’opinion publique, l’attitude verbale normale d’un certain milieu social à l’égard des êtres et des choses, le point de vue et le jugement courants. L’auteur s’écarte plus ou moins de ce langage, il l’objectivise en se plaçant en dehors, en réfractant ses intentions au travers de l’opinion publique (toujours superficielle, et souvent hypocrite), incarnée dans son langage. Cette relation de l’auteur au langage pris comme « opinion publique » n’est pas immuable; elle connaît continuellement un état mouvementé et vif, une oscillation parfois rythmique : l’auteur peut exagérer parodiquement, plus ou moins vigoureusement, tels ou tels traits du « langage courant », ou révéler brutalement son inadéquation à son objet. Parfois, au contraire, il se solidarise presque avec lui, s’en éloigne à peine, et quelquefois y fait même résonner directement sa « vérité », autrement dit, confond totalement sa voix avec lui. En même temps, les éléments du langage courant, parodiquement outrés ou légèrement objectivés, se modifient de façon logique. Le style humoristique exige ce mouvement de va-et-vient entre l’auteur et son langage, cette continuelle modification des distances, ces passages successifs entre l’ombre et la lumière tantôt de tel aspect du langage, tantôt de tel autre. S’il n’en était pas ainsi, le style serait monotone ou exigerait une individualisation du narrateur, c’est-à-dire une tout autre manière d’introduire et d’organiser le « plurilinguisme ». C’est de ce fond initial du langage courant, de l’opinion générale, anonyme, que se dégagent, dans le roman humoristique, ces stylisations parodiques des langages propres à un genre, à 1 Hippel, Theodor-Gottlieb von (1743-1796), romancier allemand que l’on peut situer entre Sterne et Jean-Paul. une profession, etc., dont nous avons parlé, ainsi que les masses compactes du discours direct, pathétique, moral et didactique, sentimental, élégiaque, ou idyllique, de l’auteur. Ce discours se réalise ainsi dans les stylisations directes, inconditionnelles, des genres poétiques (idylliques, élégiaques) ou rhétoriques (pathos, morale didactique). Les transitions du langage courant à la parodisation des langages des genres et autres, et au discours direct de l’auteur, peuvent être plus ou moins progressives ou, au contraire, brusques. Tel est le système du langage dans le roman humoristique. Rabelais, qui exerça une influence immense sur toute la prose romanesque, et surtout sur le roman humoristique, traite parodiquement presque toutes les formes du discours idéologique (philosophique, éthique, savant, rhétorique, poétique), et surtout ses formes pathétiques (pour lui, pathos et mensonge sont presque toujours équivalents); et il va jusqu’à parodier la pensée linguistique. Raillant la menteuse parole humaine, il détruit, en les parodiant, (entre autres) certaines structures syntaxiques, en réduisant à l’absurde certains de leurs éléments logiques, expressifs et appuyés, (par exemple les prédications, les gloses, etc.). La prose de Rabelais atteint presque à sa plus grande pureté quand il prend ses distances avec la langue, (par ses méthodes propres) discrédite ce qui est directement et franchement « voulu » et expressif (le sérieux « pompeux ») dans le discours idéologique, qu’il tient pour conventionnel et faux, pour une réalité fabriquée et inadéquate. Mais la vérité confrontée au mensonge n’est ici dotée quasiment d’aucune expression verbale directe intentionnelle, d’aucun mot propre; elle ne trouve sa résonance que dans la révélation parodiquement accentuée du mensonge. La vérité est rétablie par la réduction à l’absurde du mensonge, mais elle-même ne cherche pas ses mots craignant de s’y empêtrer, de s’embourber dans le pathétique verbal. - Pour marquer l’énorme influence de la « philosophie du discours » de Rabelais sur la prose romanesque postérieure, et principalement sur les grands modèles du roman humoristique (« philosophie » exprimée non pas tant dans les énoncés directs, que dans la pratique de son style verbal), il faut citer la confession purement rabelaisienne du Yorick, de Sterne, qui peut servir d’épigraphe à l’histoire de la ligne stylistique la plus importante du roman européen : ... Je me demande même si sa malheureuse tendance à l’humour n’était pas en partie à l’origine de tels fracas *, car en vérité Yorick nourrissait un dégoût insurmontable et congénital pour le sérieux; non point le sérieux véritable qui connaît son prix : quand celui-là lui était nécessaire, il devenait le plus sérieux homme au monde, pendant des jours, et même des semaines; mais il s’agit du sérieux affecté, qui sert à dissimule ’’ignorance et la sottise et avec celui-là, il se trouvait toujours en guerre ouverte et ne lui faisait pas grâce, si bien protégé et défendu fût-il. Parfois, entraîné par quelque entretien, il affirmait que le sérieux est un vrai fainéant, et de l’espèce la plus dangereuse, de surcroît, un rusé, et il était profondément convaincu qu’en une année le sérieux avait ruiné et jeté à la rue beaucoup plus de gens honnêtes et bien- pensants, que ne l’avaient fait en sept ans tous les voleurs à la tire et pilleurs de boutiques. La bonhomie d’un cœur joyeux, aimait-il à dire, n’est un danger pour personne et ne peut guère faire de mal qu’à elle-même. Alors que l’essence même du sérieux consiste en un certain dessein, donc en une tromperie. C’est une façon avérée de se faire dans le monde la réputation d’un homme plus intelligent et savant qu’il ne l’est en réalité ; voilà pourquoi, en dépit de toutes ses prétentions, le sérieux n’a jamais été meilleur, et souvent s’est même montré pire que ne l’a défini autrefois un Français, homme d’esprit : « Le sérieux, c’est un mystérieux comportement du corps qui sert à cacher les défauts de l’esprit. » Cette définition, Yorick la commentait étourdiment et hardiment, en affirmant qu’elle était digne d’être gravée en lettres d’or 2... ★ Deux particularités caractérisent l’introduction et l’élaboration du plurilinguisme dans le roman humoristique : i° On introduit les « langues » et les perspectives littéraires et idéologiques multiformes — des genres, des professions, des groupes sociaux (langage du noble, du fermier, du marchand, du paysan), on introduit les langages orientés, familiers (commérages, bavardage mondain, parler des domestiques), et ainsi de suite. Il est vrai que c’est surtout dans les limites des langages littéraires écrits et parlés, et à ce propos il faut dire qu’ils ne sont pas rapportés à tels personnages définis (aux héros, aux narrateurs) mais introduits sous une forme anonyme « de la part de l’auteur », alternant (sans tenir compte des frontières précises) en même temps avec le discours direct de l’auteur. 2° Les langages introduits et les perspectives socio-idéologiques, tout en étant naturellement utilisés dans le but de réfracter les intentions de l’auteur, sont révélés et détruits comme étant des réalités fausses, hypocrites, intéressées, bornées, de jugement étriqué, inadéquates. Dans la plupart des cas, tous ces langages déjà constitués, officiellement reconnus, prééminents, faisant autorité, réactionnaires, sont voués à la mort et à la relève. C’est pourquoi prédominent de multiples formes et degrés de stylisation parodique des langages introduits, qui, chez les représentants les plus radicaux, les plus « rabelaisiens 3 » de cette variété de roman (Sterne et Jean-Paul) confine à une récusation de presque tout ce qui est directement et spontanément sérieux (le vrai sérieux consiste à détruire tout faux uploads/Litterature/ mikhail-bakhtine-esthetique-et-theorie-du-roman-traduit-du.pdf
Documents similaires


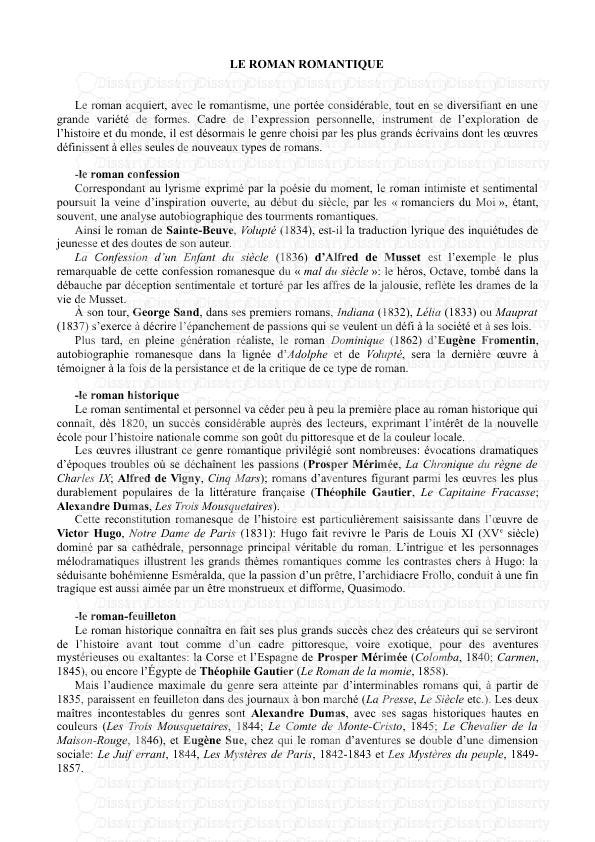







-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 22, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1485MB


