SARTRE. UNE ÉCRITURE CRITIQUE Jacques Deguy Editeur : Presses universitaires
SARTRE. UNE ÉCRITURE CRITIQUE Jacques Deguy Editeur : Presses universitaires du Septentrion Lieu d’édition : Villeneuve d'Ascq Année d’édition : 2010 Sartre contre de Gaulle : le fil de la plume p. 209-220 NOTE DE L’AUTEUR TEXTE NOTES NOTE DE L’AUTEUR « Sartre contre de Gaulle : le fil de la plume », Nord’, n° 14 (« De Gaulle écrivain/de Gaulle et les écrivains »), décembre 1989, p. 89-101. « Longtemps j’ai pris ma plume pour une épée. » Sartre, Les Mots 1 « La tribune des Temps Modernes », série de 10 émissions de Marc Floriot, France-Culture, du 14 au (...) 1France-Culture a rediffusé en août 1989 l’intégralité des émissions proposées à l’automne 1947 par l’équipe de la revue Les Temps Modernes réunie autour de son directeur Jean-Paul Sartre, une « Tribune » de libre expression qui consacrait par le médium radiophonique l’importance prise au lendemain de la guerre par le mouvement existentialiste, et qui répondait au désir de son fondateur d’« engager » philosophie et littérature dans les luttes politiques de l’époque1. 2De la lutte, il va y en avoir dès la première émission, le 27 octobre 1947, qui prend pour cible d’un tir groupé le RPF récemment formé, et qui la veille avait remporté une nette victoire au premier tour des élections municipales (près de 40 % des suffrages exprimés). Sur les ondes du « programme parisien », Sartre et ses amis, déchaînés, vont mêler à l’analyse proprement politique une série d’attaques contre la personne de de Gaulle dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles retiennent l’écoute, même après plus de quarante ans. Inventant une sorte de Tribunal des Flagrants Délires avant la lettre, ils mettent en scène un réquisitoire à plusieurs voix dont l’accusé principal, absent, se retrouve défendu… par un comédien habitué des pièces de Sartre que l’on charge de lire un texte prétendument constitué des arguments ordinaires des gaullistes et de leur chef. Le résultat de ce montage est plutôt explosif, le pseudo-gaulliste ne trouvant rien de plus pertinent par exemple que de comparer, dans un amalgame explicite, de Gaulle à Pétain : Maréchal, général, c’est tout un. Tous deux sont de l’armée, de la Grande Muette ; tous deux sont des orateurs éloquents, tous deux catholiques, tous deux ont pour principe que la souveraineté vient d’en haut, tous deux ont fait don de leur personne à la France ; tous deux haïssent ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. 2 Voir Annie Cohen-Solal, Sartre, Gallimard, 1985, p. 128. On trouvera un portrait de Bonnafé par Sar (...) 3Et ce n’est qu’un début : Alphonse Bonnafé, ancien collègue de Sartre au Havre avec lequel il s’entraînait à la boxe dans les salles de sport de la ville2 et qui avait obtenu du cabinet de Ramadier cet accès des Temps Modernes à la radio, enchaîne sur d’autres amalgames, ironisant sur les ressemblances phonétiques entre RPF et PPF. Son passé de boxeur amateur l’amène à prendre la tête du général comme punching-ball lorsqu’il évoque les affiches du RPF placardées sur les murs de Paris : Vous l’avez vu ce grand portrait du Général ? […] Ça donne un choc, je vous assure : cette petite moustache, puis ces paupières lourdes sur un regard de fer, et cette bouche, et ce cou de forcené… À part la mèche sur le front, tout y est, je vous dis, tout ! Et tout le monde le dit en passant : « Mais c’est… » [Sartre] Allons, Bonnafé, vous tenez à le dire ! [Bonnafé] Et vous, vous y tenez à m’empêcher de le dire ? 3 Voir le dernier chapitre de Qu’est-ce que la littérature ?, « Situation de l’écrivain en 1947 ». 4Le nom d’Hitler, comme celui du diable, ne sera pas prononcé. Mais Simone de Beauvoir avait cité auparavant Franco et Salazar et personne, bien sûr, ne s’y trompa. Ce coup d’essai médiatique – coup de maître dans le genre, assez rare, de la provocation, et qui illustrait le désir de Sartre d’aller vers le public, au-delà de la seule écriture, par les moyens modernes de communication3 – déchaîna le scandale. 4 Voir A. Cohen-Solal, op. cit., p. 387-388. 5 Michel Contat et Michel Rybalka, Les Écrits de Sartre, Gallimard, 1970, p. 170-171. 5Michel Contat puis Annie Cohen-Solal racontent comment les milieux gaullistes s’indignèrent de ce qu’ils ne prirent point pour le dernier canular d’un normalien célèbre. Henry Torrès et le général Guillain de Bénouville, en guise de droit de réponse, insultèrent Sartre venu débattre avec eux à la radio, en présence de Raymond Aron, médiateur choisi pour son ancienne amitié avec Sartre, sa participation à la première équipe des Temps Modernes (il n’en faisait plus partie en 1947) et son engagement gaulliste : mis dans l’impossibilité de défendre l’émission incriminée, il vit là les derniers liens se rompre avec son ancien « petit camarade », qu’il ne retrouvera à ses côtés qu’un jour de 1979 sur le perron de l’Élysée pour plaider la cause des boat-people4. Dans un article de Carrefour (29 octobre 1947) l’ancien collaborateur des Temps Modernes Albert Ollivier traita les protagonistes de l’émission de « fascistes virtuels » ; dans le même numéro, un Paul Claudel fulminant lança ce mot : « M. Sartre s’en prend au physique du général de Gaulle : est-il si satisfait du sien ? »5. La polémique ne prenait guère d’envol, et Sartre subit le sort de l’arroseur arrosé. Il multiplia les déclarations à la presse, avec un bonheur inégal : 6 Combat, 27 octobre 1947 ; cité par Contat-Rybalka, op. cit., p. 171. On aura une idée de l’affiche (...) 7 L’Ordre de Paris, 22 octobre 1947 ; cité par A. Cohen- Solal, op. cit., p. 387. On prétend que j’ai comparé de Gaulle à Hitler. C’est faux. J’ai comparé les affiches du RPF avec certaines affiches de propagande nazie6. Je n’éprouve aucune haine à l’égard de la personnalité de M. de Gaulle. Comment le pourrais-je ? Je ne le connais pas7. 6Il aurait pu argumenter sur le déroulement et la nature de l’émission, avec sa mise en ondes polyphonique et dramatisée, avec l’artifice du gaulliste fabriqué de toutes pièces ; insister surtout sur le fait que sa propre voix ne portait pas les insinuations les plus graves (Sartre s’y livrait surtout à une critique tout à fait politique de l’attitude de chantage à la guerre froide qui ressort des positions du RPF). Avec panache, il assuma au contraire, nous venons de le lire, son rôle de « directeur » des Temps Modernes et de bouc émissaire, utilisant pour répondre une première personne du singulier qui mérite réflexion. 8 Sur l’hégémonie de Sartre dans les années d’après-guerre, on lira Anna Boschetti, Sartre et « Les T (...) 9 Jean-Paul Sartre, La Nausée, in Œuvres romanesques, Pléiade, p. 110. 7Sans aucun doute, le philosophe éprouva un vif plaisir à ce scandale médiatique, qui installait l’existentialisme au cœur de la politique plus sûrement qu’un article, fût-il incendiaire, dans une revue intellectuelle à la diffusion nécessairement restreinte8. Un désir ancien d’efficacité et de violence se réalisait : Pardaillan rencontrait enfin des adversaires à sa mesure. Porté par l’euphorie du groupe réuni autour du micro, il se livrait à un éreintement public digne par son excès des meilleurs happenings surréalistes de l’avant-guerre, comme le pamphlet rédigé à la mort d’Anatole France (Un cadavre), ou le procès de Maurice Barrès organisé par Dada avec A. Breton en accusateur public en mai 1921. Roquentin rêvait déjà dans La Nausée : « J’ai fessé Maurice Barrès ». Il s’agit cette fois de démolir la figure, à tous les sens du mot, d’un grand homme. Jeu de guignol déjà inscrit lui aussi dans la scène fameuse du musée de Bouville où Roquentin se laisse fasciner par le portrait des anciens « chefs » de la cité, dont Olivier Blévigne (il « portait une petite moustache noire et son visage olivâtre ressemblait un peu à celui de Maurice Barrès »9) – avant de se ressaisir à la fin de la visite en lançant au visage de tous ces notables peints dans leur suffisance un anarchiste et retentissant « salauds ! ». Récupérée par le philosophe, l’injure deviendra dans L’Être et le Néant une catégorie conceptuelle à part entière, l’étiquette accolée à ceux en qui le personnage dévore l’authenticité de la personne. 8L’image de de Gaulle cristallise, pour le malheur de celui-ci, une série impressionnante de phobies sartriennes, repérables dans la biographie et dans l’œuvre. Phobie de l’armée : Sartre combattit dès ses années d’École normale tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la hiérarchie militaire (il refusa de se plier à la préparation militaire supérieure et mit son point d’honneur à terminer son service comme 2 e classe), à une école militaire (explication trop simple : son père et son beau-père sortaient tous deux de Polytechnique), à une revue du 14 Juillet (des manuscrits préparatoires aux Mots uploads/Litterature/ sartre-contre-de-gaulle-le-fil-de-la-plume.pdf
Documents similaires
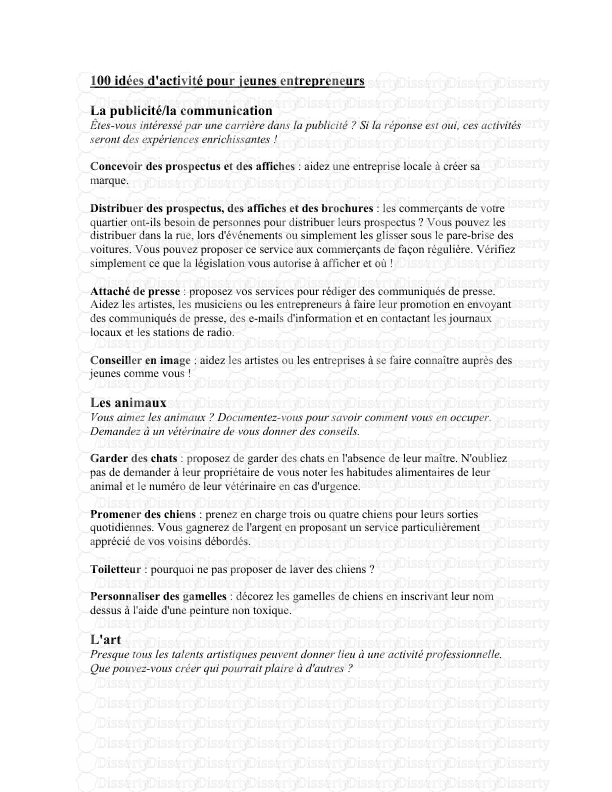




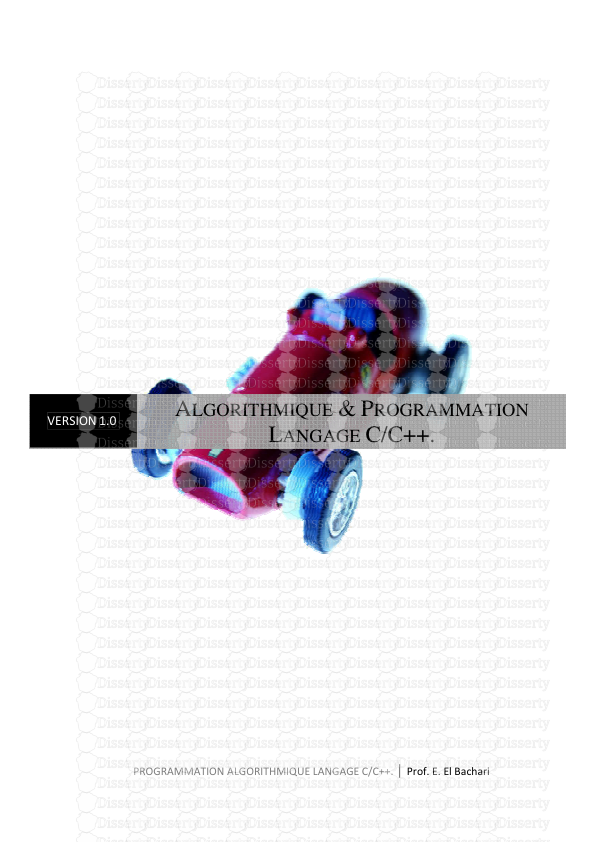




-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 16, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2092MB


