Ce livre numérique est une création originale notamment protégée par les dispos
Ce livre numérique est une création originale notamment protégée par les dispositions des lois sur le droit d’auteur. Il est identifié par un tatouage numérique permettant d’assurer sa traçabilité. La reprise du contenu de ce livre numérique ne peut intervenir que dans le cadre de courtes citations conformément à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. En cas d’utilisation contraire aux lois, sachez que vous vous exposez à des sanctions pénales et civiles. Crédits photographiques : Couverture : g Matthias Jung/LAIF-REA – m F. Maigrot/REA – d Romain Degoul/REA Direction éditoriale : Michèle Grandmangin Édition : Dominique Colombani Conception maquette et mise en pages : Alinéa Couverture : Alinéa Correction : Jean Pencreac’h © CLE international/SEJER, Paris, septembre 2006. ISBN : 978-209- 037755-2 Avant-propos « Au coin du fle » Le titre de l’avant-propos suggère une soirée paisible, passée à feuilleter l’ouvrage d’un auteur qui a connu les perturbations dues à la naissance de ce qu’on appelle le fle [fl ?]. Les pages qui suivent s’adressent aux enseignants de fle débutants, c’est-àdire à ceux qui en savent déjà beaucoup, mais qui sont parfois démunis devant un problème d’apprentissage et qui ont le souci d’intégrer une réflexion analytique aux activités pratiques qu’ils proposent en classe. Depuis la première édition de cet ouvrage, qui date de 1994, la parution, en 2001 1 du Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer 2 (CECR) – ouvrage aussitôt considéré comme majeur – est en passe de bouleverser les mentalités et les pratiques de classe. En France et dans un certain nombre d’autres pays européens 3, voire hors des frontières de l’Europe, des décisions politiques concernant la l’apprentissage des langues se font jour : réforme des programmes de langues, réforme de la composition des groupes classes, réforme des évaluations des acquis de l’apprentissage. En France, le CECR fait magistralement son apparition dans les programmes scolaires de l’école primaire, du collège et du lycée, et s’efforce, avec les moyens dont dispose le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de percer dans le domaine de la formation. La formation des enseignants, longtemps réservée au CREDIF et au BELC, a désormais une place bien reconnue dans les programmes des mentions fle des licences, de la maîtrise de fle et dans les différents masters existant au sein des universités. Cependant, même si petit à petit, le français comme langue enseignée aux étrangers commence à être abordé en formation initiale, cette discipline n’est toujours pas référencée dans les concours d’accès à l’enseignement, elle n’est donc soumise à aucun programme d’enseignement précis et se trouve en quelque sorte en zone de non droit. Le fle bénéficie ainsi depuis toujours d’un espace de liberté. Comment trouver des éléments de réponse à vos questions ? Cet ouvrage ne répondra pas à tous les problèmes que se pose un enseignant débutant tant il est vrai qu’on n’apprend à enseigner qu’en enseignant et que, selon la formule consacrée, on enseigne moins ce que l’on sait que ce que l’on est. On trouvera ici certains éléments de réponse ainsi que des indications bibliographiques qui permettront d’approfondir le travail personnel. Dans ce livre alternent des réflexions théoriques, des informations, des partis pris parfois, des pistes méthodologiques pour des pratiques de classe concrètes et des stratégies pédagogiques. La première partie présente le fle en tant qu’objet méthodologique et témoigne de la diversité des manuels d’apprentissage et des méthodologies qui se sont succédé. On y trouvera des propositions pour organiser une classe autour d’un contrat d’apprentissage qui lie étroitement les deux principaux acteurs de la formation : l’enseignant et l’apprenant. Dans la seconde partie figurent des fiches pratiques : – certaines proposent des pistes et des démarches centrées sur les principaux objectifs communicatifs, linguistiques et culturels indiqués par les descripteurs du Cadre européen commun ; – d’autres présentent des activités de classe basées sur des tâches communicatives à faire réaliser et illustrent la démarche pédagogique, à l’aide d’un document-support. En fin d’ouvrage, on pourra consulter : – une sitographie sélective ; – une bibliographie. 1. Année européenne des langues. 2. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, élaboré par un groupe d’experts de la Division des poltiques linguistiques du Conseil de l’Europe. Téléchargeable sur le site du Conseil de l’Europe http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration%5Fculturelle/education/Langues/ et publié aux éditions Didier, Paris, 2001. 3. Ministères en charge de l’Éducation ayant adopté le Cadre européen commun de référence : l’Espagne, le Portugal, l’Italie. Première partie La langue : enseignement et apprentissage Chapitre 1 La langue : enseignez-vous le fle, le flm, le fls ou le fos ? Les définitions de ces sigles peuvent varier d’un pays à l’autre, voire dans un même pays, il est donc important de les clarifier. Premier exemple : dans un pays étranger, le français sera langue seconde s’il est étudié comme deuxième langue étrangère. Dans un autre pays, il sera langue seconde s’il est la deuxième langue, apprise directement après la langue maternelle. En revanche, en France, dans ce dernier cas, on dit que cette seconde langue est « première langue vivante »… Deuxième exemple : en France, depuis la création des classes qui dans le système scolaire accueillent les enfants de migrants 1, le débat est extrêmement vif sur l’utilisation dans ces classes d’une méthodologie d’enseignement qui relève soit du fle (français enseigné en tant que langue étrangère), soit du fls (français langue seconde ou français langue de scolarisation). Cette différence tend, semble-t-il, à s’atténuer. De fait, on parle aujourd’hui de « français, langue de l’école », dont le sigle n’est autre que fle… LE FLE : LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE C’est tout simplement la langue d’apprentissage pour tous ceux qui ont une autre langue que le français comme langue maternelle. L’expression « français langue étrangère » (fle) est apparue sous la plume d’André Reboullet, en couverture de la revue Les Cahiers pédagogiques, en mai 1957. Il a cependant fallu une trentaine d’années avant que le fle ne devienne une discipline donnant lieu à des formations universitaires. C’est en 1981 qu’à la demande du ministère de l’Éducation nationale le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) a réuni un groupe de travail sur l’enseignement du français langue étrangère. En 1982, le rapport Auba (du nom du directeur du CIEP) a présenté ses conclusions pratiques et ses recommandations de création : • de filières universitaires de formation de professeurs de fle ; • de postes d’inspecteurs généraux de fle ; • de diplômes officiels français permettant de constater et de valider les niveaux de compétence en langue française des étrangers. 1983 a vu la création de la licence ès-lettres avec mention fle et de la maîtrise professionnelle de fle. Un CAPES mention fle a même existé mais a été supprimé au bout de deux ans. Deux postes d’inspecteurs généraux pour le fle ont été créés. La Commission chargée d’élaborer le projet de création des diplômes de niveaux de langue française pour les étrangers a été mise en place et a conçu les diplômes du ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : le DELF et le DALF en 1985. En 2006, la France compte un réseau d’établissements culturels français à l’étranger composé de 146 centres et instituts français et de 280 alliances françaises subventionnées. Le nombre de personnes (scolarisées dans leurs systèmes éducatifs ou apprenants volontaires dans les établissements du réseau) qui apprennent le français dans le monde ne cesse d’augmenter (+ 29 % en 10 ans soit environ +17 millions de personnes) 2. Enseigner le français langue étrangère a été et est toujours vécu comme une aventure entre enseignants, dont 70 000 environ sont regroupés en associations au sein de la Fédération internationale des professeurs de français 3. LE FLM : FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE Le français est une langue maternelle pour tous les Français, nés en France de parents français ou étrangers, mais également pour tous ceux qui sont nés dans des pays où le français est la langue première, la langue dans laquelle on apprend à parler et généralement dans laquelle on est scolarisé. Il ne faut cependant pas en déduire que la langue de la nationalité est toujours la langue maternelle, car quantité de situations montrent que la langue nationale n’est pas toujours celle dans laquelle l’enseignement est donné : ainsi, si en Espagne, l’espagnol (castillan) est la langue nationale, les enfants de différentes communautés autonomes sont scolarisés dans la langue de la communauté (le catalan, par exemple, en Catalogne). Le cas des enfants d’étrangers ou d’un couple mixte, nés en France, est un autre exemple. Les enfants parleront la langue de leur mère ou de leur père avant d’être scolarisés en français à l’école « maternelle ». Dans ce cas, la langue maternelle sera la langue vernaculaire utilisée en famille et le français deviendra la langue seconde. On voit que la notion de langue maternelle, qui paraît à première vue simple à définir, recouvre des notions relativement complexes. La France partage le français avec d’autres États, en Europe et uploads/Litterature/ tagliante-la-classe-de-la-langue.pdf
Documents similaires
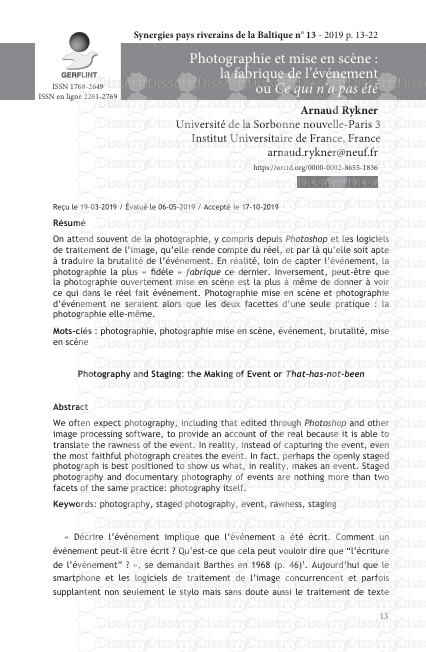









-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 07, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 7.5602MB


