Université Paris 7 – Denis Diderot U.F.R. L.A.C. (Lettres, Arts et Cinéma) Equi
Université Paris 7 – Denis Diderot U.F.R. L.A.C. (Lettres, Arts et Cinéma) Equipe « Théorie de la Littérature et Sciences Humaines » Travaux en cours Journées doctorales de Paris 7 – Denis Diderot organisées par Sarah Clément, Jonathan Degenève, Sylvain Dreyer, Gabriela García Hubard, Jérémie Majorel et Claire Montanari Coordination : Evelyne Grossman et Jérémie Majorel N°4 Avril 2009 Edito Sous une forme résumée, on trouvera dans ce quatrième numéro de Travaux en cours les communications qui ont été faites par les étudiants de Paris 7 – Denis Diderot et d’ailleurs lors des journées d’études doctorales suivantes : - la journée sur Maurice Blanchot organisée le 19 mars 2008 par Christophe Bident, Jonathan Degenève et Jérémie Majorel - la journée sur Beckett organisée le 10 avril 2008 par Evelyne Grossman, Sarah Clément et Gabriela García Hubard - la journée « Poésie et genèse » organisée le 30 mai 2008 par Claude Millet, Paule Petitier et Claire Montanari - la journée sur « Après Mai. La création après la révolte » organisée le 15 novembre 2008 par Sylvain Dreyer (Groupe CLAM ECLAT) - la journée sur Maurice Blanchot organisée le 9 mars 2009 par Christophe Bident et Jérémie Majorel Ces Travaux en cours se veulent le reflet de la vitalité et de la diversité des activités menées par les jeunes chercheurs. Ils entendent par là même contribuer à la diffusion de leurs écrits au sein de la communauté universitaire. Signalons enfin que les textes sur Blanchot et Artaud sont également disponibles sur les sites Espace Maurice Blanchot (www.blanchot.fr) et Antonin Artaud (www.artaud.info). S.D., J.M. et C.M. Édition : Université Paris 7 – Denis Diderot U.F.R. L.A.C. (Lettres, Arts, Cinéma) Ecole doctorale (direction : Julia Kristeva) CERILAC (direction : Francis Marmande) Grand Moulins - Bâtiment C - 7ème étage 16, rue Marguerite Duras 75205 PARIS CEDEX 13 Téls : 01 57 27 63 59 ou 01 57 27 64 42 Rédaction : Sarah Clément Claire Montanari 47, rue Lepic 75018 Paris 104, rue de Fontenay 94300 Vincennes 06 14 67 19 30 clement.sarah@gmail.com 06 30 77 16 81 montanariclaire@yahoo.fr Sylvain Dreyer 91, bd Longchamp 13001 Marseille 06 65 65 23 10 sylvaindreyer@hotmail.fr Gabriela García Hubard Margaritas 353-F Colonia Florida CP 01030 Mexico DF 09 54 82 63 52 gagahu@yahoo.fr Jérémie Majorel 17, rue des Morteaux 92160 Antony 06 17 15 59 81 majoxxxx2000@yahoo.fr Journée Maurice Blanchot 2008 organisée par Christophe Bident, Jonathan Degenève et Jérémie Majorel L’EXPÉRIENCE, CET ÉCART (BLANCHOT, BATAILLE) Hannes Opelz Il s’agit ici d’interroger un mot – expérience – à l’aune du destin qu’il a connu dans l’œuvre et la pensée de Maurice Blanchot et de voir, en cette interrogation, ce qu’il peut vouloir indiquer autour et à l’écart de son sens traditionnel (en admettant que l’histoire ait bien voulu lui allouer un terrain sémantique stable qui ferait tradition). Entreprise naïve et même périlleuse ; naïve, elle qui espère s’arrêter sur la signification d’un terme qui ne s’arrête pas, qui ne cesse de frayer et perdre son chemin aussi bien dans l’histoire de la pensée que dans celle de Blanchot ; périlleuse dans la mesure où elle risque de faire violence à l’œuvre qu’elle parcourt chaque fois qu’elle s’apprête à la réduire, en souhaitant pourtant l’ouvrir, au seul terme qui l’occupe. Mais le bonheur (ou le malheur) de choisir tel terme n’appartient pas uniquement à la naïveté hasardeuse qui s’est fait une raison de commenter celui-ci mais d’abord à la pensée qui l’a nourrie tout au long d’une œuvre. La question qui s’est imposée à Blanchot, ou du moins à laquelle sa pensée nous expose, est la suivante : Qu’est-ce qui est en jeu lorsque l’on affirme que la littérature est une expérience ? Une telle question, on le sent bien, déploie des perspectives presque infinies. Afin d’éviter que celles-ci ne la diluent infiniment, nous la situerons, d’emblée, en rappelant l’importance de l’expérience dite « mystique », expérience qui jouera un rôle essentiel dans la naissance et le développement de la notion d’expérience littéraire chez Blanchot. Quelques traits directeurs s’en dégageront aussitôt sous forme de tensions insurmontables et cependant nécessaires – dialectique/paradoxe, intériorité/dehors, sujet/autre, vie/mort – traits que la rencontre avec Georges Bataille (lui aussi fasciné, on le sait, par la démarche mystique) ne fera qu’accentuer afin d’accueillir cette autre région majeure de l’existence – l’impossible – que Bataille et Blanchot nous donnent non seulement à penser mais aussi à vivre. De quelle vie s’agit-il ? Peut-elle même être vécue ou éprouvée ? Comment « vit »-on l’impossible ? Questions qui seront conduites, chez l’un, par la fusion immédiate que suppose l’affect, l’extase du sacré, chez l’autre, par l’écart relationnel que commande la littérature, la parole d’écriture. Fusion et écart, donc, que nous entendons ici comme le cœur d’une différence, lourde de conséquences philosophiques, qui bat à l’ombre de leur amitié et les « met authentiquement en rapport ». Né à Genève en 1980. Études à Londres, Paris, Bologne, Cambridge. Il consacre son travail à Maurice Blanchot et à l’expérience littéraire qui lui est propre. hdo20@cam.ac.uk LIRE A LA LISIERE DE L’HERMENEUTIQUE : LA CRITIQUE BLANCHOTIENNE DES ANNEES 1940 Jérémie Majorel Nulle part dans Faux Pas ou La Part du feu ne se lit une critique de l’allégorie, du symbole et de la métaphore au profit de la seule image, que Blanchot ne manifestera comme telle qu’à partir de L’Espace littéraire. « Allégorie », « symbole » et « métaphore » sont des termes fonctionnels pour la critique blanchotienne des années 1940, parmi lesquels le terme d’« image » est noyé, ou en tout cas n’émerge pas particulièrement. Est-ce à dire que cette critique n’était qu’une application de l’herméneutique traditionnelle ? A lire attentivement Faux Pas ou La Part du feu, il n’en est rien et même parfois tout le contraire. Certes, Blanchot ne critique pas en eux-mêmes l’allégorie, le symbole et la métaphore, mais il les bouleverse de l’intérieur et prépare l’émergence d’un espace critique qui ne serait plus délimité par ces catégories. Dans l’article que Blanchot écrit dans Faux Pas sur Le Mariage du Ciel et de l’Enfer de W. Blake, il montre une « tension » entre « imagination morale » et « imagination poétique », éloignée des « ténèbres allégoriques qui assombrissent souvent ses autres œuvres », liée au contraire à un mouvement singulier des « symboles » : « [L]es symboles, destinés à une composition coordonnée, rompent le plan dont ils devaient animer l’unité grandiose et, poussés par leur puissance propre, ivres d’une vie irrésistible, ils se développent dans la fièvre de leurs métamorphoses, sans souci de leur sens, imposant un monde qui est un magnifique chaos d’allégories »1. Les « allégories » sont subordonnées au « sens » que veut communiquer le poète, elles participent de « l’unité » d’un « plan » et d’« une composition coordonnée » qui sont commandées par ce « sens ». C’est ce qu’on redoute d’un poète chrétien : une sorte de poésie à thèse. Mais, chez Blake, les « symboles » brisent l’ordonnancement allégorique voulu par le poète pour laisser place à « un magnifique chaos d’allégories ». Le mouvement effréné des symboles qui éclate l’ordre des allégories et où « l’imagination poétique » rompt sa subordination à « l’imagination morale » se formule par un chiasme : « Les proverbes y sont des figures, et les visions, déchirées par l’éclair, s’ouvrent sur des pensées lisibles »2. Blanchot situe ce chiasme entre « imagination poétique », « figures », « visions » et « imagination morale », « proverbes », « pensées lisibles » hors de toute logique dialectique : « William Blake a conçu une synthèse qui fait de lui l’adversaire anticipé de Hegel et le modèle de Kierkegaard et de Nietzsche. Il veut réunir en soi la contradiction, non pour la résoudre ou la surmonter, mais pour la maintenir dans sa tension constante »3. Si on nous permet d’anticiper aussi, ce développement ne paraîtrait pas insolite dans les pages que L’Entretien infini consacre au neutre4. Et ceci encore : « Il [Blake] reçoit les moyens de détruire et de construire »5. 1 Maurice Blanchot, « Le mariage du ciel et de l’enfer », in Faux Pas, Gallimard, 1943, p. 38. 2 Maurice Blanchot, ibid., p. 37 (c’est nous qui soulignons). 3 Maurice Blanchot, ibid., p. 39. 4 Rappelons la manière dont Derrida définit le neutre chez Blanchot : « au-delà de la dialectique, […] mais aussi au-delà de la grammaire négative […], c’est l’expérience ou la passion d’une pensée qui ne peut s’arrêter à aucun des opposés sans pour autant surmonter l’opposition […] », in Jacques Derrida, Demeure Maurice Blanchot, op. cit., p. 121. 5 Maurice Blanchot, « Le mariage du ciel et de l’enfer », art. cit., p. 39. Blanchot valorise ce même déchirement quand il s’agit aussi de métaphores, par exemple à propos du recueil Haut mal de Leiris, dans l’article de Faux Pas « Poésie et langage » : « Le rôle des images dans l’univers poétique n’est pas toujours uploads/Litterature/ travaux-en-cours-n04.pdf
Documents similaires
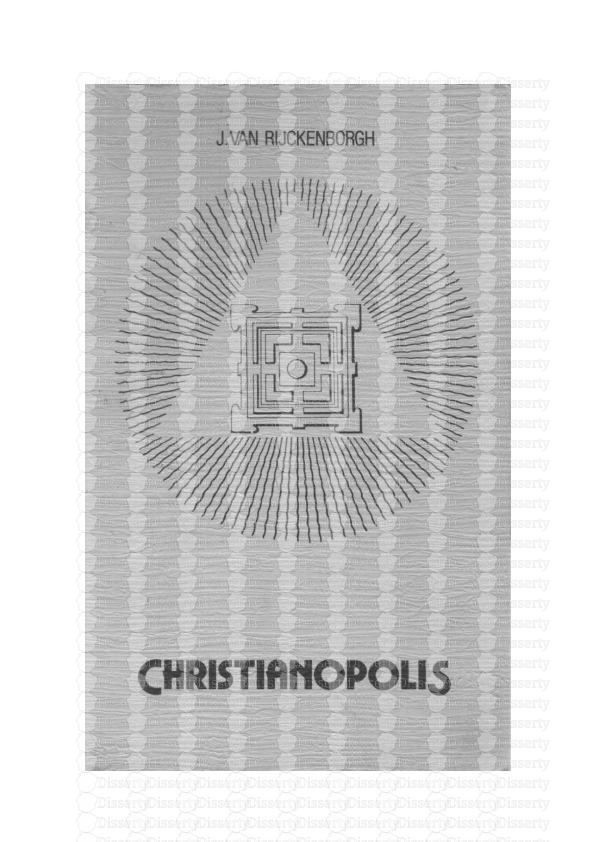









-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 07, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8826MB


