1975-11-24 YALE UNIVERSITY, KANZER SEMINAR Universités nord-américaines. Paru d
1975-11-24 YALE UNIVERSITY, KANZER SEMINAR Universités nord-américaines. Paru dans Scilicet n° 6/7, 1975, pp. 7-31, sous le titre : « Yale University, Kanzer Seminar ». (7)Ce n’est pas facile… It is not easy to speak in a country which is perfectly strange for me. Vous voyez, j’essaye de me faire entendre par chacun, quoique mon anglais soit plutôt élémentaire et bien que je tente de l’améliorer – je tente de l’améliorer cette année de façon un peu paradoxale par la lecture – par la lecture de Joyce (rires). Un de mes auditeurs, inspiré par ma récente conférence (une conférence qui me fut demandée pour ouvrir le congrès sur Joyce) – un auditeur de mon séminaire où les gens se pressent en foule, à ma grande surprise comme à celle de chacun et, naturellement, je n’y avais pas annoncé ma conférence sur Joyce – écrivit un article dans une revue française où la littérature est particulièrement tortillée. Tordue, comme ça. Mais parfois des choses paraissent dans cette revue qui font sens – parfois beaucoup de sens – et en particulier ce qui fut avancé par mon auditeur : il avança qu’après Joyce la langue anglaise n’existait plus. Évidemment, ce n’est pas vrai puisque, jusqu’à Finnegan’s Wake, Joyce respecta ce que Chomsky appelle la « structure grammaticale ». Mais, naturellement, il en a fait voir de dures au mot anglais. Il alla jusqu’à injecter dans son propre genre d’anglais des mots appartenant à un grand nombre d’autres langues, y inclus le norvégien, et même certaines langues asiatiques ; il força les mots de la langue anglaise en les contraignant à admettre d’autres vocables, vocables qui ne sont pas du tout respectables, si je puis dire, pour quelqu’un qui use de l’anglais. On peut dire qu’en anglais il existe, dans l’ensemble, deux sortes de vocables : ceux de racine latine et ceux dits germaniques, qui, de fait, ne sont pas germaniques, mais appartiennent à une autre branche de l’indo-européen : l’anglo-saxon. C’est du côté saxon qu’on trouve les racines germaniques, mais, (8)au terme, il y a quelque chose de spécifique à l’anglais à étudier en tant que tel pour saisir ce qui le caractérise en opposition aux autres langues. Mais la chose importante, du moins telle que nous, analystes, la concevons, est de dire la vérité. Et, comme nous avons de cette vérité une idée un peu particulière, nous savons que c’est très difficile. Et, comme il a été convenu que je parlerai le premier et qu’il y aurait des questions ensuite, j’aimerais commencer par prendre ce qui est justement appelé contact avec vous qui êtes là ce soir, en – pourquoi pas ? – posant des questions moi-même. Naturellement, cela suppose que vous voudrez bien répondre, fût-ce par une autre question. Je voudrais d’abord adresser une question précisément à ceux qui ont choisi de se poser comme psychanalystes, je voudrais leur demander, et j’aurai nécessairement à répondre d’abord, comment ils en étaient venus à ce qui peut après tout être raisonnablement appelé leur… job. Être un analyste est un job et, de fait, un job très dur. C’est même un travail inhabituellement fatigant et, si je reprends les mots du dernier analyste que je vis avant cette visite aux États-Unis, il me confia qu’il avait besoin de se reposer un peu entre chacune de ses analyses et que cela donnait son rythme à son travail. Quant à moi, pour vous dire la vérité, je n’ai pas le temps de me reposer entre deux analyses. Cela parce que, du fait de ma notoriété, beaucoup de gens viennent pour être analysés, pour me demander de les analyser. Hier soir, dans la maison de Shoshana Felman, un groupe de jeunes gens m’a demandé comment je choisissais mes patients. Je répondis que je ne les choisissais pas comme ça tout droit, mais qu’ils avaient à témoigner de ce qu’ils attendaient pour résultat de leur requête. 1 1975-11-24 YALE UNIVERSITY, KANZER SEMINAR Maintenant, laissez-moi répondre à ma question : comment suis-je devenu psychanalyste ? J’y suis venu sur le tard, pas avant trente-cinq ans. J’avais commis ce qui est appelé en France une thèse de doctorat en médecine. Ce n’était pas mon premier écrit, car une thèse a à être réellement écrite. Une thèse est, par définition, ce qui a à être écrit et défendu. En ce temps, une thèse était affaire sérieuse, par laquelle on s’exposait à la contradiction. (9)Aujourd’hui, on se présente devant un jury composé habituellement de deux ou trois de ses anciens patrons, parfaitement informés du sujet qu’ils vous ont le plus souvent suggéré. Ce n’était pas mon cas. J’ai dû réellement imposer ma thèse. Je l’avais appelée – c’est pour les psychiatres présents – De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. J’étais naïf alors. Je croyais que la personnalité était chose aisée à saisir. Je n’oserais plus donner ce titre à ce dont il était question car, de fait, je ne crois pas que la psychose ait quelque chose à faire avec la personnalité. La psychose est un essai de rigueur. En ce sens, je dirais que je suis psychotique. Je suis psychotique pour la seule raison que j’ai toujours essayée d’être rigoureux. Cela va évidemment assez loin puisque ça suppose que les logiciens, par exemple, qui tendent vers ce but, les géomètres aussi, partageraient en dernière analyse une certaine forme de psychose. Aujourd’hui, je pense comme ça. Pour cette thèse, je ne l’avais pas entreprise imprudemment, j’avais rassemblé trente-trois cas de psychose : dans aucun, je n’ai trouvé d’exception à cette recherche de rigueur. Mais, comme on ne peut – contrairement à la pratique commune, je pense qu’on ne le peut – parler de trente-trois cas (ma thèse aurait eu des milliers de pages), je me suis contenté d’écrire une thèse d’un nombre raisonnable de pages, je veux dire d’un volume qui puisse être tenu en main, et j’y parle d’un de ces cas qui me semblait exemplaire, nommément en ceci que la personne en question avait commis de nombreux… écrits. Elle avait commis ces écrits sous la forme de nombreuses lettres outrageantes pour un tas de gens, je veux dire qu’elle était érotomane. Un certain nombre de gens ici savent, je pense, ce qu’est une érotomane : l’érotomanie implique le choix d’une personne plus ou moins célèbre et l’idée que cette personne n’est concernée que par vous. Il serait nécessaire de trouver comment cette idée prend racine, quoique ce soit impossible jusqu’à présent. Ce qui est certain est que, une fois le mécanisme mis en marche, chaque fait prouve que l’illustre personnage (dans ce cas une femme) est en relation amoureuse, non avec la personnalité, mais avec la personne nommée, désignée par un certain nom. À cette époque, cette personne avait son nom dans les journaux à la suite du geste (10)qu’elle avait eu contre une actrice alors célèbre, de façon cohérente avec son érotomanie dirigée sur cette actrice – de même qu’elle avait été dirigée auparavant sur d’autres célébrités (il n’est pas rare de voir opérer ce glissement d’une figure à une autre). En tout cas, elle avait un peu blessé cette actrice et fut envoyée en prison. Je me permis à moi-même d’être cohérent et pensai qu’une personne qui savait toujours si bien ce qu’elle faisait savait aussi à quoi cela la mènerait, et c’est un fait que son séjour en prison la calma. Du jour au lendemain disparurent ses jusqu’ici rigoureuses élucubrations. Je me permis – aussi psychotique que ma patiente – de prendre cela au sérieux et de penser que, si la prison l’avait calmée, c’était là ce qu’elle avait réellement recherché. Aussi donnai-je à cela un nom plutôt bizarre : je l’appelai « paranoïa d’autopunition ». À l’évidence, c’était peut-être pousser la logique un peu loin. Et cela me fit remarquer qu’il y avait chez Freud quelque chose du même ordre. Freud n’a pas principalement étudié les psychotiques. Mais il a, comme moi, en fait, étudié les écrits d’un psychotique, le fameux président Schreber. Et, à l’endroit du président Schreber, Freud n’adopte pas le même type de position que moi. Il est vrai que 2 1975-11-24 YALE UNIVERSITY, KANZER SEMINAR c’était un cas de logique beaucoup plus poussé. Mais je remarquai, à cause de ce qui fait le fond de sa pensée, que Freud n’était pas psychotique. Il n’est pas psychotique, contrairement à beaucoup, parce qu’il s’intéressait à quelque chose de différent. Son premier intérêt était l’hystérie. Et sa voie d’approche de cette autre chose était parfaitement sérieuse, consistant non pas à colliger des écrits – car les cas qu’il traitait n’étaient pas gens à inonder d’écrits, contrairement aux psychotiques –, mais à écouter. Il passait beaucoup de temps à écouter, et de ce qu’il écoutait résultait quelque chose de paradoxal eu égard à ce que je viens juste de dire, qui est une lecture. Ce fut pendant qu’il écoutait les hystériques qu’il lut qu’il y avait un inconscient. C’est quelque chose qu’il pouvait seulement construire et dans quoi il était lui-même uploads/Litterature/ yale-university-20-pages1975-11-24b.pdf
Documents similaires









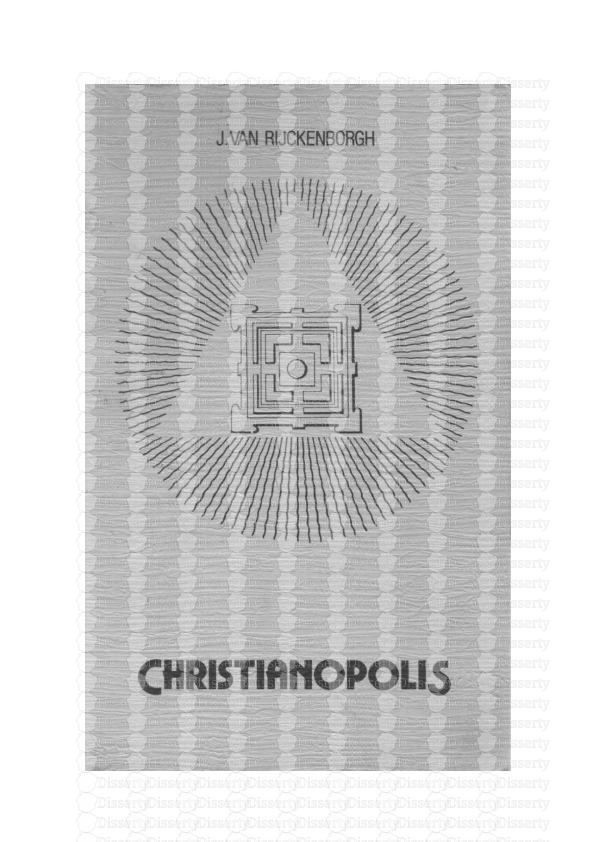
-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 11, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1605MB


