Ludovic NOËL Diplôme Professionnel Son 2ème Année 2007-2008 LE DOUBLAGE Copyrig
Ludovic NOËL Diplôme Professionnel Son 2ème Année 2007-2008 LE DOUBLAGE Copyright - Enseignement des Métiers de la Communication Malakoff 92240 - Tous droits réservés. Site web : http://www.emc.fr Pages INTRODUCTION 02 I/ HISTORIQUE ET PRESENTATION 03 I.1) Prémices 03 I.2) Versions multiples et postsynchronisation 04 I.3) Doublage et sous-titrage 05 I.4) Doublage : utilisation et évolution 06 I.5) Données économiques 07 I.6) Enjeu européen 07 I.7) Différents intervenants du doublage 08 I.8) Organisation des métiers 08 I.9) Chaîne du doublage : de la VO à la VF 09-11 II/ FONCTIONNEMENT 12 II.1) Support 12 II.2) Montage 12 II.3) Codification 12 II.4) Transformations de la bande rythmo 13 II.5) Signes de l’image 13 II.6) Signes mimiques, ponctuations visuelles et sonores 14 II.7) Signes du son 14 II.8) PAD 14 II.9) Outils 15 III/ ETAPES 16 III.1) Détection 16 III.2) Adaptation 16 III.3) Calligraphie 16 III.4) Frappe 16 III.5) Enregistrement 17 III.6) Mixage 17 III.7) Report 17 CONCLUSION 18 GLOSSAIRE 19-21 BIBLIOGRAPHIE, NETOGRAPHIE 22 ANNEXES 23-28 Copyright - Enseignement des Métiers de la Communication Malakoff 92240 - Tous droits réservés. Site web : http://www.emc.fr 1 INTRODUCTION Depuis plus de 100 ans, le monde du cinéma ne cesse de faire rêver. Qui n’a jamais souhaité travailler dans ce milieu enchanteur ? Les livres sur les métiers, les écoles de cinéma, de spectacle et de communication contribuent fortement à nourrir ce rêve. Les métiers du doublage permettent également une entrée dans ce milieu. Souvent péjoratif, le terme « doublage » regroupe, en réalité, un ensemble de talents et de compétences. Les métiers y sont évolutifs et multiples, les demandes récurrentes et les besoins grandissants. Dans ce mémoire, nous dresserons en premier lieu, un bref historique. Puis dans une seconde partie, nous étudierons le fonctionnement technique. Enfin, nous verrons les différentes étapes du doublage ainsi que les métiers qui leur sont associés. Copyright - Enseignement des Métiers de la Communication Malakoff 92240 - Tous droits réservés. Site web : http://www.emc.fr 2 I/ HISTORIQUE ET PRESENTATION I.1) Prémices En avril 1877, Charles Cros formulait le principe d'un appareil de reproduction des sons, le paléophone. Avant qu’il ne puisse suivre son idée et construire un prototype, Thomas Edison, mettait au point le premier phonographe et déposait son brevet le 19 décembre 1877. Les deux hommes ne connaissaient pas leurs travaux réciproques. Le 13 février 1895, les frères Louis et Auguste Lumière déposaient le brevet du cinématographe. Puis se succédèrent une première projection privée le 22 mars et une publique le 28 décembre de cette même année. Le problème du synchronisme* se présentait ici : diffuser simultanément l’image et le son. Une première solution naquit dans la profession de bonimenteur ou bonisseur qui commentait l’action et expliquait l’intrigue du film aux spectateurs. Les inventions se multiplièrent pour tenter d’asservir le gramophone, inventé par l’allemand Émile Berliner en 1889, à la caméra et au projecteur. Au début du XXème siècle, l’apparition des films sonores contournait ce problème en collant l’image au son. Le play-back, le Scopitone (ici, ce mot décrit les films eux-mêmes et non la sorte de juke-box associant l'image au son qui fut créé en France en 1960) et le clip étaient nés. Le play-back* ou présonorisation, consiste à conformer, au mieux, une image à une bande sonore préexistante. Ces bandes étaient des chansons gravées sur des galettes de cire. Le chanteur ou le comédien devait caler, face caméra, ses gestes et le mouvement de ses lèvres en fonction du rythme de la musique et des paroles de la chanson. Léon Gaumont associé à Georges Demeny, en juillet 1906, synchronisait le phonographe et le projecteur, grâce à un couplage électrique. Il lance dans le commerce ce qu’il appelle le chronophone Gaumont. Le chronophone était accompagné d'une liste de phonoscènes en locations. Alice Guy réalisait plus d’une centaine des ces « tableaux sonores » entre 1902 et 1906. La musique passait d’un état illustratif à un état fusionnel avec l’image. Mais le problème du synchronisme dans le cinéma sonore n’était toujours pas résolu. Dans de nombreux films, le son commençait en avance de l’image où les personnages remuaient encore les lèvres alors que la chanson était finie. De même, pour les films où, un orchestre ou un pianiste suivait, à vue, les péripéties. Les départs, les arrêts et les changements de climats étaient plus qu’approximatifs. En 1927, Paul Hindemith, dans le cadre du festival de Baden-Baden, utilisait une machine lui permettant de suivre la partition qui défilait au rythme de la projection du dessin animé Félix au cirque et d’exécuter, à vue, sa musique pour piano. La machine utilisée ressemblait au pupitre synchronisateur ou ciné pupitre mis au point par Charles Delacommune en 1923. Dans ce procédé, le synchronisme était assuré par le projecteur qui envoyait des impulsions électriques au ciné pupitre. Ce dernier faisait avancer une bande continue sur laquelle était inscrits le texte des commentaires ou les portées de la partition musicale. Cette bande défilait devant une fenêtre lumineuse à une cadence censée correspondre à celle du film : la bande rythmographique était née. Un an plus tôt, Alan Crosland, réalisait Don Juan et inaugurait le genre de la comédie musicale. Puis, en 1927, le Chanteur de Jazz (The Jazz Singer) marquait les débuts du synchronisme labial maîtrisé : une minute et vingt secondes de parole, soit environ 300 mots ouvrirent les portes du cinéma parlant et par extension du doublage*. Copyright - Enseignement des Métiers de la Communication Malakoff 92240 - Tous droits réservés. Site web : http://www.emc.fr 3 I.2) Versions multiples et postsynchronisation L’abandon du phonographe, l’invention de nouveaux moyens d’enregistrement optique et électro- acoustique du son a permis de lier définitivement le synchronisme et le film parlant. Le monde du cinéma muet appartenait d’un coup au passé. Il fallut pour les producteurs, insonoriser les studios de tournage et les caméras. Pour les distributeurs, uniformiser la vitesse de défilement de la pellicule (24 images par seconde) et sonoriser les salles. Pour les réalisateurs, réduire, pour un temps, leur recherche de l’esthétisme : le son direct imposant ses contraintes à la mise en scène et aux mouvements des appareils. Pour pouvoir s’exporter, les films devaient, désormais, parler la langue du pays de diffusion. L’industrie hollywoodienne et européenne se lança alors dans la production de films en « versions multiples ». Ces versions suivaient rigoureusement le scénario du film original. Elles se tournaient simultanément dans des langues différentes, dans le même studio, mêmes décors, mêmes costumes, suivant un découpage similaire. La direction était parfois assurée par le même metteur en scène et souvent par un autre. Le casting, évoluait en fonction des langues étrangères maîtrisées par les comédiens. Par exemple, Laurel et Hardy jouèrent phonétiquement, en langue étrangère, dans de nombreuses versions multiples de leurs films. C’est grâce à la technique de reproduction du son sur la bande même du film appelé phonofilm du Dr Lee Forest, que les frères Dave et Max Fleischer, en 1924, vont produire des films sonores et le premier personnage parlant de l'histoire du dessin animé, devançant en cela Walt Disney et son Steamboat Willy en 1928. Les Américains développèrent alors le dubbing ou synchronization, c'est-à-dire l’enregistrement du son et sa synchronisation après que l’image ait été tournée. Hallelujah de King Vidor, réalisé en 1929, est considéré comme le premier long métrage entièrement doublé. L’anecdote raconte que le camion du son était en retard sur le lieu de tournage, à Memphis. Vidor, obligé de commencer son film muet, se sentit finalement libéré des contraintes de la prise de son direct et continua à le réaliser entièrement de la même façon. Copyright - Enseignement des Métiers de la Communication Malakoff 92240 - Tous droits réservés. Site web : http://www.emc.fr 4 I.3) Doublage et sous-titrage Rapidement, le sous-titrage* et le doublage s’appliquèrent aux films originaux ainsi qu’aux versions multiples. Plusieurs films gardent la trace de ces évolutions techniques et de leur adaptation aux divers pays de diffusion. Ainsi, le film de Josef Von Sternberg, l’Ange Bleu, dont il existe deux versions en 1930, l’une allemande Der Blaue Engel, l’autre anglaise The Blue Angel, a été projeté au Studio des Ursulines, à Paris, alternativement en version anglaise sous-titrée en français et en version intégrale allemande. Suivant le découpage du film, la taille et la position des personnages dans l’espace du cadre, les plans originaux pouvaient être réutilisés facilement dans les versions multiples et doublés dans une autre langue. Ce procédé permit une normalisation de la production ainsi que des économies importantes. L’arrivée massive de ces versions sur le marché obligea bientôt la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne à les limiter afin de préserver leur production nationale. Le mot de doublage se substitua en France à celui de dubbing et cette activité fut reconnue au générique des films. Ainsi, Une Histoire d’Amour (1933) de Max Ophuls, « version multiple » de Libelei (1932), est assurée, entre autres, par Erich Paul Radzac. Ce serait lui qui, de retour d’Allemagne, aurait introduit en France la bande rythmo* inventée en 1927 pour la projection de Félix le chat uploads/Litterature/le-doublage.pdf
Documents similaires







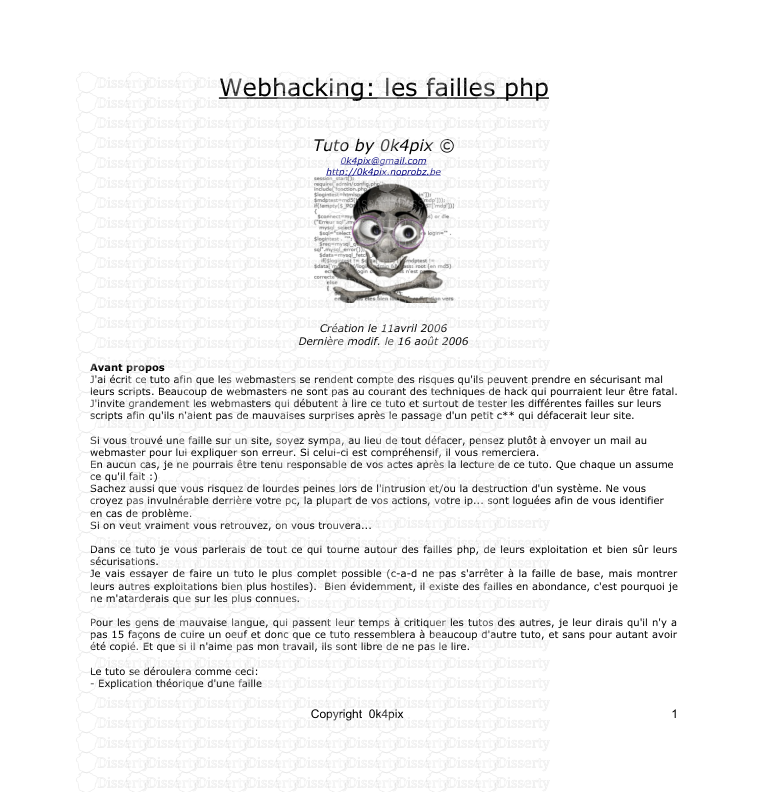


-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0563MB


