Article original Les effets directs et indirects des stéréotypes sociaux sur un
Article original Les effets directs et indirects des stéréotypes sociaux sur une décision d’orientation scolaire The Effect of salient Social Stereotypes on Academic-Tracking Decisions A. Channouf *, C. Mangard, C. Baudry, N. Perney Laboratoire de psychologie sociale, U.F.R. psychologie et sciences de l’éducation, université de Provence, 29, avenue Robert-Schuman, 13621, Aix-en-Provence, cedex 01, France Reçu le 12 janvier 2004 ; reçu en forme révisée le 24 janvier 2005 ; accepté le 26 février 2005 Résumé Des professeurs de collège devaient décider de l’orientation scolaire d’un élève de 3e dont l’appartenance sociale (favorisée vs défavorisée) était induite expérimentalement. Les informations stéréotypiques liées à l’origine sociale de l’élève étaient délivrées soit directement soit indirectement. Les résultats montrent qu’un élève de milieu social favorisé est davantage orienté en seconde générale qu’un élève de milieu social défavorisé et, symétriquement, qu’un élève d’origine sociale défavorisée est davantage orienté en seconde professionnelle qu’un élève d’origine sociale favorisée. Toutefois, ces différences de décisions d’orientation sont principalement observées lorsque les informations sté- réotypiques liées à l’appartenance sociale sont délivrées indirectement, c’est-à-dire sans que le sujet ait vraiment conscience de leur influence. © 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés. Abstract Middle-school teachers had to make decisions about the academic tracking of ninth-grade students whose social class (upper-middle vs. underprivileged) was experimentally induced. Stereotypical information about the student’s family background was given either directly or indirectly. The results showed that a student from a well-off home was more often oriented towards a college-prep curriculum than a student from an underprivileged home, and symmetrically, an underprivileged student was more often oriented towards vocational school than a well-off student. However, these decisional differences were only observed when the stereotypical information about the student’s social class was given indirectly, i.e. in such a way that the subject was unaware of its impact. © 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés. Mots clés : Stéréotypes sociaux ; Décision d’orientation scolaire ; Influence inconsciente Keywords: Stereotypes; Decisions about the academic tracking; Unconscious influence 1. Introduction Dans l’enseignement secondaire français, l’orientation des élèves vers une filière générale ou vers une filière profession- nelle dès le passage de la classe de 3e vers la classe de seconde constitue un enjeu social majeur tant pour les élèves que pour leurs familles (cf. e. g. Duru-Bellat et Henriot-van Zanten, 1992). En effet, cette orientation détermine, pour une grande partie, les possibilités, réelles ou représentées, des choix socio- professionnels qui s’offriront par la suite à l’élève (cf. Gui- chard et Cassar, 1998 ; Guichard et al., 1994 ; Guichard et Huteau, 2001 ; Huteau, 1992 ; Huteau et Vouillot, 1988). On ne peut donc qu’espérer que la décision d’orientation soit la plus objective possible et que seules puissent être prises en compte les informations individuelles relatives aux cursus et aux performances scolaires de l’élève au moment de l’orien- tation afin que le principe consensuel fondamental de l’éga- lité des chances soit respecté. Même si les interprétations divergent, les travaux des sociologues (cf. Boudon, 1973 ; * Auteur correspondant. Adresse e-mail : ahmed.channouf@up.univ-aix.fr (A. Channouf). Revue européenne de psychologie appliquée 55 (2005) 217–223 http://france.elsevier.com/direct/ERAP/ 1162-9088/$ - see front matter © 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés. doi:10.1016/j.erap.2005.02.003 Bourdieu et Passeron, 1964, 1970) nous ont unanimement appris que, statistiquement, un élève de milieu social défavo- risé n’a pas les mêmes chances d’accéder à une filière géné- rale qu’un élève de milieu social favorisé. Les résultats de ces recherches devraient impliquer de laisser à un élève donné sa chance de réussite dans les filières générales malgré ces déterminismes sociaux. On peut même penser et espérer que les professionnels de l’enseignement secondaire impliqués dans l’orientation des élèves (les professeurs et les conseillers d’orientation psychologues) soient très bien informés des tra- vaux des sociologues, pour ne tenir compte que des seules compétences de l’élève (i. e. savoirs et savoir-faire) afin d’évi- ter les préjugés et les biais d’évaluation liés à la connaissance qu’ils peuvent avoir de son milieu d’origine. Mais si tel n’était pas le cas, on pourrait craindre que les stéréotypes sociaux aggravent les inégalités déjà très importantes. Même si ce n’est pas exactement la problématique que nous abordons ici, on peut citer les travaux en psychologie sociale sur les sté- réotypes implicites (cf. Banaji et al., 1993 ; Bargh, 1984, 1992 ; Dumora et Lannegrand, 1996 ; Greenwald et Banaji, 1995 ; Lewicki, 1986 ; Pratto et Bargh, 1991) qui montrent que ce type de croyance n’est hélas pas toujours facile à contrecarrer. Cette difficulté tient au fait que les stéréotypes interviennent souvent de manière indirecte et parfois en dehors des processus conscients. La recherche présentée ici a ainsi pour objectif de compa- rer les effets des stéréotypes directement activés aux effets des stéréotypes indirectement activés d’appartenance sociale sur une décision d’orientation scolaire auprès d’une popula- tion de professeurs de l’enseignement secondaire. Nous ne manipulons pas les stéréotypes implicites au sens méthodo- logique du terme, mais plutôt la saillance ou non des infor- mations stéréotypiques, qui permet d’étudier les influences inconscientes sur l’évaluation, en l’occurrence, la décision d’orientation (Channouf, 2004). Il s’agit d’une décision concernant le passage d’élèves de 3e en classe supérieure assortie d’une orientation quasi décisive du type d’étude (filière scientifique ou littéraire générale ou filière profession- nelle). Précisons, au préalable, que la procédure d’orienta- tion débute, en classe de 3e, dès le second trimestre par des vœux provisoires formulés par l’élève et ses parents. Ces vœux sont examinés par le conseil de classe. En fonction de ces vœux et des résultats scolaires de l’élève, le conseil de classe formule des propositions provisoires d’orientation. À ce stade, le désaccord possible peut déboucher sur une ren- contre entre les parents, l’élève et le professeur principal. L’élève et/ou la famille peuvent également solliciter l’avis du conseiller d’orientation psychologue afin de trouver des solutions. Au troisième trimestre, la famille et l’élève émet- tent des vœux définitifs sous forme de choix hiérarchisés. Lors du conseil de classe de la fin de l’année scolaire, les profes- seurs vont prononcer des propositions définitives d’orienta- tion. En cas d’accord des familles, les propositions du conseil valent comme décisions d’orientation. Mais en cas de désac- cord, les parents ont la possibilité de faire appel. L’avis du conseil de classe est ainsi suspendu et les choix de l’élève sont réexaminés par une commission d’appel. Dans cette déci- sion d’orientation, importante dans la vie d’un élève et de sa famille, nombreux sont les travaux qui ont souligné l’exis- tence de biais qui sont liés à l’origine sociale. Duru-Bellat et Henriot-van Zanten (1992) par exemple, ont montré que dans une fourchette de notes allant de 9 à 10,3, les élèves sont dispersés dans des filières différentes selon leur origine sociale. En effet, l’orientation en second cycle long est beau- coup plus fréquente pour les enfants de cadres que pour les enfants d’ouvriers plutôt destinés à un second cycle court (voie professionnelle comme le BEP ou le CAP). Ainsi, les résul- tats scolaires ne seraient pas les seuls déterminants du cursus scolaire. Les décisions d’orientation seraient soumises à des influences sociales probablement plus inconscientes que cons- cientes. C’est l’objet d’étude de cette recherche. L’hypo- thèse que nous formulons et testons ici est que la décision d’orientation scolaire est influencée par les stéréotypes liés à l’appartenance sociale et que cette influence est d’autant plus forte que le stéréotype est indirectement induit. 1.1. Les stéréotypes Se former une impression sur autrui se fait souvent de manière plus ou moins spontanée. Aussi, des informations traitées de manière inconsciente peuvent influencer ou déter- miner l’impression qu’une personne se fait d’une autre per- sonne. Bargh et Pietromonaco (1982) ont réalisé une expé- rience sur la formation d’impression au cours de laquelle ils ont introduit des informations inconscientes : il s’agissait d’amorces présentées en subliminal, c’est-à-dire en dessous du seuil de perception consciente (cf. Channouf, 1995,1997 ; Channouf, 2000a,2000b pour les aspects techniques de l’amorçage subliminal). Ils ont formulé l’hypothèse selon laquelle la présentation d’une information relevant d’une caté- gorie (l’hostilité par exemple) peut, au moins temporaire- ment, augmenter l’accessibilité à la catégorie et conduire l’individu à un biais dans son jugement. Les auteurs présen- taient aux sujets, placés à 56 cm de l’écran d’un ordinateur, des mots amorces de manière subliminale. Les mots appa- raissaient comme des éclairs lumineux aux quatre coins de l’écran. Les sujets n’étaient pas informés qu’il s’agissait de mots. Dans un premier temps, ils devaient dire si l’éclair était apparu à gauche ou à droite de l’écran de l’ordinateur. Ces mots avaient pour caractéristique d’être à 80, 20 ou à 0 % sémantiquement reliés à la notion d’hostilité. Dans un second temps, une tâche de formation d’impression leur était propo- sée.Après avoir lu la description d’un comportement ambigu quant à sa nature hostile, les sujets devaient évaluer l’acteur (fictif) du comportement sur plusieurs échelles dont six étaient directement reliées au concept d’hostilité. Les résultats mon- trent que plus les sujets ont été amorcés avec des mots séman- tiquement reliés à l’hostilité, plus ils ont tendance à évaluer négativement l’individu qui leur était présenté par la uploads/Litterature/les-effets-directs-et-indirects-des-sthereotipies-dezv-exp.pdf
Documents similaires




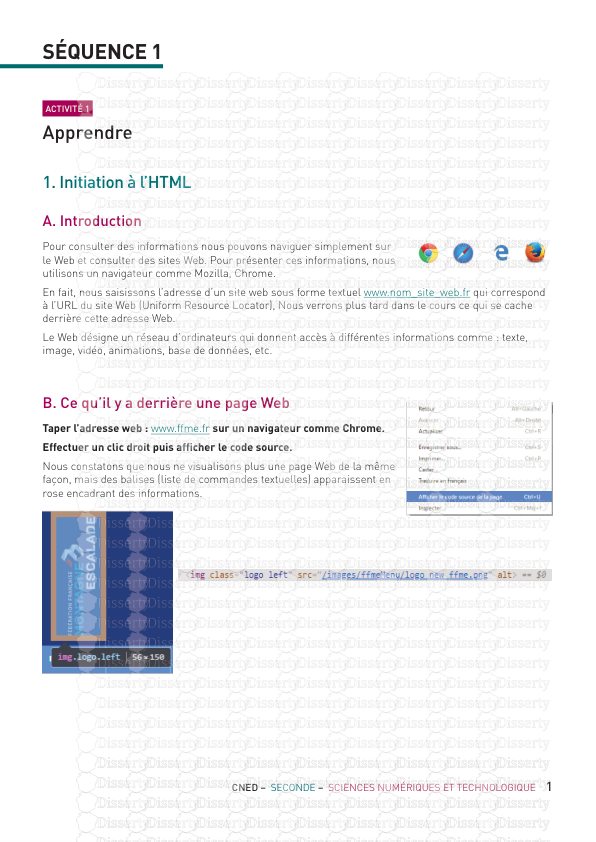





-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 26, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1149MB


