Cah. Techn. Inra, 2008, 63, 25-32 Prélèvement, préservation et prétraitement de
Cah. Techn. Inra, 2008, 63, 25-32 Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons Journées physico-chimie à Arras les 16 et 17 juin 2005 Mireille Barbaste1, Giovanni Caria1, Henri Ciesielski2, Nicolas Proix2, Fabienne Trolard3 Résumé : Cet article a pour objet de décrire les différentes étapes de traitement de l’échantillon prélevé sur le terrain et destiné à l’analyse. Des éléments de réflexions, des alertes sur les risques de pertes ou de contamination encouru lors des étapes de conditionnement, transport, stockage, division, séchage, broyage, conservation sont donnés. Les analytes considérés sont les composés organiques et les éléments minéraux pour des matrices environnementales (sols, végétaux, solutions, déchets). Mots clés : Prétraitement échantillons, sol, végétaux, déchets, ETM, molécules organiques Introduction Lors des journées physico-chimie qui se sont tenues à Arras les 16 et 17 juin 2005, une demi- journée a été consacrée à la conservation et au prétraitement des échantillons pour analyses. Les matrices considérées ont été les sols, les végétaux, les solutions et les déchets (boues, composts), en vue des analyses de composés minéraux et organiques en excluant toutefois celles à caractère microbiologique. Ce document est issu des présentations faites lors de cette session et des discussions qui ont suivi. Compte tenu de la variété des matrices et des analytes, on ne peut envisager l’élaboration de protocoles détaillés et exhaustifs pour le prétraitement des échantillons. L’objectif recherché ici est donc plutôt de fournir quelques éléments de réflexion pour préserver au mieux les caractéristiques qualitatives et quantitatives des grandeurs à mesurer. 1. Généralités Du prélèvement de « l’échantillon pour laboratoire » jusqu’à la préparation de « l’échantillon pour essai », il convient d’éviter toute dégradation des composés à analyser. Les dégradations peuvent être d’origine : - physique : volatilisation, adsorption, - chimique : oxydoréduction, réactions photochimiques, - biologique : activité microbiologique, réactions enzymatiques. A ces difficultés s’ajoutent les risques de contamination induits par l’utilisation de récipients et outils de préparation non adaptés. 1 Inra USRAVE -Analyses végétales et environnementales - BP 81 - 33883 Villenave d’Ornon cedex 05 57 12 24 04 barbaste@bordeaux.inra.fr 2 Inra Analyses des sols LAS - 273 rue de Cambrai -62000 Arras - 03 21 21 86 00 las@arras.inra.fr 3 Inra GSE -Géochimie des soles et des eaux - Europôle méditerranéen de l’Arbois - BP 80 - 13545 Aix en Provence cedex 04 04 42 90 85 41 trolard@aix.inra.fr 25 La connaissance de certaines caractéristiques physico-chimiques des composés à analyser peut aider au choix d’une méthode appropriée de prétraitement des échantillons. On peut citer : - la température d’ébullition ou la tension de vapeur à température et pression données, - la sensibilité à certains types de dégradation, photochimique par exemple, - la solubilité dans l’eau, - la polarité des composés, - le coefficient de partage eau-octanol, - etc. 2. Prélèvement, contraintes particulières, identification des échantillons Cette opération consiste à produire un échantillon destiné au laboratoire qui soit représentatif de l’entité à caractériser. Si les procédures de prélèvement pour obtenir cette représentativité ne sont pas examinées ici, le mode de prélèvement en lui-même ne peut être complètement occulté car il peut déjà faire appel à des protocoles spécifiques destinés à préserver les grandeurs à mesurer. Par exemple, prélever les solutions du sol à l’abri de l’oxygène est une nécessité pour ne pas modifier les équilibres induits par des conditions réductrices. Note : L’obligation de conserver les conditions de milieu peut nous amener à considérer la réalisation in situ des mesures elles-mêmes. Si l’opération s’avère techniquement délicate, il n’en demeure pas moins que la miniaturisation de certaines techniques a déjà permis des progrès importants dans ce domaine. Pour certains analytes, on peut également être amené à stabiliser l’échantillon dès que prélevé. Cela peut se traduire, par exemple, par l’addition d’un volume connu de solvant à un échantillon de sol brut, pour éviter la volatilisation de composés organiques de faibles masses moléculaires4. Le volume d’échantillon brut prélevé peut être conséquent. Dans les cas les plus simples, il peut faire l’objet d’une réduction sur le terrain5 avant d’être transmis au laboratoire. Sinon, c’est dans ce dernier que sera réalisée la réduction. Enfin, il peut être utile de rappeler que le support portant les données d’identification de l’échantillon doit être conçu pour résister aux conditions de transport et de conservation. En règle générale, le demandeur est libre de choisir son mode d’identification dont la nomenclature sera fonction de la taille et de la complexité du programme ou de la campagne d’analyses. Il va cependant de soi que la procédure retenue doit être compatible avec les possibilités du laboratoire et il peut s’avérer nécessaire de consulter ce dernier au préalable. Lorsqu’on envisage la récupération des données analytiques sur une échelle plus large il est nécessaire de se fixer des règles d’identification homogènes. Un exemple de norme existe pour les sols6. Rappelons toutefois qu’un laboratoire accrédité ne peut déroger à des exigences très strictes de confidentialité sans un accord de ses clients et ce, quel que soit le niveau d’intégration des données fournies à un tiers. 4 NF ISO 13877 - Qualité du sol – Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance 5 NF X 31-100 - Qualité des sols – Echantillonnage – Méthode de prélèvement des échantillons de sol 6 NF ISO 15903 – Qualité du sol - Format d’enregistrement des données relatives aux sols et aux sites. 26 3. Conditionnement, transport des échantillons Les critères de choix du récipient destiné à contenir l’échantillon brut relèvent souvent du bon sens : - taille, forme et masse, - résistance mécanique, - étanchéité du système de fermeture, - résistance aux variations de température, - étanchéité à l’humidité, aux échanges gazeux, - disponibilité et coût, - possibilité de réutilisation. Il convient d’éviter les interactions entre le matériau constitutif et l’échantillon. Les principaux problèmes rencontrés sont : - adsorption de l’analyte par les parois, - contamination de l’échantillon par les constituants du récipient, - réaction entre les constituants de l’échantillon et le récipient. Les risques seront d’autant plus importants que la surface de contact entre les parois du récipient et l’échantillon sera élevée. Dans la pratique, pour le dosage des composés organiques, on utilisera plutôt le verre. Lorsque des réactions en présence de lumière sont à craindre, ce dernier sera ambré. Les bouchons seront munis de capuchons en PTFE ou de feuilles d’aluminium. Pour les composés minéraux on utilisera plutôt des polymères neutres comme le PTFE (Polytetrafluoroethylene). Il existe plusieurs qualités de téflon® (PTFE, PFA…) ; à chacune correspond des caractéristiques de surface (adsorption, rugosité...). Les fournisseurs peuvent donner les caractéristiques de ces produits. Certains échantillons peuvent être le siège d’une activité microbiologique plus ou moins intense susceptible de les dénaturer et/ou de modifier les valeurs des grandeurs à mesurer. Dans ces cas, on utilisera le transport à froid pour limiter ces phénomènes : congélation lorsque l’échantillon s’y prête ou température proche de 0°C dans le cas contraire ou lorsque les temps de trajet entre le lieu de prélèvement et le laboratoire sont réduits. Les conditions de transport doivent prendre en compte la sensibilité de l’échantillon à l’écrasement (transport de pêches ou de fraises par exemple). Pour les échantillons fragiles, il est important d’évaluer en plus de la durée du transport les retards possibles (envoi par La Poste, destinataire absent...). 4. Conditions de stockage à l’arrivée au laboratoire On retrouve les mêmes procédures de conservation que précédemment à savoir, maintien à une température proche de 0°C ou congélation lorsque nécessaire. Mais certains échantillons peuvent rester instables dans ces conditions et doivent être analysés ou stabilisés au plus vite selon les méthodes décrites dans la suite du texte. 27 5. Prétraitement de l’échantillon pour laboratoire Par prétraitement on considère ici une succession d’opérations qui peuvent être faites en amont de la déshydratation et du broyage des échantillons ou même directement avant l’analyse lorsque ces deux dernières opérations ne sont pas nécessaires. On peut citer : - la séparation des phases solides et liquides. On peut être amené à procéder à une filtration des solutions pour le dosage des anions suivie d’une acidification pour le dosage des cations. Des réactifs spécifiques peuvent être ajoutés pour la conservation de certains éléments comme le mercure ; - l’élimination de constituants indésirables, consistant, par exemple, en un lavage préalable pour éliminer des dépôts superficiels dans le cas des végétaux. La méthode de lavage ne doit pas être agressive pour le végétal pour ne pas extraire les éléments contenus dans l’échantillon. Les ultrasons par leur action mécanique de surface nettoient sans entamer la surface du végétal. Les surfactants (type triton X) peuvent être utilisés s’ils sont dilués et s’il contiennent des quantités très faibles des éléments à analyser (demander la composition du produit au fournisseur) ; - la réduction d’un échantillon trop volumineux qu’il convient de réduire alors qu’il est à l’état brut. On pourra utiliser la méthode par quartage dont un exemple est donné ci-dessous (figure 1), sachant que dans son principe elle peut s’appliquer à tous les niveaux de la préparation des échantillons et sur des échantillons en uploads/Management/ 25-barbaste63.pdf
Documents similaires








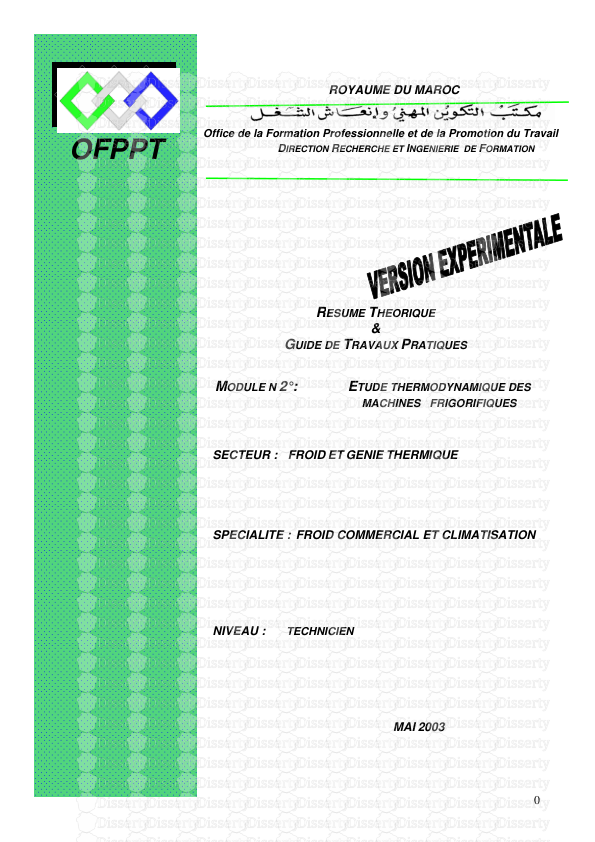

-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.0827MB


