Alain Gignac et Anne Fortin ( dir.) «CHRIST EST MORT POUR NOUS» Études sémiotiq
Alain Gignac et Anne Fortin ( dir.) «CHRIST EST MORT POUR NOUS» Études sémiotiques, féministes et sotériologiques en /'honneur d'Olivette Genest ~ MÉDIASPAUL Th1. a One li l li l llllllll l 11111111111111111111111111 11 111 ~I Z76A-F50-UE3T Les Editions Médiaspa11l remercient le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des Arts d11 Canada et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) pour leur Programme d'aide à l'édition. le présent ouvrage a bénéficié d'une subvention du Fonds Gérard-Dion de l'Université Laval et de la section des éwdes bibliques de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal. Catalogage avant publication de Biblioth~que et Archives Canada Vedette principale au titre: Christ est mort pour nous: études sémiotiques, féministes et sotériologiques en l'honneur d'Olivette Genest Comprend des réf. bibliogr. ISBN 2-89420-632-1 1. Jésus Christ - Passion - Enseignement biblique. 2. Bible. N.T. - Critique, interprétation, etc. 3. Sémiotique. 1. Gignac, Alain, 1964- 11. Fortin, Anne, 1957- Ill. Genest, Olivette. BT431.3.C47 2005 232.96 C2005-940370-5 Composition et mise en page: Médiaspaul illustration de la couverture: Le corps de Jésus remis dans les bras de sa Mère. Icône russe du XlX' siècle. Maquette de la couverture: Studio SG lSBN 2-89420-632-1 Dépôt légal - 2' trimestre 2005 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada © 2005 Médiaspaul 3965, boui. Henri-Bourassa Est Montréal, QC, HIH Ill (Canada) www.mediaspaul.qc.ca mediaspaul@mediaspaul.qc.ca Médiaspaul 48, rue du Four 75006 Paris (France) distribution@mediaspaul.fr Tous droits réservés pour tous les pays. Imprimé au Canada - Printed in Canada 7 PLURALITÉ DES LECTURES DU «CHRIST DE LA PASSION» DE Rm 3, 21-26 Exégèse et herméneutique dans une perspective structurale Daniel Patte La recherche d'Olivette Genest a oscillé entre deux pôles: l'ana- lyse du discours du Nouveau Testament sur la mort de Jésus et celle du discours du Nouveau Testament sur les femmes. La pré- sente contribution pour les mélanges en son honneur se tourne vers le premier pôle pour illustrer la complexité de l'acte herméneutique. En empruntant une partie de mon titre à un de ses ouvrages, je veux signaler tout ce que, personnellement, je lui dois, ainsi que son apport au champ de l'exégèse tout entier. UN ÉCHANGE DÉCISIF L'apport d'Olivette Genest à l'exégèse peut être illustré par une anecdote. Il y a plusieurs décennies, l'auteur du Christ de la Pas- sion1 présentait dans le cadre de la Studiorum Novi Testamenti Societas une conférence analysant le discours de Paul sur la signi- fication de la mort du Christ dans 1 Corinthiens. Les détails de cette 1 O. G ENEST, Le Christ de la Passion. Perspective structurale. Analyse de Marc 14, 53- 15, 47, des parallèles bibliques et extra-bibliques (Recherches Théologie 21 ), Paris-Tournai-Montréal, Desclée-Bellarrnin, 1978. 179 conférence m'échappent, mais sa leçon m'a marqué, car elle engen- dra une discussion passionnée. Un éminent collègue, que je ne nom- merai pas, s'éleva contre l'exposé et les conclusions qu'Olivette Genest venait de tirer de son analyse sémiotique du texte. «Ces conclusions et l'analyse sémiotique ne peuvent pas être valables», dit-il en substance, «parce qu'on sait bien ce que Paul voulait dire par la phrase "Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritu- res".» Mais justement, Olivette Genest venait de démontrer à l'aide de la sémiotique structurale qu'on ne le sait pas. Le sens de ces mots n'est pas le contenu d'un récipient (la phrase) que l'on pour- rait s'approprier comme un objet et verser dans un autre récipient (le commentaire de l'exégète). Puisque le texte est un discours, il a un «effet de sens», comme Greimas nous le répétait. Il faut donc parler de la génération de cet effet de sens, sans cesse rendu plus complexe par son énonciation et par les phénomènes d'intertextualisation qui l'accompagnent. Parler d'un consensus, «on sait bien>>, au sujet de la signification d'un texte, c'est faire de ce texte une lettre morte et mortelle, alors qu'il se propose comme un discours vivant qui donne la vie (voir 2 Co 3, 6). Moment décisif pour moi que cet échange. J'étais déjà initié à la sémiotique structurale, ayant travaillé avec Jean Delorme et Louis Panier au CADIR à Lyon et ayant participé au séminaire de Greimas à L'École des Hautes Études à Paris. J'avais com- mencé à comprendre les différences entre les trois types de struc- tures que l'on trouve dans tout discours et donc dans les lettres de Paul: a) la sémantique fondamentale et narrative d'un texte (et la manière dont le carré sémiotique y fonctionne); b) la syntaxe fondamentale et narrative; etc) leurs discursivisations respectives dans la syntaxe discursive et la sémantique discursive2• Mais jus- qu'alors la théorie sémiotique était pour moi une base sur laquelle, je l'espérais, on pourrait développer une «super-méthode 2 Pour une explication de ces termes techniques, voir d'abord la présentation du «parcours génératif» en forme de tableau dans A.J. G REIMAS et J. CouRT~s, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, p. 160. Une fois que l'on a cette vue d'ensemble, on peut consulter le «dictionnaire» sur chacun de ces termes techniques. 180 exégétique» qui permettrait de rendre compte de la complexité du texte biblique, en englobant la philologie et l'exégèse historique. Une analyse sémiotique établirait l'effet de sens global d'un texte biblique, tel l'épître aux Romains, pour ses énonciataires d'origine, les Romains. Tout cela fait avec l'arrière pensée de pouvoir transposer cet effet de sens pour les lecteurs d'aujourd'hui, ou, ce qui revient au même, de pouvoir dénoncer toute lecture de Ro- mains qui ne serait pas conforme aux résultats de l'analyse sémio- tique. Le conflit des interprétations serait alors résolu, en s'assurant que l'on ait bien une vue complète de la génération du sens. N'était-ce pas ce que Greimas nous montrait avec son mo- dèle du parcours génératif? Voilà où j'en étais avant cette discussion. «Ün sait bien ce que Paul voulait dire ... » «Je ne nie pas ces conclusions de l'exégèse philologique et historique. Mais du point de vue de mon analyse sémiotique, une autre conclusion s'impose.» Voilà, en substance, ce qu'a été la réponse d'Olivette Genest, dans la ligne de son insistance selon laquelle: «Toutes les méthodes ont besoin les unes des autres» et sa reconnaissance des différences fondamentales entre exégèse diachronique et analyse synchroni- que3. Une réponse bien dérangeante pour ma vision des choses, et qui est restée avec moi tout au long des années. J'aurais voulu m'en débarrasser en l'attribuant à une humilité exagérée devant une autorité en exégèse. Mais il fallait bien y voir une marque de sagesse. Quand on se contente de mettre à jour l'une des dimen- sions du texte, on ne peut que conclure que Romains est un dis- cours à sens unique. Cependant quand on prend en compte les divers niveaux de structuration syntaxique, sémantique et discur- sive, toute la richesse du texte et sa polysémie apparaissent. D'un côté, on ne peut plus nier les résultats d'une exégèse historico-cri- tique, même s'ils semblent bien étriqués parce qu'ils ne représen- tent que l'un des niveaux de structuration du texte. De l'autre côté, il faut bien reconnaître qu'en tirant des conclusions d'une analyse 3 Comme elle le dit dans les conclusions de son livre, Le Christ de la Passion, p. 187; voir aussi p. 11-15; 183-185. 181 sémiotique particulière, on formule aussi un sens unique du texte, qui privilégie un autre de ses niveaux de structuration. Une exé- gèse historico-critique et une analyse sémiotique offrent des con- clusions divergentes. Mais ni l'une ni l'autre ne doit être rejetée. Elles sont toutes deux légitimes. Bien plus, même si on ne sait pas encore comment le montrer, on peut aussi envisager la légitimité des interprétations marquées par «émotion et [ ... ] vibration reli- gieuses» que l'analyse sémiotique (et l'exégèse historique) avait écartées4• Il m'a fallu des années pour comprendre les implications de cette leçon. J'en ai retenu trois: a) On peut affirmer tout tranquillement la légitimité de deux in- terprétations qui tirent des conclusions divergentes sur l'enseigne- ment d'un même texte. Il s'agit de reconnaître que toute lecture reflète un choix entre plusieurs «cadrages analytiques» possibles, qui dans le cas des exégèses est mis en évidence par un choix de mé- thodes exégétiques. b) Des raisons tenaces poussent chaque interprète à tenter de démontrer qu'une interprétation est la seule vraie, et donc seule di- gne d'être adoptée par tous les lecteurs du texte. Il s'agit en pre- mier lieu du «cadrage théologico-herméneutique» dans lequel chaque interprète investit en ne mettant que très rarement en danger la lé- gitimité de l'interprétation, malgré ce qu'on pense souvent. c) Une plus ample définition de la responsabilité de l'exégète apparaît quand on reconnaît que chaque interprétation inclut aussi le choix d'un «cadrage contextuel», qui dans le cas des exégèses est le choix d'une pratique exégétique (à ne pas confondre avec le choix d'une méthode analytique). Chacune de ces implications est importante pour notre interpré- tation du Christ de la Passion dans Romains. Je les reprendrai dans les trois sections de mon article. Auparavant cependant, il convient de préciser l'hypothèse uploads/Management/ daniel-patte-pluralite-des-lectures-du-christ-de-la-passion-de-rm-3-21-26.pdf
Documents similaires
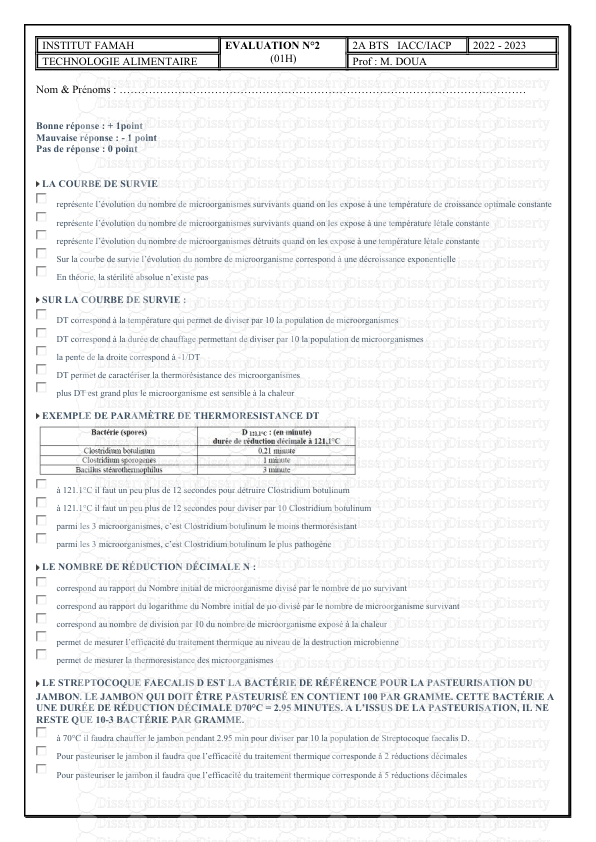









-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 19, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 7.9455MB


