1 Orientation lacanienne III, 4. Jacques-Alain Miller Première séance du Cours
1 Orientation lacanienne III, 4. Jacques-Alain Miller Première séance du Cours 1 (mercredi 14 novembre 2001) I J’ai vu, annoncé partout, le titre de ce cours, qui serait Le désenchantement de la psychanalyse. Première nouvelle. J’ai songé à me laisser suggestionner par la vox populi, mais je reconnais là en définitive plutôt une formule à laquelle je suis arrivé l’an dernier, que je ne renie pas, que je prends volontiers comme appui, mais ce que je vise en ce début d’année est décalé par rapport à cette formule. J’avais employé cette formule pour nommer ce sur quoi débouche le dernier enseignement de Lacan, en tant que, d’une part, il dénude le ressort de fiction de l’expérience analytique, ce qu’il avait déjà nommé le sujet supposé savoir, et, d’autre part, corrélativement, l’enjeu de réel de cette expérience - un réel qui saille d’autant plus qu’il est disjoint du rationnel. Je crois avoir montré l’an dernier que l’enseignement de Lacan ne parvenait pas à ce point sans une inversion du déterminisme porté à l’absolu, qui donnait leur accent propre aux commencements de son enseignement. C’est précisément un accent que nous entendons dans ses propos de Rome, en 1953, des propos que vous pouvez lire maintenant dans le recueil des Autres écrits, pages 143 et 144, quand Lacan définit l’expérience analytique par la conjugaison du particulier et de l’universel et la théorie analytique par la subordination du réel au rationnel - ces termes étant 1 « La transcription de ce Cours a été assurée par Catherine Bonningue, Béatrice Chahtoussi Bernard Cremniter et Gérard Le Roy. » évidemment empruntés à la philosophie, une philosophie bien précise puisqu’il s’agit de celle de Hegel. Et c’est précisément ces propositions qui s’inversent dans son dernier enseignement, qui sont invalidées et comme contredites. Ce à quoi nous avons affaire avec ces dernières indications, c’est bien plutôt, dans l’expérience analytique, à un particulier disjoint de tout universel, un particulier qui ne se laisse pas résorber dans l’universel mais qui est bien plutôt rendu à la singularité, à l’originalité, voire à la bizarrerie, du cas par cas. Et le singulier est d’ailleurs désormais pour nous le statut du cas. Et nous avons aussi affaire, dans ces dernières indications, à un réel détaché du rationnel, et même de toute possibilité de régularité et d’aucun établissement d’une loi. Le désenchantement de la psychanalyse, avec les harmoniques de cette formule, je le laisse volontiers à d’autres. Nommons-les, ces autres, puisqu’il y a dans la psychanalyse quelque chose, une formation, une sédimentation, qui s’appelle l’IPA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sous ce nom, puisqu’en plus elle fait la coquette, elle ne veut pas qu’on l’appelle comme ça, en France - dans le reste du monde ça s’appelle comme ça. C’est un conglomérat de Sociétés de psychanalyse, de groupements de psychanalystes, qui est aujourd’hui bien en peine de se définir. Je pourrais proposer cette définition : “ l’IPA lit pas Lacan ”. C’est une définition qui est tous les jours moins exacte parce que précisément l’IPA est en train de lire Lacan. Ça promet. Ça promet car elle reste marquée par son “ lit pas ” définitionnel. Il n’est donc pas sûr que ça lui fera du bien de passer Lacan à la moulinette de son “ lit pas ”. C’est de ce côté-là, je le dis avec compassion, que l’on éprouve durement le désenchantement de la psychanalyse. Et l’I.P.A., l’IPA, l’éprouve sous les espèces de la fragmentation. C’est un terme qui J.-A. MILLER, Orientation lacanienne III, 4. - Cours n°1 14/011/2001 - 2 revient dans des productions récentes issues de l’IPA, et il m’est arrivé d’y faire référence. Je vous épargne les textes à l’appui qui vous montreraient que ça n’est nullement une interprétation de ma part mais à proprement parler une citation, un ensemble de citations. Le terme de fragmentation, pour caractériser l’état de la psychanalyse, son état théorique, n’est pas un terme que nous puissions adopter. Car ces termes de fragmentation, de morcellement, de dispersion, ne prennent leur sens que de ce qui a été sa croyance à elle, l’IPA, à savoir qu’il existait dans la psychanalyse quelque chose comme une orthodoxie… - [un appariteur présente une feuille à Jacques-Alain Miller ; je signe une feuille de présence ; ça tombe très bien, étant donné qu’à un moment je compte donner, en passant, une valeur éminente à la présence d’esprit] - et que cette orthodoxie c’était elle. Enfin c’est un détail. C’est en fait par rapport au temps révolu de son orthodoxie - il y a encore des gens pour distinguer les lacaniens et les orthodoxes, les lacaniens et les freudiens - qu’elle éprouve le moment présent comme fragmentation. Et le terme traduit la constatation navrée qui se fait de ce côté-là qu’il n’y a plus personne pour eux, et pas eux-mêmes d’abord, qui disent le vrai sur le vrai en psychanalyse. Et dire le vrai sur le vrai en psychanalyse c’était d’abord savoir ce qu’est la psychanalyse et de là ce qui est psychanalyse et ce qui ne l’est pas. C’est un fait que Freud pensait le savoir. Il pensait le savoir et il a été amené à le dire précisément au moment où ça a été mis en question, évidemment, et où ça l’a inquiété, et donc au moment où il a pensé être en mesure de transférer ce savoir - ce qu’est la psychanalyse - à un corps constitué, constitué par lui et ses amis, un corps investi à cette fin, une association internationale dotée d’une énonciation collective. D’où nous sommes, après un siècle d’expérience de la psychanalyse, nous pouvons aller jusqu’à dire que cette initiative de Freud de 1914 a été une erreur. Je ne dis pas l’idée que lui ait pu savoir ce qu’était la psychanalyse, mais en tout cas l’idée de pouvoir transférer ce savoir à une instance dotée d’une énonciation collective. Et l’échec de ce projet de Freud qui était déjà patent pour ceux de l’extérieur, c’est un fait qu’il est aujourd’hui avoué, subjectivé, par ceux de l’intérieur. Il s’ensuit pour eux - comme quelqu’un d’entre eux en a vendu la mèche - un affect dépressif, qui commence à s’avouer. Il serait logique que cet affect dépressif de ceux de l’intérieur soit corrélatif chez ceux de l’extérieur d’un affect maniaque. Et qui serait dû par exemple à ce que nous pourrions avoir le sentiment d’avoir eu encore plus raison que nous ne pouvions le croire. C’est là qu’il faut garder le sens de la mesure et nous interroger précisément sur ce que, dans ce moment de désarroi de ceux qui furent, qui crurent être les représentants de l’orthodoxie psychanalytique, sur ce que, dans ce moment de leur désarroi, nous pouvons enseigner. Eh bien, nous pouvons d’abord enseigner ce que l’expérience d’un siècle de psychanalyse enseigne, à savoir que cette expérience s’est démontrée animée d’une dynamique qui n’a permis en définitive à aucune théorie de la psychanalyse de se stabiliser durablement dans un état d’orthodoxie. En 1914, Freud pouvait penser que l’identité de la psychanalyse était stabilisée. Mais lui-même fut conduit, peu après, à bouleverser les coordonnées de sa théorie en introduisant une seconde topique. Et donc, dans l’œuvre de Freud lui-même, on observe ce débordement de l’expérience par rapport à une formalisation théorique qui était quand même le résultat de l’élaboration même qui avait permis de mettre en place l’expérience. C’est cette seconde topique qui devint le credo de l’orthodoxie qui s’établit alors et dont on peut dire en J.-A. MILLER, Orientation lacanienne III, 4. - Cours n°1 14/011/2001 - 3 effet - c’est ça notre référence quand nous parlons d’orthodoxie analytique - qu’elle régna aux États-Unis de 1940 jusqu’au début des années 70, périodisation que j’emprunte à monsieur Wallerstein, ancien président de l’IPA, et dont l’effondrement progressif, on peut le dire, laisse aujourd’hui nos collègues, et nous- mêmes à travers eux, devant la fragmentation et le morcellement. Mais remarquons que cette orthodoxie fut limitée, fut rongée de l’intérieur, fut animée d’une tension déstabilisante en raison du compromis historique, si je peux employer cette expression, que le centre de l’IPA, le centre hartmannien de l’IPA, fut conduit à passer avec la périphérie kleinienne. Et néanmoins, ce mannequin d’orthodoxie fournit à Lacan le partenaire dont il faut croire qu’il avait besoin pour entamer en 1953 son enseignement et une pratique qui lui valurent, dix ans plus tard, ce qu’il appela une excommunication. Nous disons “ l’enseignement de Lacan ”, et l’expression, ici dans ce cours, est devenue rituelle. Il vaut la peine de l’interroger, cette expression. Pourquoi cette prédilection pour parler de l’enseignement de Lacan ? Sans doute parce qu’elle vaut par ce à quoi elle s’oppose. Nous ne disons pas “ la théorie de Lacan ”. Et nous ne le disons pas parce que nous serions bien en peine de dire la théorie de Lacan. En effet, il n’y a pas de théorie de Lacan. Lacan n’a pas établi avec l’expérience analytique un rapport tel qu’il permette de fixer une uploads/Management/ jacques-alain-miller-le-desenchantement-de-la-psychanalyse-cours-2001-2002.pdf
Documents similaires







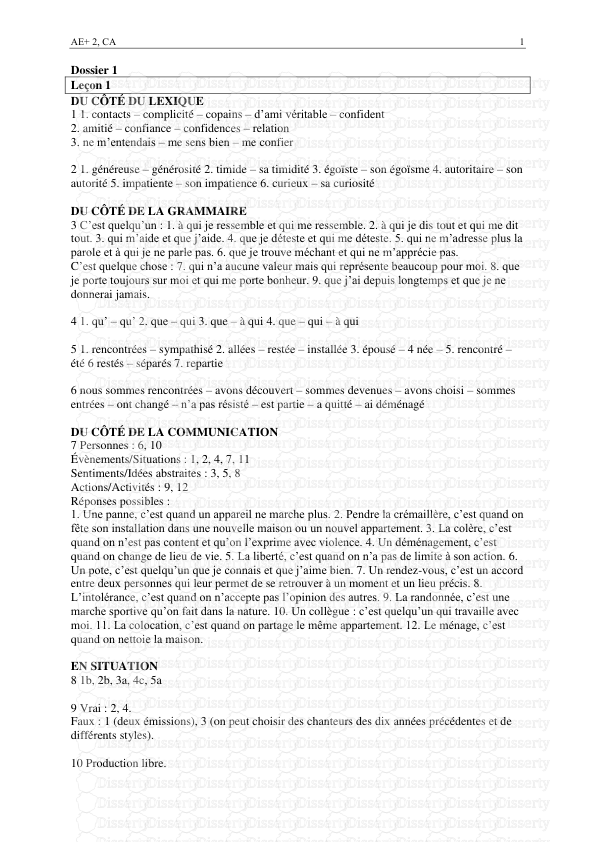


-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 22, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.2089MB


