FEMEN : CARICATURES EN PERFORMANCES. RAILLERIE, SCANDALES ET BLASPHÈME AUTOUR D
FEMEN : CARICATURES EN PERFORMANCES. RAILLERIE, SCANDALES ET BLASPHÈME AUTOUR DU CHRISTIANISME EN RÉGIME DE LAÏCITÉ. Gaspard Salatko NecPlus | « Communication & langages » 2016/1 N° 187 | pages 105 à 120 ISSN 0336-1500 DOI 10.3917/comla.187.0105 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2016-1-page-105.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour NecPlus. © NecPlus. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © NecPlus | Téléchargé le 28/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 190.231.15.181) © NecPlus | Téléchargé le 28/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 190.231.15.181) 105 Lectures de la caricature GASPARD SALATKO Femen : caricatures en performances. Raillerie, scandales et blasphème autour du christianisme en régime de laïcité. À quoi réfèrent les objets qui supportent la présentation des entités du chris- tianisme pour ceux qui les vénèrent et pour ceux qui les caricaturent ? Pour répondre à cette question, cet article entend rendre compte de la façon dont les membres du collectif Femen appuient leurs revendications sur le détournement parodique et controversé des ressources du christianisme. Il s’agit alors de décrire la façon dont ces militantes, par le re- cours à des mises en scène transposées et adaptées du rituel chrétien, enrôlent les images de leurs ennemis aux fins de véhiculer leur propre message. Mots-clés : blasphème, caricature, catholicisme, christianisme, cloche, im- age, icône, iconoclasme, femen, rituel La caricature a fait l’objet de maintes définitions formelles. Encore faut-il considérer que celles-ci ne se sont stabilisées qu’au XXe siècle, avec notamment les travaux de Fris (1938), de Mahon (1947) et de Gombrich (1962)1. Dès lors, mettre en question le genre « caricature », comme le propose Aude Seurrat2, requiert au moins deux préalables qui, dans le cadre de cet article, conduiront à rendre compte de la portée descriptive de la notion au regard des formes contemporaines de parodie, d’iconoclasme et de blasphème qui lui sont étroitement corrélées. D’une part, renoncer à toute acception restreinte du terme image – qui tend à en limiter l’analyse au seul régime d’appréciation visuel3 – afin de recourir à une acception élargie à « tout signe, œuvre 1. Comme l’ont fait apparaître ces auteurs, « on ne peut parler proprement de caricature que si sont satisfaites simultanément trois conditions : il faut que l’intention comique soit perceptible, qu’elle se traduise par la déformation et que celle-ci vise précisément soit un individu, soit un type reconnaissable, ce qui suppose la maîtrise technique des codes graphiques, historiquement constitués, de la ressemblance, ou de la vraisemblance. » (Bernard Vouilloux, « Caricature », in Jacques Morizot & Roger Pouivet, Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Paris, Armand Colin, 2007, p. 72-73). 2. Aude Seurrat, « La mise au jour des médiations à travers l’affaire des caricatures », Communication & langages, 155, 2008, p. 27-38. 3. Marie-Luce Gélard, Olivier Sirost (dir.), « Langages des sens », Communications, 86, 2010. communication & langages – n◦187 – Janvier 2016 © NecPlus | Téléchargé le 28/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 190.231.15.181) © NecPlus | Téléchargé le 28/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 190.231.15.181) 106 Lectures de la caricature d’art, inscription ou peinture servant de médiation pour accéder à autre chose »4. D’autre part, traquer les usages des termes afférents à la notion de caricature, de façon à objectiver les dispositifs sémantiques qui en contraignent l’emploi et lui confèrent moins un intérêt descriptif qu’une portée critique. Il en retourne alors de l’attention portée aux opérations de cadrage, de mise en visibilité et, par là même, de mise en intelligibilité des cours d’actions qui, sujettes à contentieux5, sont constitutives de situations de crise, à comprendre comme autant de conjonctures dans lesquelles « des éléments de niveaux très différents se connectent de façon relativement inhabituelle »6. Pour rendre compte de ces crises, cet article se base sur un travail d’enquête portant sur les actions formulées par le collectif Femen, un groupe d’activistes féministes fondé en Ukraine en 2008 dont les militantes recourent à des formes médiatisées de « mises en scène » qui tendent à parodier la pratique chrétienne7. Que dire des motivations effectives de ces activistes ? Et quelles réactions leurs actions suscitent-elles chez ceux qui, dans des sociétés à principe de laïcité, vénèrent les objets et les symboles religieux ? Les formes de mobilisation qui se constituent en réaction au détournement critique de référents religieux ont été identifiées et documentées pour la religion musulmane. C’est ce qu’illustrent les recherches de Jeanne Favret8 qui, dans la continuité de ses travaux sur l’outrage et sur le blasphème9, s’est proposée d’enquêter sur la crise, de caractère international, suscitée par les caricatures du prophète Mahomet publiées au mois d’août 2005 par le Jyllands-Posten, un quotidien conservateur danois. Mais, par contraste, les affaires constituées autour du christianisme contemporain ont tendanciellement échappé à l’attention des sciences sociales et, plus particulièrement, de l’anthropologie, qui dispose d’un équipement analytique et conceptuel a priori pertinent pour rendre compte des rapports que les groupes humains entretiennent avec des images qui, pour être faites de main d’homme10, n’en sont pas moins sujettes à de singuliers processus d’autonomisation11. Pour reprendre les termes de l’historien David Freedberg, 4. Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches suivi de Iconoclash, Paris, La Découverte, 2009. 5. Jacques Cheyronnaud, « Rire de la religion ? Humour bon enfant et réprobation », Archives de sciences sociales des religions, 34(2), 2006, p. 93-112. 6. Élisabeth Claverie, « La naissance d’une forme politique : l’affaire du Chevalier de la Barre », in Élisabeth Claverie, Jacques Cheyronnaud, Denis Laborde & Philippe Roussin, Critique et affaires de blasphèmes à l’époque des Lumières, Paris, Honoré Champion, 1998. 7. Les données empiriques rassemblées dans ces pages entendent rendre compte des réactions contrastées que suscitent les actions controversées formulées par les membres de ce collectif. Basé sur l’examen du vaste corpus de ressources médiatiques (images, coupures de presses, billets postés sur des réseaux sociaux, témoignages et manifestes de toutes sortes) liées à cette forme singulière d’activisme, ce travail exploratoire a vocation à compléter un programme, en cours de réalisation, d’observation ethnographique portant sur la question des formes politiques d’iconoclastie religieuse. 8. Jeanne Favret-Saada, Comment produire une crise mondiale avec douze petits dessins, Paris, Les prairies ordinaires, 2007. 9. Jeanne Favret-Saada, « Rushdie et compagnie : Préalables à une anthropologie du blasphème », Ethnologie française, 22(3), 1992, p. 251-260 10. Hans Belting, Image et culte, Paris, Cerf, 1998. 11. Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Éditions de Minuit, 1992. communication & langages – n◦187 – Janvier 2016 © NecPlus | Téléchargé le 28/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 190.231.15.181) © NecPlus | Téléchargé le 28/03/2022 sur www.cairn.info (IP: 190.231.15.181) Femen : caricatures en performances 107 les caricatures religieuses, tout comme les icônes qu’elles parodient, seraient-elles de nature à susciter chez ceux qui en font l’expérience des réactions de caractère spectaculaire12 ? Répondre à cette question suppose d’identifier et de distinguer ce à quoi réfèrent les objets qui supportent la présentation des entités du christianisme (cloches, icônes, statues) pour ceux qui les vénèrent, d’une part, et pour ceux qui les parodient, d’autre part. Sous cette perspective, la description des gestes critiques formulés par les membres du collectif Femen permet de rendre compte de la façon dont ces militantes appuient leurs revendications, non seulement sur la destruction, mais aussi sur le détournement parodique ou caricatural d’icônes, de cloches ou de statues qui, d’un point de vue cultuel, tiennent lieu de supports de mise en présence du dieu et des saints chrétiens. L’un des gestes remarquables de ce collectif a consisté en l’abattage à la tronçonneuse, au mois d’août 2012, d’une croix chrétienne monumentale située à Kiev. Les Femen entendaient ainsi manifester publiquement leur soutien aux Pussy Riot, un groupe de musique punk dont les membres avaient été emprisonnées en Russie quelques mois plus tôt pour avoir « profané » l’autel d’une cathédrale moscovite13. La question demeure cependant de comprendre si les visées anticléricales des Femen se limitent à une simple action de destruction volontaire : en effet, de même que la prière parodique formulée par les Pussy Riot, les actions de militantes du collectif Femen n’intègrent-t-elles pas aussi un détournement des gestes d’oraison, et pour ainsi dire des formes de communications extra-mondaines14 caractéristiques du christianisme, ainsi que l’illustrent les séquences filmées de la Femen Inna s’agenouillant et se marquant d’un signe de croix avant de procéder à l’abattage de la croix monumentale ? Sans se limiter à l’examen des « grammaires de la dénonciation » d’où procède l’imputation de blasphème15, l’attention portée au caractère situé de ces crises et de leur uploads/Management/ salatko-2016-femen 1 .pdf
Documents similaires





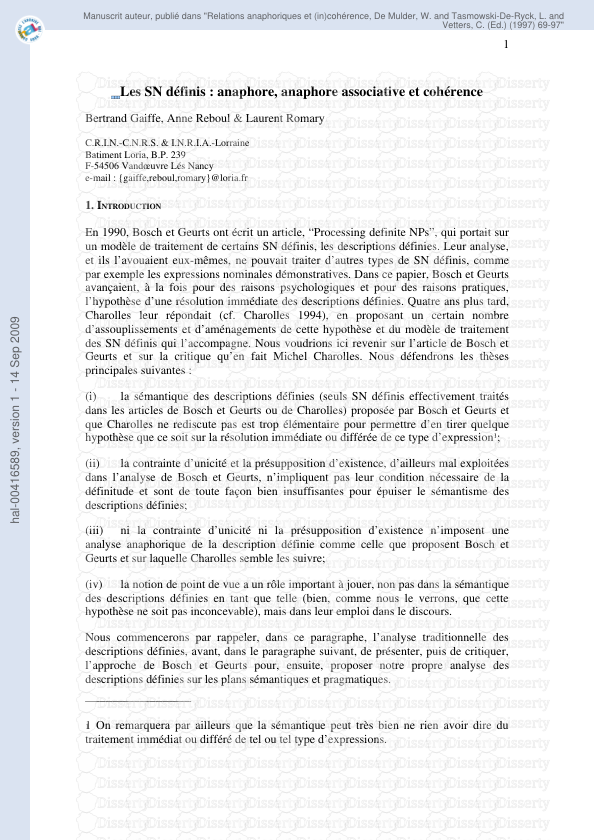




-
21
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.9778MB


