OUVRAGES CITÉS Le lieu de publication est toujours Paris. S : Freud, Abrégé de
OUVRAGES CITÉS Le lieu de publication est toujours Paris. S : Freud, Abrégé de psychanalyse, PUF, 1950. – Cinq Leçons sur la psychanalyse, Payot, 1966. – Cinq Psychanalyses, PUF, 1966. – Essais de psychanalyse, Payot, 1951. – Introduction à la psychanalyse, Payot, 1965. – Ma vie et la psychanalyse, Gallimard, 1968. – Le Mot d’esprit et ses Rapports avec l’inconscient, Gallimard, 1953. – La Technique psychanalytique, PUF, 1967. J. Lacan, Écrits, Seuil, 1966. J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, 1968. ISBN : 978-2-02-112559-7 (ISBN 1re publication : 2-02-004606-7) © 1977, ÉDITIONS DU SEUIL. Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo Cet ouvrage a été numérisé en partenariat avec le Centre National du Livre. A y bien réfléchir, il me semble qu’un historien doit aussi et nécessairement être poète, car seuls les poètes peuvent s’entendre dans cet art qui consiste à raccorder habilement les faits. Novalis Table des matières Couverture Ouvrages cités Copyright Explication du titre 1. La naissance de la sémiotique occidentale LES TRADITIONS PARTICULIÈRES SÉMANTIQUE LOGIQUE RHÉTORIQUE HERMÉNEUTIQUE LA SYNTHÈSE AUGUSTINIENNE DÉFINITION ET DESCRIPTION DU SIGNE CLASSIFICATION DES SIGNES QUELQUES CONCLUSIONS NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 2. Splendeur et misère de la rhétorique 3. Fin de la rhétorique THÉORIE SÉMANTIQUE GÉNÉRALE LES TROPES ET LEUR CLASSIFICATION LA FIGURE, THÉORIE ET CLASSIFICATIONS RÉFLEXIONS FINALES 4. Les infortunes de l’imitation 5. Imitation et motivation 6. La crise romantique NAISSANCE CHOIX DU PRÉTENDANT LA FIN DE L’IMITATION DOCTRINE ROMANTISME SYMPHILOSOPHIE PRODUCTION INTRANSITIVITÉ COHÉRENCE SYNTHÉTISME L’INDICIBLE ATHENAEUM 116 SYMBOLE ET ALLÉGORIE GOETHE SCHELLING AUTRES CREUZER ET SOLGER NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 7. Le langage et ses doubles LE LANGAGE ORIGINEL LE LANGAGE SAUVAGE 8. La rhétorique de Freud ESPRIT DES MOTS – ESPRIT DE LA PENSÉE CONDENSATION, SURDÉTERMINATION, ALLUSION, REPRÉSENTATION INDIRECTE UNIFICATION, DÉPLACEMENT CALEMBOUR, EMPLOI MULTIPLE, DOUBLE SENS L’ÉPARGNE ET LE NON-SENS RHÉTORIQUE ET SYMBOLIQUE DE FREUD 9. Le symbolique chez Saussure 10. La poétique de Jakobson Ouvertures Appendice : Freud sur l’énonciation STRUCTURE PROFONDE DE L’ÉNONCIATION EFFETS TRANSFERT COMME ÉNONCIATION, L’ÉNONCIATION COMME TRANSFERT Explication du titre Le symbole constitue l’objet de ce livre : comme chose, non comme mot. On n’y trouvera pas une histoire du terme « symbole » mais des études consacrées à ceux qui ont réfléchi sur certains faits que, de nos jours, on appelle le plus souvent « symboliques ». Comme, de surcroît, il s’agit la plupart du temps de théories portant sur le symbole verbal, celui-ci sera communément opposé au signe. L’étude des différentes façons de saisir et de définir les faits « symboliques » constitue ce livre ; il n’y a donc pas lieu de poser ici une définition liminaire ; qu’il suffise d’indiquer que l’évocation symbolique vient se greffer sur la signification directe, et que certains usages du langage, telle la poésie, la cultivent plus que d’autres. Cette notion ne peut être étudiée isolément ; et aussi souvent que de symbole il sera question, dans les pages qui suivent, de signe et d’interprétation, d’user et de jouir, de tropes et de figures, d’imitation et de beauté, d’art et de mythologie, de participation et de ressemblance, de condensation et de déplacement, et de quelques autres termes. Si l’on donne au mot « signe » un sens générique par où il englobe celui de symbole (qui dès lors le spécifie), on peut dire que les études sur le symbole relèvent de la théorie générale des signes, ou sémiotique ; et ma propre étude, de l’histoire de la sémiotique. Il faut ajouter aussitôt qu’ici encore, il s’agit de la chose et non du mot. La réflexion sur le signe s’est exercée dans plusieurs traditions distinctes et même isolées, telles que : philosophie du langage, logique, linguistique, sémantique, herméneutique, rhétorique, esthétique, poétique. L’isolement des disciplines, la variété terminologique nous ont fait ignorer l’unité d’une tradition qui est parmi les plus riches de l’histoire occidentale. Je cherche à révéler la continuité de cette tradition, et je ne me préoccupe qu’épisodiquement des auteurs ayant employé le mot « sémiotique ». Théorie est à prendre en un sens lâche ; le mot s’oppose ici à « pratique », plutôt qu’à « réflexion non théorique ». La plupart du temps, les théories dont il sera question ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une science (d’ailleurs inexistante à l’époque), et leur formulation n’a rien du caractère d’une « théorie » au sens strict. L’s du pluriel, ajouté au mot « théorie », est essentiel. Il signifie d’abord qu’il est question de plusieurs descriptions concurrentes des faits symboliques. Mais conjugué à l’absence d’article défini, il indique surtout le caractère partiel de cette recherche : il ne s’agit évidemment pas d’une histoire complète de la sémiotique (ou même d’une de ses parties), il n’est pas question de toutes les théories du symbole, ni peut-être des plus importantes d’entre elles. Ce choix du partiel s’explique autant par un penchant personnel que par une impossibilité quasiment physique : la tradition que j’étudie est si abondante que, pour peu qu’on l’étende à l’Occident plutôt que de la limiter à un seul pays, elle ne peut être connue au cours d’une seule vie humaine. J’ai écrit, dans le meilleur des cas, quelques chapitres de l’histoire de la sémiotique occidentale. N’importe quels chapitres ? Ce serait de l’hypocrisie, ou de la naïveté, que de l’affirmer. En fait ce livre s’organise à partir d’une période de crise, qui est la fin du XVIIIe siècle. Il s’opère à cette époque, dans la réflexion sur le symbole, un changement radical (même s’il est préparé depuis longtemps), entre une conception qui avait dominé l’Occident depuis des siècles, et une autre, que je crois triomphante jusqu’aujourd’hui. Il est donc possible, sur l’espace d’une cinquantaine d’années, de saisir à la fois l’ancienne conception (que j’appelle souvent par commodité « classique ») et la nouvelle, à laquelle je donne le nom de « romantique ». C’est cette condensation de l’histoire sur une période relativement courte qui m’a fait choisir mon point de départ. Ce choix initial explique la composition du livre. Le premier chapitre se situe en dehors de la problématique que je viens d’évoquer ; il se présente plutôt comme une série de pages destinées à un manuel et qui résumeraient le bagage sémiotique commun, tel qu’il s’est trouvé livré à la disposition de tous. Dans ce but, je suis parti d’un moment que je crois privilégié (une autre crise) : la naissance de la sémiotique dans l’œuvre de saint Augustin. Les quatre chapitres suivants explorent différents aspects de la doctrine « classique », dans deux domaines particuliers, rhétorique et esthétique. J’ai laissé de côté l’histoire de l’herméneutique, dont l’étude produit des résultats semblables. Le premier de ces quatre chapitres contient, de plus, un aperçu rapide sur la problématique du livre tout entier. Le chapitre six, le plus long, présente de nouveau une vue d’ensemble synthétique. Il cherche à résumer et à systématiser la nouvelle doctrine, celle qu’engendre la crise ; je la décris dans ce qui m’apparaît comme son lieu d’épanouissement, le romantisme allemand. Les citations sont nombreuses dans ce chapitre comme dans le premier ; j’ai cru utile de soumettre au lecteur les textes mêmes que j’étudie, étant donné qu’ils n’ont jamais été réunis, ni, la plupart du temps, traduits. Sans composer une anthologie, je voulais que ce livre pût aussi être utilisé comme une source de documents. Les quatre chapitres qui suivent concernent essentiellement des auteurs postérieurs à la crise romantique. Mais ce ne sont pas d’autres instances de la même attitude. Choisis parmi les plus influents de notre temps, les auteurs étudiés ici présentent plutôt des variations nouvelles par rapport à la grande dichotomie entre classiques et romantiques, ils occupent des positions qui compliquent le tableau plutôt qu’elles ne l’éclairent. Dans chaque période, j’ai choisi d’étudier le domaine qui me paraissait le plus révélateur ; d’où, sans doute, une impression de discontinuité qui pourrait se dégager à la lecture de ces chapitres. Le premier parle de sémiotique, les deux suivants, de rhétorique ; viennent ensuite trois chapitres consacrés à l’esthétique, les quatre derniers traitant de disciplines qui appartiennent aujourd’hui aux sciences humaines : anthropologie, psychanalyse, linguistique, poétique. Mais révéler l’unité d’une problématique, dissimulée par des traditions et des terminologies divergentes, est précisément l’une des tâches de ce livre. La pluralité des théories examinées donne à ce travail un caractère historique. Je l’aurais volontiers qualifié d’« histoire-fiction », si je n’avais le soupçon que c’est le cas de toute histoire, et que là-dessus mon sentiment coïncide avec la conviction intime de chaque historien. Le fait historique, à première vue pure donnée, se révèle être entièrement construit. Deux partis pris se sont ajoutés, en cours de route, à ce premier constat peut-être inévitable. D’une part, j’ai voulu retracer l’histoire de l’avènement des idées, et non celle de leur première formulation ; les saisir au moment de leur réception plutôt qu’à celui de leur production. De l’autre, je ne crois pas que les idées engendrent seules d’autres idées ; sans aller loin dans des domaines que je connais mal, j’ai voulu indiquer que la mutation uploads/Management/ todorov-tzvetan-theories-du-symbole.pdf
Documents similaires









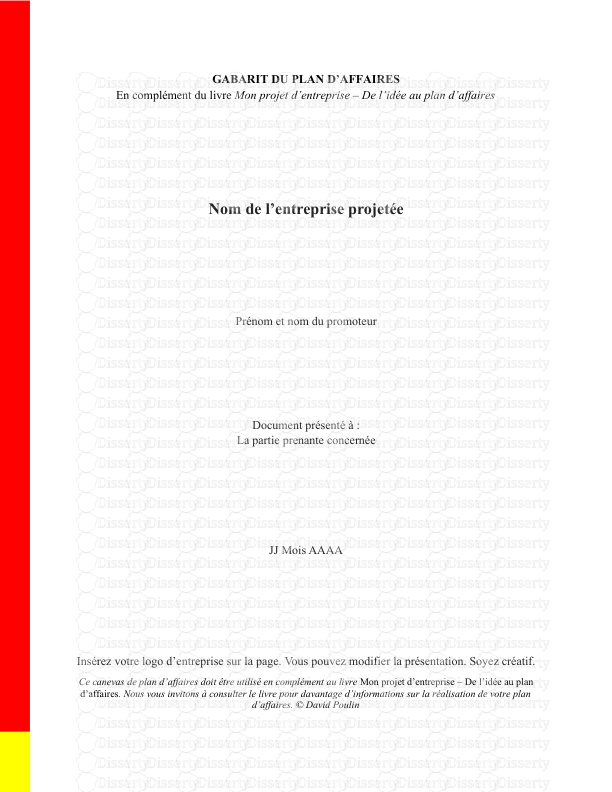
-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 07, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.9662MB


