Aires forestières communautaires conservées dans le Haut Atlas central, Maroc A
Aires forestières communautaires conservées dans le Haut Atlas central, Maroc Abdellah Herzenni Rapport pour le projet “Understanding and Promoting Community Conserved Areas (CCAs) for Conservation of Biodiversity and Sustainable Use of Natural Resources” Décembre 2008 Page 2 Résumé exécutif On peut considérer, au Maroc, les agdals comme des « aires conservées par les communautés locales» ou Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (cfr. Dudley, 2008). Il s‘agit d‘institutions de mise en défens des ressources fondées sur des conditions réglementaires et organisationnelles émanant des communautés en place et répondant aux spécificités locales selon le type d‘écosystème, la nature de la ressource et l‘évolution économique et sociale des communautés. On rencontre dans le pays divers types d‘agdals : les agdals pastoraux d‘altitude, les agdals forestiers, les agdals agro-forestiers et les agdals sur terrains irrigués. La notion d‘agdal est également appliquée aux grands jardins créés dans le passé aux périphéries des grandes villes impériales grâce aux eaux d‘irrigation dérivées des piedmonts et au drainage des eaux souterraines. Il existe peu d‘agdals forestiers, objets de cette étude, en comparaison avec les agdals pastoraux d‘altitude. Néanmoins diverses catégories sont en présence dans les cas observés dans le Haut Atlas central (province d‘Azilal) : les agdals en forêts domaniales délimitées ou non délimitées, les plus courants, soumis à un partage de fait entre les communautés locales, chacune ayant ses propres règles internes de gestion ; les agdals de boisements collectifs non délimités dont le statut collectif a été fixé par la communauté locale sur des bosquets auparavant privés et cédés par les propriétaires pour en faire un agdal de l‘ensemble des familles de la communauté ; les agdals de boisements privés, partagés entre les familles, dans des zones enclavées dont la population a constamment refusé la délimitation des forêts. Dans les cas considérés, il est intéressant de noter la convergence entre les préoccupations de conservation des pouvoirs publics et celles des communautés locales. L‘avantage des agdals est qu‘ils demeurent mieux conservés que les forêts non soumises à l‘agdal, souvent vouées à la surexploitation et à la dégradation. D‘où l‘enjeu majeur de l‘avenir : la forêt dans son ensemble pourra-t-elle atteindre le niveau de conservation observé dans les agdals, ou faut-il s‘attendre à l‘aggravation de l‘évolution tendancielle observée aujourd‘hui? Les principes législatifs et réglementaires essentiels tels que fondés par le dahir du 10 octobre 1917, encore en vigueur aujourd‘hui, reposent essentiellement sur la préservation du patrimoine forestier et sur l‘exploitation productive des forêts. Les dispositions prises depuis le début du XX° siècle référent à ces deux principes tout en reconnaissant des droits d‘usage des populations « riveraines ». Des amendements d‘ordre technique ont été souvent apportés aux divers textes, mais sans changement majeur au niveau des principes. C‘est le dahir du 20 septembre 1976 relatif à la participation de la population à l‘économie forestière qui apporte un début d‘innovation dans les concepts. La loi affirme la domanialité ou la présomption de domanialité sur toute végétation ligneuse et admet explicitement des usages locaux tels que le parcours et le prélèvement de bois « mort gisant », mais c‘est l‘Administration qui se réserve le droit d‘apprécier l‘étendue et les conditions d‘octroi de ces usages aux riverains. Dans les faits, en dépit de leur caractère domanial, les forêts font l‘objet dans plusieurs zones, sauf en agdal, de déprédations diverses et de surexploitation qui conduisent à des pertes en sols et en eau et à la dégradation des écosystèmes. Le texte de 1976 sur la participation des populations au développement de l‘économie forestière n‘a pas connu de décrets d‘application. Il est en fait plus question de la participation des conseils communaux que des populations proprement dites. De nouvelles tendances ont vu le jour ces dernières années dans le cadre de la mise en œuvre de plans et programmes nationaux d‘aménagement et de développement forestier et de projets de développement rural intégré. Ils accordent une grande importance à l‘implication des populations locales, même s‘il n‘est pas spécifiquement question des communautés locales ni de garanties juridiques et institutionnelles de durabilité. Page 3 Les dispositions relatives à la compensation des mises en défens sont d‘un grand intérêt et peuvent être fécondes à plusieurs titres. Elles reconnaissent en fait l‘intérêt vital de la forêt pour les populations usagères, Néanmoins l‘ensemble du dispositif s‘inscrit dans l‘esprit du code forestier, il n‘y a pas de véritable reconnaissance des capacités de prise de responsabilité effective par les communautés. Pour autant une nouvelle dynamique est introduite, susceptible de mener à une gouvernance partagée des ressources. Les toutes récentes propositions relatives aux aires protégées visent une refonte de textes existants en vue de les rendre conformes aux dispositions internationales relatives à la préservation de la biodiversité. Mais il n‘est pas question d‘aire communautaire protégée, c'est-à-dire l‘agdal, alors que la préparation de ces propositions offrait l‘opportunité irremplaçable de reconnaître cette institution et d‘encourager son adoption et son extension, voire sa généralisation. Comme dans le cas de la compensation des mises en défens, la mise en application des dispositions relatives aux aires protégées peut dépendre du degré de volonté d‘implication effective des communautés locales aux divers stades, depuis l‘étape de la négociation et de la concertation jusqu‘à celle de la mise en application de conventions entre l‘ensemble des acteurs concernés. Dans les descriptions des types d‘agdals forestiers en présence, on a fait ressortir leur forte contribution à la conservation des ressources, en comparaison avec les forêts non agdal. En outre de ca, l‘institution de l‘agdal constitue un gage d‘équité entre les membres de la communauté. Les règles de gestion, de contrôle, de prélèvements s‘imposent à tous. Les sanctions sont acceptées par tous. Il y a là un sens de haute responsabilité de type moderne. Un autre trait éminent de l‘agdal, c‘est la flexibilité des règlements internes et leur perfectibilité, reflet de la souplesse d‘un droit local « écologique » adapté aux conditions naturelles locales. Mais la flexibilité peut être aussi l‘expression d‘un équilibre fragile. Rien ne garantit la permanence de la cohésion communautaire qui est sans doute la condition essentielle du respect des règlements internes régissant l‘agdal. Cet équilibre fragile pose la question de la durabilité de l‘agdal. On sait qu‘il s‘agit de situations aujourd‘hui rares et isolées, et qu‘elles dépendent de l‘évolution des moyens d‘existence [livelihoods] : celle de la place de la forêt parmi ces moyens, en liaison avec celle des autre composantes telles que les parcours asylvatiques, les terres de culture, l‘émigration, la force de travail, et en liaison avec l‘ensemble des agents d‘évolution de l‘histoire locale… La comparaison de l‘état des ressources naturelles de l‘agdal et des secteurs hors agdal apporte nombre d‘enseignements. Elle permet d‘appréhender les aspects d‘ordre législatif, réglementaire et institutionnel à adopter dans une optique de gestion partagée durable des ressources forestières par l‘ensemble des acteurs concernés. A l‘amont de ces aspects la reconnaissance de l‘identité sociétale et territoriale des communautés locales est une condition indispensable. La situation ambiguë des massifs forestiers, relevant du domaine privé de l‘Etat mais démembrés de fait, qu‘il s‘agisse des massifs délimités ou non, sans parler des boisements privés, collectifs ou individuels, pose la question des droits de propriété et du régime foncier qui mérite d‘être approfondie et clarifiée. La notion de « domaine privé » de l‘Etat, au même titre d‘ailleurs que celle de « Domaine public », mérite d‘être revue aujourd‘hui dans le contexte de la participation de l‘ensemble des acteurs au développement. La notion de bien commun semble plus adaptée, à condition que ses fondements juridiques et soient précisés et sa faisabilité garantie. Les principes fondateurs de l‘agdal constituent avant tout un modèle susceptible d‘inspirer des engagements de gestion partagée des ressources dans lesquels les communautés locales joueraient un rôle primordial à la mesure de leur savoir, de leur savoir-faire et de leurs capacités organisationnelles et opérationnelles tels que le montrent les cas d‘agdals observés. En partant de ces principes, la communauté internationale devrait confèrer aux communautés locales rurales un statut à la mesure de leur identité propre et de leur rôle fondamental dans la production et la conservation des ressources. Page 4 Executive Summary In Morocco, traditional agdals are examples of what are elsewhere referred to as ―Indigenous and Community Conserves Areas‖ or ICCAs (cfr. Dudley, 2008). They are institutions for the preservation of natural resources based on rules and organizations emanating from the local communities and answering to local specificities such as ecosystem type, nature of the resources and economic and social evolution of the communities themselves. One meets in the country various types of agdals: pastoral agdals in the high grounds, forest agdals, agro-forest agdals and agdals on irrigated grounds. The concept of agdal does also describe the gardens created in the past at the periphery of large imperial cities thanks to irrigation water derived from the piedmonts of from the drainage of local aquifers. In comparison with the pastoral agdals in the high ground, one can find relatively few forest agdals, which are the object of this study. Nevertheless, some types can be distinguished among the cases observed in the uploads/Management/a-voir-agdal.pdf
Documents similaires








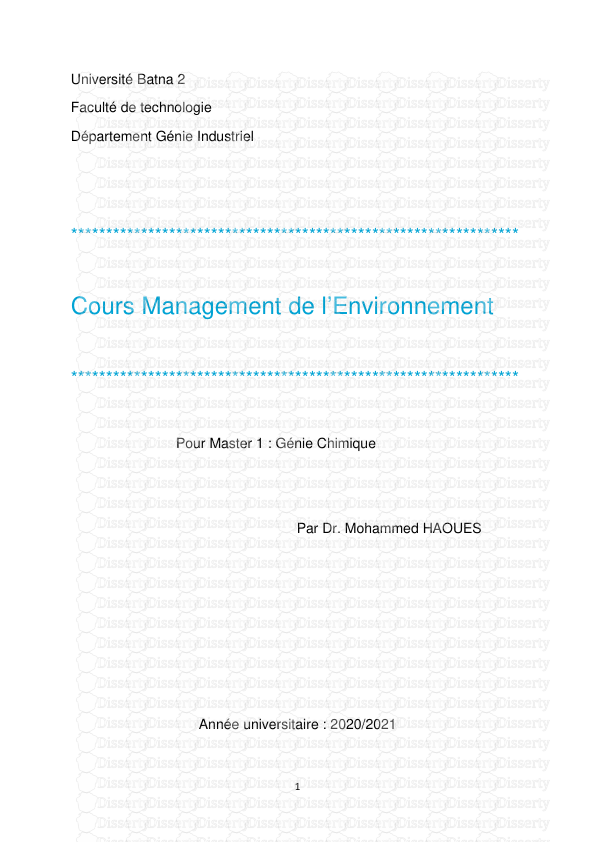

-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 12, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.1518MB


