Cécile Barbet Université de Cambridge – Université de Neuchâtel – Université du
Cécile Barbet Université de Cambridge – Université de Neuchâtel – Université du Littoral – Côte d’Opale & Unité de recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures & l’Interculturel (HLLI – EA 4030) Devoir et pouvoir, des marqueurs modaux ou évidentiels ? 1. INTRODUCTION 1 Virtuellement toutes les positions théoriques sont représentées dans la littérature concernant le lien existant entre la modalité exprimée par devoir et pouvoir et l’évidentialité : traditionnellement, ces verbes sont dits modaux (Sueur 1979, 1983 ; Le Querler 1996, 2001 ; Vetters 2004) ; on les a également décrits comme « mixtes », i.e. évidentio-modaux (Kronning 1996, 2001, 2003) ; ou évidentiels en ce qui concerne leurs emplois épistémiques (Dendale 1994 ; Tasmowski & Den- dale 1994 ; Dendale & De Mulder 1996 ; Desclés & Guentchéva 2001) et, récem- ment, C. Rossari et al. (2007) ont fait de devoir un marqueur fondamentalement évidentiel. Après un bref rappel des différentes interprétations possibles des deux verbes, et des différentes positions théoriques concernant leur caractère modal ou éviden- tiel, nous défendrons l’hypothèse que devoir et pouvoir sont bien des marqueurs modaux et non des évidentiels. Cependant, nous tirerons parti des approches « évidentialisantes » notamment en montrant que le caractère partagé ou non des evidences 2 permet de rendre compte de la différence entre interprétations épistémiques dites subjectives et interprétations épistémiques dites objectives. Dans la littérature, c’est devoir qui a surtout fait l’objet d’analyses en termes d’évidentialité, pouvoir fait un peu figure de parent pauvre à cet égard. La 1. Cette étude bénéficie du soutien du Fond National Suisse pour la recherche scientifique (subside PBNEP1- 134420). 2. Nous garderons dans l’article l’anglais “evidence” dont la traduction en français est mal aisée. LANGUE FRANÇAISE 1 rticle on line rticle on line 1 “04_Barbet_2” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/2/23 — 19:12 — page 1 — #1 i i i i i i i i Modalité et évidentialité en français brèche « évidentielle » ouverte par L. Tasmowski et P. Dendale (1994) et, dans une moindre mesure, par H. Kronning (1996), concernant pouvoir est restée non exploitée. Nous analyserons conjointement dans cet article devoir et pouvoir. De même, ce sont presque exclusivement les marqueurs épistémiques qui ont fait l’objet d’analyses évidentielles ; nous prendrons au sérieux les propositions d’H. Kronning (1996) ou de C. Rossari et al. (2007), qui expliquent également une partie (Kronning) ou la totalité (Rossari et al.) du sémantisme des emplois radicaux en termes d’évidentialité. 2. INTERPRÉTATIONS DE DEVOIR ET POUVOIR Selon le contexte d’emploi, les verbes modaux du français, comme les modaux des autres langues, peuvent recevoir différentes interprétations. On s’accorde ordinairement pour distinguer, sur la base de critères sémantiques et syntaxiques, deux grandes catégories d’interprétations : les radicales et les épistémiques. Les premières communiquent une nécessité ou une possibilité de faire, tandis que les secondes communiquent une nécessité ou une possibilité qu’un état de chose soit le cas. Nous concentrant sur les emplois proprement modaux, nous laissons de côté dans cet article les emplois dits « post-modaux » (van der Auwera & Plun- gian 1998) ou l’emploi aspectuel « sporadique » de pouvoir (Kleiber 1983) qui nécessitent des études spécifiques (Vetters & Barbet 2006 ; Barbet & Vetters 2011 ; Vetters 2007 ; Barbet & Saussure sous presse ; Vetters ce volume). 2.1. Interprétations radicales On distingue différentes interprétations radicales. Ainsi, pouvoir peut exprimer, selon les termes notamment de N. Le Querler (1996, 2001), une capacité (1), une permission (2) ou une possibilité matérielle (3) : (1) En quittant son domicile Dupont n’était pas mort, il pouvait même marcher tant bien que mal – le docteur était forcé de le signaler, pour ne pas être contredit par la gouvernante. (Robbe-Grillet, Les Gommes, 1952) (2) La vieille a demandé si elle pouvait téléphoner. Bien sûr qu’elle pouvait ; le patron lui a indiqué l’appareil accroché au mur. (ibid.) (3) Elle finit par convaincre l’obstination de l’avocat et se retrouva bientôt dans la rue avec le sentiment fort agréable de pouvoir dépenser sans compter et échafauder tous les projets qu’elle voudrait. (Christie, Le Train bleu, 1991) Dans le premier cas, l’origine de la possibilité réside dans les qualités inhérentes du sujet ; dans le deuxième, elle correspond à un être animé humain ou à des lois sociales ou éthiques ; dans le dernier, elle demeure dans les conditions matérielles extérieures au sujet. Devoir radical, quant à lui, peut communiquer ce que H. Kronning (1996) nomme une obligation théorique (4) ou une obligation pratique (5) : 2 “04_Barbet_2” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/2/23 — 19:12 — page 2 — #2 i i i i i i i i ‘Devoir’ et ‘pouvoir’, des marqueurs modaux ou évidentiels ? (4) Ne faut-il pas de toute manière qu’il le retrouve ? Il en a reçu l’ordre. C’est cela qu’il doit faire. (Robbe-Grillet, Les Gommes, 1952) (5) Ils entraient partout pour faire leurs manigances et n’écoutaient même pas ce qu’on leur disait. Elle a dû les observer de près, de peur qu’ils n’emportent quelque chose, car leurs mines n’inspiraient guère confiance. (ibid.) L’obligation pratique se caractérise par sa composante téléologique : devoir établit un lien de nécessité entre une fin et les moyens d’y parvenir (nécessité d’obser- ver de près les visiteurs en (5) pour que rien ne soit volé). L’inférence pratique (Kronning, 1996 : 112-113) dont procède l’interprétation pratique distingue cette dernière de l’obligation théorique, qui est quant à elle le résultat d’une infé- rence théorique (sans composante téléologique, mais avec une prémisse nomique, i.e. une norme sociale, religieuse, légale, morale, etc., Kronning, op. cit. : 34-35). Dans l’optique de H. Kronning, les emplois épistémiques ne sont donc pas les seuls à résulter d’une inférence. Nous développerons infra (§ 4.2), où nous dis- cuterons également la pertinence et la possible application d’une telle analyse « inférentielle » des interprétations radicales à pouvoir. 2.2. Interprétations épistémiques Les emplois épistémiques expriment, quant à eux, qu’un état de choses soit le cas est possible – avec pouvoir – ou probable – avec devoir (6) : (6) D’ailleurs, comme, au bout du compte, une affaire pour laquelle se déran- geaient vingt-cinq ou trente citoyens pouvait et même devait être une affaire importante, il ordonna que ceux qui désiraient lui parler fussent introduits. (Dumas, La Comtesse de Charny, 1990) Nous discutons plus en détails infra (§ 3-4) le lien entre évidentialité inférentielle et modalité épistémique, mais notons déjà qu’étant donné que le locuteur semble poser une éventualité avec pouvoir ou une probabilité avec devoir, au terme d’un raisonnement inférentiel (de type abductif en (6)), certains auteurs considèrent que les emplois épistémiques des modaux sont des emplois fondamentalement évidentiels (inférentiels) et non modaux. Selon notamment H. Kronning (1996, 2001), devoir et pouvoir radicaux expriment, respectivement, une nécessité et une possibilité « de faire être » véridicibles, i.e. justiciables d’une appréciation en termes de vérité ou de fausseté ; tandis que les modaux épistémiques expriment une nécessité ou une possibilité « d’être » non véridicibles, ou “externally inscrutable” 3 chez A. Papafragou (2006) à propos des modaux anglais may et must en emploi épistémique (dit subjectif, § 2.4), c’est-à-dire exprimant une pensée privée en tant que telle et ne pouvant donc pas être questionnée par l’interlocuteur. La différence entre modalité radicale véridicible et modalité épistémique (subjective) non véridicible/externally 3. Soit quelque chose comme « insondable de l’extérieur », mais nous garderons l’expression anglaise. LANGUE FRANÇAISE 1 3 “04_Barbet_2” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/2/23 — 19:12 — page 3 — #3 i i i i i i i i Modalité et évidentialité en français inscrutable explique par exemple qu’un modal épistémique (subjectif), contrai- rement à un modal radical, ne peut se trouver dans les interrogations partielles ou les subordonnées en puisque, dont le contenu est présupposé, donc présenté comme vrai préalablement à l’énonciation (Kronning 1996, 2001), cf. (7) vs (8) : (7) Combien de fruits et légumes doit-on manger par jour pour être en forme ? (8) ??Quel jour devait-il être midi quand tu es arrivé ? 4 D’autres caractéristiques différencient les interprétations épistémiques des radicales 5, cependant seul le caractère véridicible ou non des interprétations sera directement pertinent dans le cadre de cet article. Il justifie également en partie la proposition de H. Kronning de reconnaître une troisième catégorie d’interprétations à devoir. 2.3. Interprétations aléthiques À la bipartition consensuelle, radical vs épistémique, H. Kronning (1996, 2001) ajoute une troisième catégorie d’emplois : l’aléthique. Devoir exprimerait dans ce cas une « nécessité d’être » comme devoir épistémique, mais à la différence de ce dernier, véridicible. De plus, devoir aléthique exprimerait une nécessité « absolue » (Kronning, 2001 : 72), cf. (9), quand devoir épistémique dénoterait, quant à lui, une probabilité. (9) Le langage ainsi défini, il faut chercher quel est le caractère logique général commun à tous les parlers possibles. Ce caractère doit être contenu dans le français même que nous parlons, car il doit imprégner toute phrase, la plus simple comme la plus complexe. (Damourette & Pichon 1911-1940, cités par Kronning 1996 : 115) Tout concourt à susciter l’adhésion en uploads/Marketing/ barbet-devoir-i-pouvoir.pdf
Documents similaires
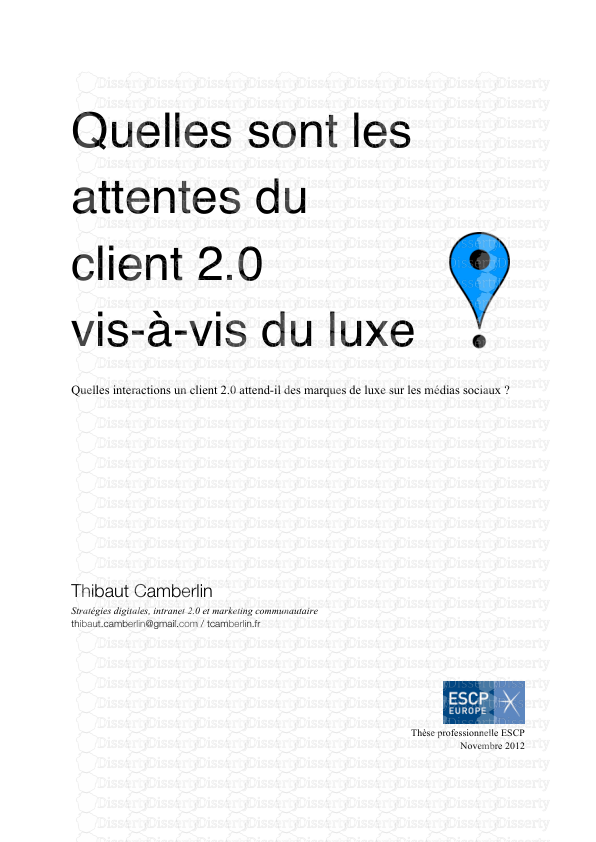









-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 20, 2022
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 0.2911MB


