Page 1 sur 4 Dossier n° 2 – Annexe 1 Bibliothèque de travail – Document 004 Ver
Page 1 sur 4 Dossier n° 2 – Annexe 1 Bibliothèque de travail – Document 004 Version du 27 juillet 2015 Le champ sémantique de « méthode » N.B. : Les entrées signalées par un astérisque (ex. : Méthode*) ont été rédigées par moi (Ch. PUREN) pour le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (sous la coordination de Jean- Pierre CUQ, Paris : ASDIFLE-CLE international, 2003, 304 p.), et publiées dans cet ouvrage. Approche : 1. Méthode utilisée pour initier un travail sur un document ou un domaine (ex. : « approche globale d’un texte »). 2. Discipline ou théorie scientifique auxquelles on emprunte ses outils d’analyse (ex. : « ap- proche anthropologique de la culture »). 3. « Approche communicative » : méthodolo- gie que l’on a souhaité maintenir souple et ouverte (les méthodologues communicati- vistes français ont emprunté le concept an- glais « aproach », celui de « méthodologie » ayant pris à leur yeux une connotation de cohérence fermée, rigide voire dogmatique, avec la méthodologie audiovisuelle). 4. « Ap- proche actionnelle » : voir « perspective ac- tionnelle ». Configuration didactique : ensemble histo- riques cohérent où sont venus historiquement se « configurer » par rapport aux éléments premiers – l’objectif social langagier et/ou l’objectif social culturel en relation avec une situation d’usage de référence – les autres éléments qui sont un agir d’usage, un agir d’apprentissage et une construction méthodo- logique (« méthodologie » sens 2). Cf. « Évo- lution historique des configurations didac- tiques (modèle) », doc. 029. Démarche : Articulation raisonnée de plu- sieurs procédés ou méthodes. Une démarche repérable en compréhension orale d’un dia- logue consistera par exemple, successivement 1) à faire produire par les apprenants des hypothèses sur son contenu à partir d’informations sur l’identité des personnages et de leurs intentions, 2) à faire valider ou invalider ces hypothèses au cours d’une pre- mière écoute, 3) à faire repérer des mots-clés lors d’une deuxième écoute, 4) à faire pro- duire de nouvelles hypothèses à partir de ces mots-clés. « Démarche est parfois utilisé (à tort) dans le sens limité de méthode : « dé- marche active », « démarche inductive ». Méthode Dans la littérature didactique actuelle, le mot « méthode » est utilisé couramment avec trois sens différents, celui de matériel didac- tique (manuel + éléments complémentaires éventuels tels que Livre du maître, cahier d’exercices, enregistrements sonores, cas- settes vidéo,… : on parle ainsi de la « mé- thode » De vive voix ou Archipel), celui de méthodologie (on parle ainsi de la « méthode directe du début du siècle ») enfin celui qu’il possède dans l’expression « méthodes ac- tives », le seul que l’on retiendra ici. Pris dans ce dernier sens, une « méthode » correspond en didactique des langues à l’ensemble des procédés de mise en œuvre d’un principe mé- thodologique unique. La « méthode directe » désigne ainsi tout ce qui permet d’éviter de passer par l’intermédiaire de la langue source (l’image, le geste, la mimique, la définition, la situation, etc.) ; la « méthode active » tout ce qui permet de susciter et maintenir l’activité de l’apprenant, jugée nécessaire à l’apprentissage (choisir des documents inté- ressants, varier les supports et les activités, maintenir une forte « présence physique » en classe, faire s’écouter et s’interroger entre eux les apprenants, etc.). • Exception faite de la méthode interrogative (qui correspond au schéma question de l’enseignant– réponses des apprenants – éva- luation et/ou réaction de la part de l’enseignant), toutes les méthodes apparues depuis un siècle et demi en didactique scolaire des langues peuvent se classer par paires opposées : ce sont les méthodes active et transmissive, directe et indirecte, synthétique et analytique, inductive et déductive, réflexive et répétitive, applicatrice et imitative, onoma- siologique et sémasiologique, orale et écrite, expressive et compréhensive. • Ces méthodes peuvent être reliées entre elles par articulation (succession chrono- logique de deux méthodes différentes, par exemple lorsqu’à un exercice de conceptua- lisation grammaticale – méthode inductive – succède un exercice d’application – méthode déductive –) ou par combinaison (utilisation conjointe de plusieurs méthodes, par exemple des méthodes inductive, active et écrite lors- qu’un enseignant demande aux apprenants de découvrir eux-mêmes la règle de grammaire à partir d’une série de phrases écrites au ta- bleau). Les méthodes opposées ne peuvent bien évidemment être qu’articulées les unes aux autres. Certaines méthodes sont obliga- toirement combinées entre elles (les mé- Page 2 sur 4 thodes intuitive et réflexive, par exemple), d’autres s’attirent naturellement (les mé- thodes répétitive, imitative et orale, par exemple), d’autres enfin sont privilégiées à tel ou tel moment parce que le principe corres- pondant se trouve en position dominante : en didactique scolaire, par exemple, la plupart des formateurs conseillent actuellement aux enseignants débutants de ne pas faire eux- mêmes ce que les apprenants pourraient faire (priorité à la méthode active), de ne pas utili- ser ou faire utiliser la langue source si l’utilisation de la langue cible est possible (priorité à la méthode directe), de présenter de préférence les nouvelles formes linguis- tiques à l’oral (priorité à la méthode orale). • La cohérence de chaque méthodologie cons- tituée (traditionnelle, directe, audio-orale, audiovisuelle…) repose sur un « noyau dur » constitué d’un nombre limité de méthodes privilégiées et fortement articulées et/ou combinées entre elles. Dans la méthodologie directe du début du XXe siècle, par exemple, sont systématiquement privilégiées toutes les activités qui vont amener les apprenants eux- mêmes (méthode active) à parler (méthode orale) directement en langue cible (méthode directe) : les conceptions didactiques ac- tuelles des formateurs cités plus haut repo- sent donc sur le noyau dur de cette méthodo- logie directe, qui s’est maintenu jusqu’à nos jours. Dans la méthodologie audio-orale, on va chercher à ce que les apprenants, de ma- nière intensive (méthode répétitive), repro- duisent des modèles (méthode imitative) de langue orale (méthode orale) : appliquée au dialogue de base, ce noyau dur va générer l’exercice de dramatisation (dans lequel l’apprenant, en jouant le dialogue mémorisé) reproduit l’ensemble de ses modèles), appli- qué à l’enseignement de la grammaire, il gé- nère l’exercice structural. On voit que la mé- thodologie audiovisuelle française est fonda- mentalement éclectique puisque l’on retrouve ces deux noyaux durs dans l’unité didactique : le noyau dur de la méthodologie audio-orale dans la dramatisation des dialogues de base et les exercices structuraux, et le noyau dur de la méthodologie directe dans les activités de passage des dialogues au style indirect et au récit, de description des images, de con- versation sur les personnages et les situations des dialogues. Méthodologie* 1. Utilisé au singulier défini (« la méthodolo- gie »), ce mot désigne, comme « la sociolo- gie » ou « la philosophie » un domaine de réflexion et de construction intellectuelles ainsi que tous les discours qui s’en réclament. Dans le cas qui nous intéresse, il correspond à toutes les manières d’enseigner, d’apprendre et de mettre en relation ces deux processus qui constituent conjointement l’objet de la didactique des langues. On dira ainsi que jusqu’à la fin des années 1960, ce que nous appelons actuellement la « didactique des langues » se réduisait pour l’essentiel à la méthodologie, ou encore que la préoccupation principale de la plupart des enseignants débu- tants porte sur les problèmes méthodolo- giques. 2. Utilisée à l’indéfini et/ou au pluriel (« une méthodologie », « les méthodologies », « des méthodologies », ce mot désigne des cons- tructions méthodologiques d’ensemble histori- quement datées qui se sont efforcées de don- ner des réponses cohérentes, permanentes et universelles à la totalité des questions con- cernant les manières de faire dans les diffé- rents domaines de l’enseignement/- apprentissage des langues (compréhensions écrite et orale, expressions écrite et orale, grammaire, lexique, phonétique, culture), et qui se sont révélées capables de mobiliser pendant au moins plusieurs décennies de nombreux chercheurs, concepteurs de maté- riels didactiques et enseignants s’intéressant à des publics et contextes variés, de sorte qu’elles se sont complexifiées et fragilisées en tant que systèmes en même temps qu’elles se sont généralisées. • Si l’on adopte cette [dernière] définition (destinée à faire un tri aussi nécessaire qu’empirique), on admettra que ne méritent historiquement en France l’appellation de « méthodologie » que la méthodologie tradi- tionnelle dite de « grammaire-traduction » du XIXe siècle, la méthodologie directe des an- nées 1900-1910, la méthodologie audio-orale américaine des années 1950-1960 et la mé- thodologie audiovisuelle des années 1960- 1970 ; que la « méthode Gouin » des années 1880 n’a jamais été une méthodologie, que la « suggestopédie », le « Silent Way » et autres constructions méthodologiques récentes dites « non conventionnelles » n’ont de toute évi- dence pas les moyens d’atteindre ce statut ; enfin qu’il existe deux cas de figure excep- tionnels, celui de la « méthodologie active » dans la didactique scolaire des années 1920- 1960, parce qu’elle s’est voulue d’emblée à la fois cohérente et éclectique, et celui de l’ « approche communicative » des années 1970-1980, parce qu’elle s’est voulue d’emblée uploads/Philosophie/ 004-champ-semantique-methode-annexe1-d2 1 .pdf
Documents similaires






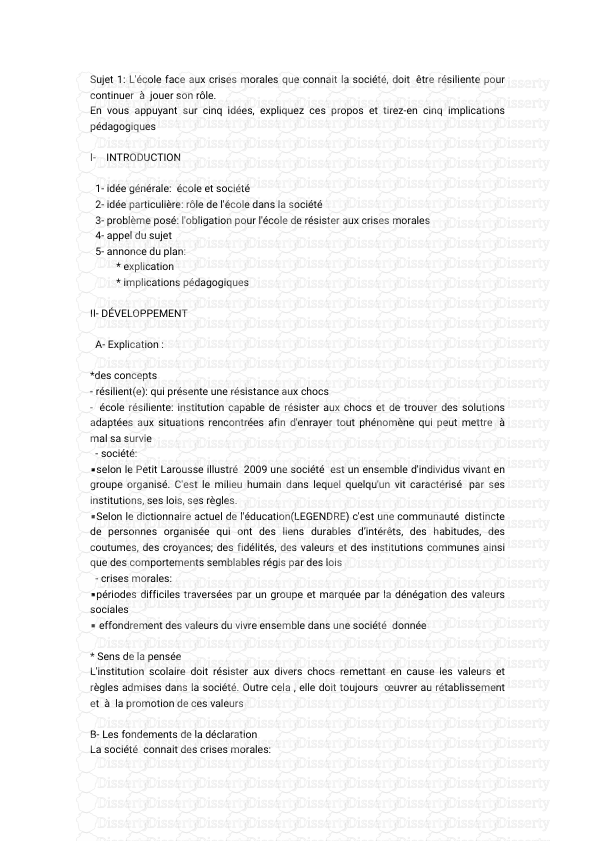



-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 03, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1859MB


