Jean-Baptiste Lamarck PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE 1809 Jean-Baptiste Pierre Antoine
Jean-Baptiste Lamarck PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE 1809 Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck 1er août 1744, Bazentin, Somme, 18 décembre 1829, Paris. PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE 1809 Présentation et notes par André Pichot 1994 Edition réalisée afin de diffusion des connaissances, sans but commercial ni lucratif d’aucune sorte. ©opyrate : Satanic mill, mars 2018. Présentation par André Pichot La Philosophie zoologique passe souvent pour un livre confus. Ce jugement est injuste. Il est vrai que le style de Lamarck est parfois assez relâché ; il est également vrai que l’ouvrage comprend quelques répétitions fastidieuses, et que son plan n’est pas parfait. Mais ces défauts cèdent assez facilement dès qu’on y met un peu de bonne volonté. Les principales difficultés tiennent surtout à ce que Lamarck se réfère à la biologie et à la chimie du XVIIIe siècle, et que celles-ci sont un peu oubliées de nos jours. En effet, bien que ses principaux ouvrages datent du début du XIXe, Lamarck est un homme du XVIIIe siècle (il a 65 ans quand paraît la Philosophie zoologique), et plus spécialement du XVIIIe siècle matérialiste et sensualiste (avec, en arrière-plan, un vague déisme). Pour bien saisir sa démarche et ne pas se méprendre sur ce qu’il écrit, il convient de le replacer dans ce cadre historique. Un autre point important pour comprendre la Philosophie zoologique est de ne pas la limiter à un exposé du transformisme (Lamarck n’emploie ni le mot de transformisme, ni celui d’évolution qui n’avait pas à l’époque le sens que nous lui donnons aujourd’hui). Le transformisme n’occupe, avec la taxonomie, que la première des trois parties de l’ouvrage. Lamarck dit même s’être surtout intéressé aux deuxième et troisième parties, qui sont consacrées, respectivement, à une biologie générale, où sont établies les caractéristiques organisationnelles qui différencient les êtres vivants et les objets inanimés, et à une sorte de psychophysiologie, où la psychologie est présentée dans le prolongement de la biologie grâce aux présupposés évolutionnistes. Le projet de Lamarck était bien plus large que la seule transformation des espèces ; il entendait, par sa Philosophie Lamarck, Philosophie zoologique 2 – zoologique, jeter les bases d’une biologie en tant que science autonome, et d’une psychologie continuant cette biologie ; l’invention du transformisme y est subordonnée. En général, on se borne à lire (ou même à éditer) la première partie, celle consacrée à la classification et au transformisme. Or cette première partie ne peut pas se comprendre sans la deuxième, car le transformisme lamarckien est fondé sur la biologie générale qui y est exposée. C’est là sans doute le plus grave défaut du plan de la Philosophie zoologique ; nous nous efforcerons de le corriger dans notre présentation, en exposant d’abord la biologie générale lamarckienne, et en développant seulement ensuite le transformisme. Quant à la « psycho-physiologie » qui occupe la troisième partie de la Philosophie zoologique, elle poursuit logiquement la biologie générale exposée dans la deuxième partie, et elle sera reprise et développée en 1820 dans le dernier ouvrage de Lamarck, le Système analytique des connaissances positives de l’homme. La biologie avant Lamarck Quelle était la situation des sciences biologiques au XVIIIe siècle ? Elle était fort confuse 1. Jusqu’au XVIIe siècle, hormis quelques courants chimiatriques issus de Paracelse, le paradigme biologico-médical dominant était aristotélico-galénique, c’est-à- dire inspiré de la médecine de Galien, avec quelques restes de la biologie aristotélicienne et quelques apports arabes. Au XVIIe siècle, la révolution scientifique toucha autant la biologie que la physique. Mais, alors que cette révolution perdura en physique grâce à Newton, le mécanisme s’imposa beaucoup moins bien en biologie. La physique de Descartes, si elle fut très vite considérée comme un roman philosophique, avait le mérite de formuler avec 1 Pour un exposé plus détaillé de ces questions d’histoire de la biologie, voir A. Pichot, Histoire de la notion de vie, éd. Gallimard, coll. TEL, Paris, 1993. Présentation par André Pichot – 3 une grande cohérence et une grande clarté les principes de la mécanique fondée par Galilée (ainsi, d’après Alexandre Koyré, la première formulation explicite du principe d’inertie n’est pas due à Galilée, mais à Descartes) ; les corrections qu’y apportèrent Leibniz, Newton et quelques autres n’en modifièrent pas l’esprit, qui resta celui que Galilée et Descartes lui avaient donné. La biologie de Descartes fut, tout aussi rapidement que sa physique, considérée comme un roman philosophique, mais elle ne trouva pas un Leibniz et un Newton pour la corriger (les influences de Leibniz et de Newton en biologie peuvent même être considérées comme plutôt néfastes de ce point de vue). En outre, elle n’avait pas la cohérence de sa physique. Il s’ensuit une très grande confusion au XVIIIe siècle, qui prétend soit améliorer, soit combattre cette biologie cartésienne. C’est finalement Lamarck qui apporta la solution avec sa Philosophie zoologique. La biologie cartésienne était double. Cette dualité n’apparaît pas toujours dans les textes de Descartes lui-même, mais elle ressort très bien du devenir de cette biologie à la fin du XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle. Le premier aspect de la biologie cartésienne, le plus célèbre, est une physiologie qu’on qualifie habituellement de mécaniste, celle de l’animal- machine. Le deuxième aspect de cette biologie, bien moins célèbre, est une explication du développement embryologique ; et cette embryologie s’articule mal avec la physiologie de l’animal-machine. L’animal-machine passa, pendant tout le XVIIIe siècle, pour le paradigme du mécanisme en physiologie. Le corps y est considéré comme un automate hydraulique, constitué de parties solides contenantes et de fluides contenus qui y circulent, sur le modèle de la circulation sanguine découverte par Harvey. Les principales fonctions physiologiques sont expliquées par les mouvements de ces fluides, et par des filtra- tions qui en séparent divers composants. Descartes lui-même dit cependant qu’il n’adopta une telle physiologie qu’en raison de son incapacité à décrire, sur un mode mécaniste, le développement du corps depuis le mélange des Lamarck, Philosophie zoologique 4 – semences jusqu’à l’âge adulte. C’est pourquoi il avait dû partir d’un corps tout formé, et c’est ce corps tout formé qu’il considérait comme une sorte de machine hydraulique. Cette physiologie de l’animal-machine était donc pour lui une « physiologie provisoire ». Étudiée d’un peu près, elle apparaît vite n’être que très partiellement mécaniste. Pour l’élaborer, Descartes a simplement repris les grandes lignes de la physiologie galénique, en se contentant de mécaniser le fonctionnement des organes, sans toucher à l’esprit même de la conception de Galien. Pour Galien, le corps était composé d’organes exerçant diverses fonctions justifiées par leur utilité 2. C’était une sorte de machine fabriquée par la Providence divine du mieux que le permettaient les lois de la matière. Dans cette « machine », les organes ne fonctionnaient pas « mécaniquement », mais grâce à de mystérieuses facultés naturelles. Par exemple, selon Galien, le foie fabriquait le sang à partir des aliments et, pour fabriquer ce sang, il disposait d’une faculté sanguinifique ; ou encore, pour s’accroître, les os transformaient le sang en matière osseuse, et, pour ce faire, disposaient donc d’une faculté ossifique. Il y avait ainsi toute une série de facultés naturelles ad hoc, dont le mode d’action était inconnu (ou occulte). Il n’en reste pas moins vrai que l’organisme selon Galien était déjà une sorte de machine, qui fonctionnait grâce à des facultés naturelles plutôt que selon les lois de la mécanique. Descartes s’en prend aux facultés naturelles (et au diverses âmes héritées de la biologie aristotélicienne), mais il conserve l’idée d’un corps conçu comme un ensemble d’organes exerçant chacun une fonction déterminée, donc un corps-machine. Il se contente de remplacer, dans le fonctionnement des organes, les facultés naturelles par des principes mécaniques (en général, il reprend alors les conceptions que Galien reprochait aux médecins et philosophes atomistes d’utiliser, que ce soit Épicure, Érasistrate ou Asclépiade). La mécanisation est donc seulement locale; elle ne touche que le fonctionnement des organes considérés isolément 2 Pour un exposé plus détaillé de la doctrine de Galien, voir Galien, Œuvres médicales choisies, éd. Gallimard, coll. TEL, Paris, 1994. Présentation par André Pichot – 5 les uns des autres. La conception globale, celle d’un corps- machine composé d’organes ayant chacun une existence justifiée par la fonction qu’il exerce au sein du tout, est conservée. Reste le problème de la construction de cette machine : à un corps considéré comme une machine, une horloge, il faut un horloger. Galien attribuait cette construction à la sagesse omnisciente de la Providence divine. Descartes est plus nuancé. Dans certains cas (par exemple, pour l’espèce de mouvement réflexe qu’il décrit), il dit, comme Galien, que c’est Dieu qui a pourvu le corps de la structure adéquate. En revanche, dans son traité La Description du corps humain, il donne une esquisse d’embryologie, et cette embryologie est quasiment l’inverse de sa physiologie de l’animal- machine. En effet, dans celle-ci, les organes sont donnés tout formés et dotés d’une structure telle qu’ils peuvent exercer leur fonction (en harmonie les uns avec les autres). Dans l’embryologie, c’est la fonction qui est première et qui constitue les organes. Ce qui est rendu possible uploads/Philosophie/ 1809-philosophie-zoologique-jean-baptiste-lamarck.pdf
Documents similaires





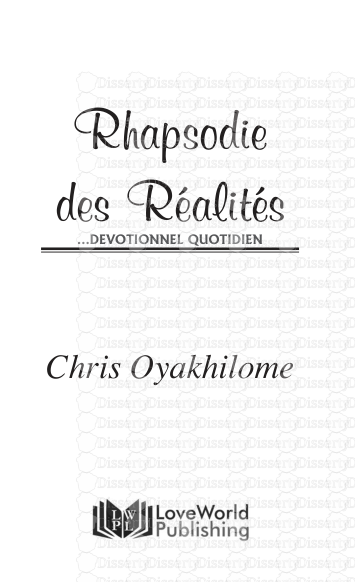




-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 01, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 4.1189MB


