Initiation à la philosophie moderne CTU 2012-13 Descartes et le problème de Die
Initiation à la philosophie moderne CTU 2012-13 Descartes et le problème de Dieu On a souvent en tête une image fausse : un Descartes au mieux théiste1 dont le rôle dans l’histoire de la philosophie aurait été celui du père du rationalisme moderne, avec tout ce que l’on y met d’opposition à l’ordre de la foi. Descartes serait responsable, avec Galilée, du désenchantement du monde puisqu’il promeut l’autonomie du sujet connaissant, sa liberté vis-à-vis des autorités et des dogmes ; sa méthode de doute généralisé qui aboutit à l’instauration du je pense, assorti de sa promotion d’une connaissance inspirée directement de l’évidence mathématique : n’en voilà-t-il pas assez pour faire de lui un philosophe dont on sait qu’il fut croyant, mais qui à l’orée du grand siècle de la logique rationaliste et de la contestation des autorités de droit divin, introduit la rupture indispensable entre foi et raison, entre théologie et philosophie ? Pascal ne s’y trompa pas, d’ailleurs, et on peut relire son œuvre comme une vaste entreprise de relativisation du primat de la raison comme source première de connaissance. Pour Pascal, scientifique encore bien plus que Descartes (dont la liste de ses erreurs dans le domaine des sciences expérimentales est longue2), la connaissance que permet la science appartient au 2e ordre seulement, qui ne sait rien de l’ordre de la charité (cf. Pensées n°308). Pascal craint fort que Descartes, fameusement considéré comme « inutile et incertain » (Pensées n° 887) fasse que l’on se « passe de Dieu » : « Je ne puis pardonner, dit-il, à Descartes ; il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, se pouvoir passer de Dieu ; mais il n’a pu s’empêcher de lui faire donner une chiquenaude, pour mettre le monde en mouvement ; après cela, il n’a plus que faire de Dieu. » (Pensées 1001, propos rapportés par Marguerite Périer3) Il n’est pas question ici de jouer les arbitres entre Descartes et Pascal. Peut-être peut-on dire avec Thibaut Gress4 que l’incompatibilité de la position cartésienne et de celle de Pascal au sujet de Dieu existe car pour ce dernier, la compréhension de Dieu se fait depuis Dieu lui-même, par la Révélation, et pas depuis l’âme comme pour Descartes. Mais revenons à l’expérience fondatrice de Descartes : s’il a voulu, un, jour, tout révoquer en doute et définir une méthode pour bien penser et atteindre la vérité dans les sciences, c’est parce que le jeune élève de la Flèche n’était pas satisfait de l’enseignement scolastique dispensé à son époque. Cette insatisfaction était celle d’un esprit éclairé par un besoin d’une vérité qui soit sûre, alors que les constructions théologico- philosophiques de l’Ecole ne semblaient pas garantir l’accès à la certitude, telle que le démontre notamment la géométrie et plus largement l’évidence mathématique. Le doute qui l’a forcément saisi à ce moment de sa formation, quant à l’assurance d’une vérité scientifique satisfaisante, ne peut-on pas le rapprocher du doute mis en œuvre bien plus tard ? Bien sûr, ces deux doutes sont différents : dans un cas, un questionnement quant à la qualité d’un enseignement, d’une méthode jugée inadéquate et par là, fausse; dans l’autre, la mise hors jeu systématique des anciennes connaissances afin de ne garder que ce qui résisterait à cette opération de tabula rasa. 1 Théisme = croyance en un Dieu dont on affirme l’agir dans les affaires humaines ≠ Déisme : foi en un Dieu sans idée d’intervention 2 5. Parmi ces erreurs : - les tourbillons de matière subtile. - six règles du mouvement (sur sept). - la génération spontanée. - la matière calorique. - le rejet des expériences de Galilée. - la négation de l’attraction terrestre. - la propagation plus rapide des sons aigus. - la propagation des sons aussi rapides dans le sens du vent que contre le vent. - la vitesse de la lumière plus élevée dans le milieu d’indice plus élevé. (cf. http://laconnaissanceouverteetsesennemis.blogspot.fr/2011/10/lviii-philosophie-naissance-du.html) 3 Pascal, Œuvres complètes, Seuil, 1963, p. 640 4 Apprendre à philosopher avec Descartes, Ellipses, 2009 Mais qui ne voit, cependant, que ce qui anime le philosophe mûr correspond bien à ce qui l’avait tant gêné étant jeune ? Descartes cherche la vérité, toujours ; c’est parce qu’il est fondamentalement insatisfait, et en même temps si sûr de lui, qu’il va entreprendre de mettre en œuvre sa méthode, basé sur le doute méthodique. Cette attitude dubitative, donc ce doute, qui le faisait refuser l’enseignement de ses maîtres, il va l’utiliser pour tout refonder et aboutir au cogito. Il ne veut se satisfaire d’aucun à-peu-près dans aucun domaine5. Jeanne Hersch dans son petit livre L’étonnement philosophique insiste sur ce que représentait l’évidence mathématique à l’époque de Descartes : « Nous ne sommes plus guère capables aujourd’hui de revivre en profondeur l’expérience intellectuelle que l’évidence mathématique représentait pour les penseurs de ce temps. Ils admiraient les mathématiques justement parce qu’elles procuraient l’expérience de l’évidence (…) pour Descartes, comme pour d’autres penseurs de son temps, cette clarté de l’évidence faisait partie de la clarté divine. A travers elle, ils s’approchaient du divin. Descartes s’émerveillait de la clarté de la pensée et de la certitude qui en découle. On peut à son propos parler d’un amour, d’une passion pour la certitude. Il décide donc de se mettre à la recherche de la certitude.»6 Descartes mettra longtemps, entre son illumination, ou intuition (de nature religieuse, ne l’oublions pas) de 1619 et ses premiers écrits présentant la mise en œuvre de la méthode qui en découle. Il s’agit donc d’une longue recherche à la poursuite de la clarté de l’évidence. Il faut souligner aussi le courage qu’il lui a fallu pour braver les habitudes de pensée, les autorités scientifiques et religieuses, les pressions (il s’exile en Hollande) qui toutes poussaient à ce qu’il garde pour lui ce qui l’animait. On peut parler sans forcer, pour décrire l’inspiration de son geste philosophique, d’une véritable foi en la vérité, vérité de ce qui le poussait ainsi (il était sûr de lui), et vérité qu’il poursuivait et voulait à tout prix établir (se rappeler la puissance du scepticisme culturel à son époque). L’annonce d’une foi à la racine du doute cartésien peut sembler paradoxale : comment croire et douter en même temps ? Comment parler de foi quand tout, même Dieu, ravalé au niveau du malin génie, est mis en question ? D’abord, ne pas oublier ce qui anime Descartes : retrouver une méthode pour asseoir la connaissance selon la rigueur des mathématiques, dont il admire la puissance et la clarté quasi divines. Ensuite, le doute mis en œuvre n’est « nullement un doute angoissé qui peut s’emparer d’une âme malgré elle. Descartes doute parce qu’il le veut. » (Hersch, p. 138) Comme la foi, « le doute volontaire doit lui permettre de trouver la certitude » (id). Dans la foi, il y a cette quête inquiète mais impérieuse de la vérité absolue (voir saint Augustin). Le doute cartésien jette le philosophe à l’eau, il ne le retient dubitativement pas dans le bateau7. Il s’agit de se laisser couler tout au fond (un geste qui rappelle la mystique), et d’expérimenter si effectivement il y a un fond. On objectera peut-être : mais Descartes ne rencontre pas Dieu, ce qu’il rencontre c’est le je, le moi. Mais notez que ce qu’il dit c’est : je pense, donc je suis. Or l’opération de pensée qui permet d’aboutir à ce résultat, c’est le doute, c’est un « je doute, donc je suis », et ce doute ressemble d’autant plus fortement à de la foi qu’il aboutit à une évidence dont Descartes fait le socle de toutes les autres vérités. Ce développement, qui tend à considérer la méthode de mise en doute des connaissances comme de la foi, n’en fait pas une foi religieuse à strictement parler. Il s’agit davantage d’une foi – si l’on veut garder ce mot - en la raison, mais si (comme Descartes l’aurait dit lui-même8), la raison est en l’homme le reflet de l’intelligence divine, alors que le doute hyperbolique soit décrit comme une sorte d’acte de foi est cohérent avec l’origine même du projet cartésien, dont la source est 5 Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique, Folio essais, 1993, p. 137 6 Idem. 7 Cf. Mat 14,29 et Méditations métaphysiques II,1 8 Mais ce qu’aurait repoussé des penseurs comme Montaigne (« Nous n’avons aucune communication à l’être », Essais II, 12), ou bien des dramaturges comme Shakespeare ou Cervantès, pour qui la raison se renverse en possible folie (cf. JF Pradeau, Histoire de la philosophie, Seuil, 2009, p. 332). l’événement mystérieux de 1619. Un acte de foi est même nécessaire, au vu de la possibilité pour la raison de devenir folle, c'est-à-dire « de produire un système de fictions tellement bien agencé que nous n’ayons aucun moyen de nous en émanciper »9. Il n’y a pas, dans la raison seule, laissée à son seul étiage, assez de force pour la sauver de la déraison. Il est donc exact que le Dieu de Descartes apparaît globalement comme un Dieu utilitariste, uploads/Philosophie/ 9-descartes-et-le-probleme-de-dieu.pdf
Documents similaires







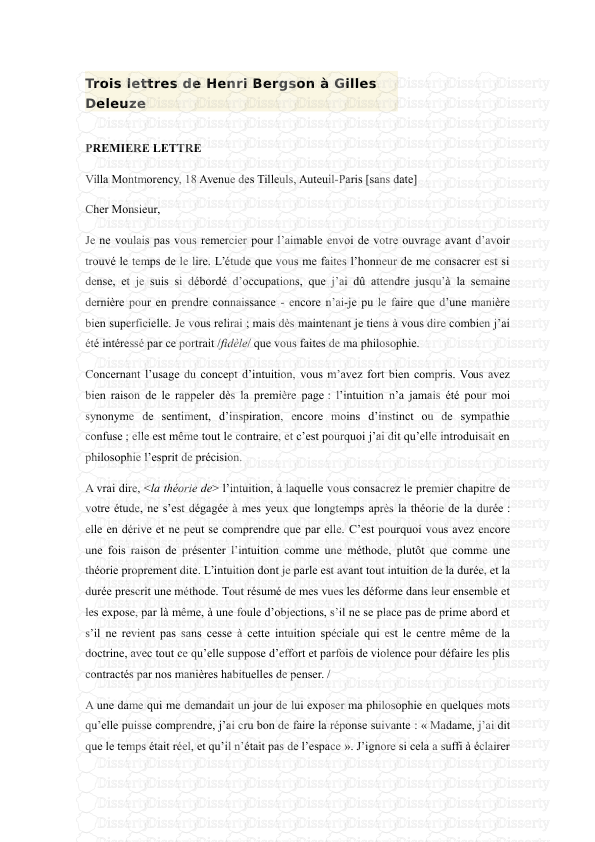


-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 18, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1085MB


