José-Maria Asensio – Jean-Pierre Astolfi – Michel Develay Licence de sciences d
José-Maria Asensio – Jean-Pierre Astolfi – Michel Develay Licence de sciences de l’éducation Apprentissage et didactique Cours 8 7002 TG PA 00 05 Les cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris). Licence de sciences de l’éducation Apprentissage et didactique Cours Rédaction José-Maria Asensio Jean-Pierre Astolfi Michel Develay Coordination pédagogique Thibaut Poupard Directeur de publication Jean-Luc Faure Conception graphique Cned Institut de Poitiers – Futuroscope Impression Fabrègue (87) Table des matières Table des matières T Introduction ....................................................................5 Plan du cours ..................................................................... 5 Conseils généraux ............................................................ 6 Orientation bibliographique ......................................... 7 Chapitre 1 État des lieux : le fonctionnement standard de la « forme scolaire » .............................................9 1. La forme scolaire et ses origines ........................... 10 2. « Métier d’élève » et coutume didactique ......... 11 2A. Métier d’élève et vie scolaire ............................ 11 2B. Métier d’élève et moment des apprentissages 19 3. Le bas « niveau taxonomique » des activités scolaires ........................................................................ 22 4. Le « rapport au savoir » et ses processus différenciateurs .......................................................... 24 4A. Approche psychologique .................................... 25 4B. Approche sociologique ....................................... 30 4C. Approche épistémologique ................................ 33 Chapitre 2 39 Apprendre, avec toutes ses variables ...............39 1. Apprendre, entre complexité et paradoxes ....... 40 1A. Les variables-leviers de l’apprentissage (avec leurs contrepoints) ............................................ 40 1B. Les variables-freins de l’apprentissage (avec leurs contrepoints) ............................................ 46 1C. La motivation : un concept à construire .......... 49 1D. Le paradoxe de l’apprentissage ......................... 55 2.La différenciation pédagogique ............................. 57 2A. La diversité des styles cognitifs .......................... 57 2B. L’éducabilité cognitive ......................................... 61 Chapitre 3 67 Le savoir, dans tous ses états ...............................67 1. Trois termes à contraster : information, connaissance, savoir ................................................. 68 1A. L’information ....................................................... 68 1B. La connaissance ................................................... 68 1C. Le savoir ............................................................... 69 2. Concepts et disciplines ............................................. 70 2A. Des notions aux concepts .................................. 70 2B. Les disciplines scolaires et leurs composantes . 71 2C. Les matrices disciplinaires et leur cohérence ... 72 3. Disciplines et interdisciplinarité ........................... 73 3A. La pluridisciplinarité ............................................ 73 3B. L’interdisciplinarité ............................................... 74 3C. La transdisciplinarité ........................................... 74 Chapitre 4 77 Enseigner, par tous ses modèles .........................77 1. Trois modèles et leur usage fl exible .................... 78 1A. Le modèle de la transmission ............................ 78 1B. Le modèle du conditionnement ........................ 80 1C. Le modèle constructiviste ................................. 81 1D. Vers des modèles composites ............................ 83 2. Les référents théoriques de l’enseignant ........... 85 2A. Quelques concepts-clés pour construire des séquences ............................................................. 85 2B. Piaget, Bachelard, Vygotski ..............................105 3. Didactique et pédagogie .......................................110 Corrigés des exercices ...........................................113 Chapitre 1 .......................................................................113 Chapitre 2 .......................................................................117 Chapitre 3 .......................................................................123 Chapitre 4 .......................................................................127 8 7002 TG PA 00 5 Introduction Plan du cours Ce cours, intitulé « Apprentissages et didactiques », a été rédigé par José Maria Asensio, professeur à l’université autonome de Barcelone, Jean-Pierre Astolfi , professeur à l’université de Rouen et Michel Develay, professeur à l’université Lumière, Lyon 2. État des lieux : le fonctionnement standard de la « forme scolaire » Nous débuterons par une présentation, à tonalité critique, du fonctionnement « standard » de la forme scolaire actuelle. Le but n’est en aucun cas de dénigrer tout ce qui se passe dans les écoles et établissements concernant les apprentissages, mais de relever des points problématiques susceptibles d’amélioration. La rapidité des évolutions sociales et économiques conduit la société à être de plus en plus exigeante vis-à-vis de l’école et, en un sens, il est même rassurant de pouvoir identifi er des « gains » encore possibles en termes de modalités d’enseignement. Nous rappellerons ici les origines de la « forme scolaire » actuelle, comme lieu séparé des appren- tissages au regard de l’expérience quotidienne et de l’univers familial ou professionnel. Seront notamment évoquées les notions récentes de « métier d’élève » et de « rapport au savoir », avec les processus différenciateurs que nous relèverons. Puis, nous détaillerons successivement les trois pôles du « triangle pédagogique et didactique », lequel relie au sein d’un même système l’apprenant, le savoir et l’enseignant. Apprendre, avec toutes ses variables Le « pôle Apprendre » détaille la complexité des processus qui sont à charge de l’apprenant, auquel nul ne pourra se substituer. Il faut noter – comme une curiosité porteuse de sens en français, da- vantage que dans d’autres langues – le fait qu’on puisse dire que le maître apprend des notions à l’élève... alors qu’il ne peut que les enseigner ! C’est l’élève (ou le formé) qui apprend, et nous en préciserons les mécanismes diversifi és, en nous attardant un peu sur le concept de motivation, tant caricaturé par ses usages quotidiens. Nous insisterons sur le fait qu’à la complexité s’ajoute souvent le paradoxe, car toute variable posi- tive (l’intérêt, la coopération...) peut facilement inverser son effet, quand une variable négative (le milieu socio-familial ou les aléas de l’histoire personnelle) ne sont jamais des déterminismes absolus. Nous ajouterons à ces considérations générales sur l’apprendre des éléments précis concernant la diversité des styles cognitifs individuels et la nécessité pédagogique d’en tenir compte. Et nous conclurons sur l’importance de l’éducabilité cognitive, dans la mesure où c’est là une posture essentielle de l’enseignant pour favoriser la réussite, même si cela ne suffi t jamais à la garantir. Le savoir, dans tous ses états Mais à trop se centrer sur l’élève, on risquerait d’en oublier le « pôle Savoir », qui est pourtant la raison d’être première de l’école. Bien sûr, celle-ci vise aussi d’autres objectifs de formation, de so- cialisation, de citoyenneté, etc., mais ces derniers ne doivent pas venir en compétition avec le savoir, encore moins en substitution. L’école est d’abord un lieu conçu par la société pour « programmer » la rencontre avec des savoirs jugés désirables pour tous, sans les laisser soumis à l’aléatoire des parcours individuels. 8 7002 TG PA 00 6 Introduction Nous distinguerons trois termes souvent confondus, que nous avons nommés information, connais- sance et savoir, en précisant leurs caractéristiques contrastées. Il ne s’agit bien sûr pas de défi nitions formelles, car peu nous importent les étiquettes, mais de repérer trois statuts théoriques différents pour les savoirs scolaires, dont nous tirerons les conséquences très concrètes sur l’effi cacité des enseignements. Nous insisterons alors sur les notions essentielles de « disciplines » et de « concepts », souvent mal compris des élèves mais aussi des enseignants, parce que conçus comme un simple découpage de la connaissance quand ils en sont les pôles organisateurs. S’ensuivra naturellement une réfl exion sur les signifi cations de l’« interdisciplinarité ». Enseigner, par tous ses modèles Il sera alors temps d’en venir au « pôle Enseigner », qui tirera les conséquences des développe- ments précédents, tout en ajoutant des points de vue spécifi ques. Après avoir défi ni trois modèles pédagogiques de référence qui donnent sens aux pratiques, nous présenterons un ensemble de concepts-clés (notamment ceux issus des recherches en didactique), qui permettent de fonder ce qu’on nomme aujourd’hui des pédagogies constructivistes. En nous appuyant sur une diversité d’auteurs, nous évoquerons successivement les conceptions alternatives et les obstacles épistémo- logiques, les confl its socio-cognitifs, la zone proximale, l’étayage et le format de l’apprentissage format de l’apprentissage format , de l’apprentissage, de l’apprentissage enfi n la métacognition, le transfert et la médiation. Nous recentrerons ensuite la réfl exion sur les apports majeurs mais divergents de Jean Piaget, Gaston Bachelard et Lev Vygotski, en proposant une façon de les mettre en perspective, sans les amalgamer. Mais nous conclurons pourtant, malgré la puissance de telles fi gures tutélaires, sur le caractère irréductible de la pédagogie par rapport aux sciences voisines, sur lesquelles elle s’appuie sans jamais s’y confondre. C’est là une condition essentielle pour qu’elle reste un « métier de l’hu- main » et puisse se professionnaliser davantage. Conseils généraux Comment travailler ? Ce cours a été conçu pour permettre votre travail personnel à un rythme individualisé. Avant d’en entreprendre la lecture, ainsi qu’en cours de lecture, réfl échissez aux modalités favorables à l’ap- prentissage. Travaillez de préférence par grandes plages horaires, afi n d’avoir le temps d’examiner un chapitre entier. Ne vous limitez pas à une lecture linéaire et séquentielle, car la compréhension d’un texte suppose que vous vous en construisiez une vue d’ensemble et que vous en dégagiez les mots-clés. Les exercices proposés au fi l des pages sont également destinés à vous permettre de revenir sur votre lecture, pour mieux assimiler le cours. Pensez à prendre des notes, cherchez la signifi cation des mots qui ne vous sont pas familiers, et plus généralement accompagnez votre lecture de diverses uploads/Philosophie/ apprentissage-et-didactique-pdf.pdf
Documents similaires




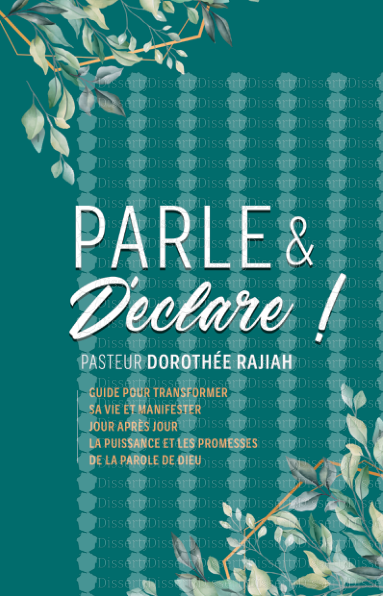





-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 18, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1264MB


