Groupe de recherche et d’étude sur les transformations sociales et économiques
Groupe de recherche et d’étude sur les transformations sociales et économiques CAHIERS DU GRÉTSÉ NO14 La causalité dans la Théorie générale de John Maynard Keynes Ianik Marcil Département des sciences économiques Université du Québec à Montréal GRETSÉ Groupe de recherche et d’étude sur les transformations sociales et économiques Novembre 1993 La causalité dans la Théorie générale de John Maynard Keynes IANIK MARCIL* «[O]ur ordinary description of nature, and the idea of exact laws, rests on the assumption that it is possible to observe the phenomena without appreciably influencing them. [...] The law of causality, because of its very nature, can only be defined for isolated system, and in atomic physics even approximately isolated systems cannot be observed.» Werner Heisenberg1. Spinoza2. Le père de John Maynard Keynes, John Neville, écrivait dans son célèbre ouvrage de méthodologie: (J. N. Keynes, 1890, 176). C’est également, du reste, l’avis de beaucoup de scientifiques de toutes disciplines, dont l’économique. Par contre, d’aucuns semblent croire que le principe de causalité a été évacué du discours théorique de la science économique ou même de la physique3. Ce problème de la causalité a pourtant une pérennité dans l’histoire de la science et de la philosophie que peu de questions ont l’honneur d’avoir. D’Aristote à Russell ou Wittgenstein en passant par Hume, il présente une difficulté épistémologique des plus aiguës. Nous allons ici nous intéresser au traitement que Keynes fait de la causalité dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), et de l’utilité que cette question peut avoir dans la compréhension des débats économiques contemporains. Mais, comme son approche n’est ni claire ni * Département des sciences économiques, Université du Québec à Montréal. Je remercie Gilles Dostaler et Claude Fortin, pour leurs commentaires sur des versions préliminaires de ce travail. 1. (1930), in James R. Newman (1956, t. 1, 1029 et 1031). 2. L’éthique (1677†), in Œuvres complètes, Paris: Gallimard (Pléiade), 1954, 350. 3. Par exemple, Paulré (1985, 11) pour l’économique, et Russell (1912-13, 1) pour la physique. I. Marcil La causalité dans la Théorie générale de J.M. Keynes 2 explicite dans ce volume, nous devrons visiter d’autres textes. Nous allons d’abord examiner les thèses développées par Keynes au sujet de la causalité, prise en général. Ces idées se trouvent précisées à deux endroits: dans un manuscrit important de sa jeunesse, non encore publié, rapporté par divers auteurs4, et dans une note contenue dans son Treatise on probability (1921). Nous mettrons ces concepts en rapport avec ceux élaborés par les intellectuels proches de Keynes lors de sa formation mathématique et philosophique au début du siècle, particulièrement George Edward Moore, qui eut sur le futur théoricien de l’économie, comme on le sait, une influence déterminante. C’est après cet examen que nous pourrons étudier avec plus de détails le ‘contenu causal’ de la Théorie générale. Nous serons alors en mesure de voir, comme du reste de nombreux ouvrages et articles l’ont montré depuis quelques années5, que l’étude des conceptions logiques ou mathématiques de la probabilité et de la causalité sont une des clefs de lecture les plus utile pour comprendre la Théorie générale, et pour en apprécier la structure complexe. Après ce tour d’horizon de la Théorie générale, nous étudierons brièvement quelles autres conceptions de la causalité les économistes ont mises de l’avant ces récentes années. L’examen de ces débats, souvent forts abstraits et limités à l’économétrie, nous aidera à faire ressortir les particularités et similitudes entre les idées de Keynes et celles de ses adversaires et disciples sur cette question. Dans la dernière partie de notre travail, en conclusion, nous essaierons de voir qu’elles pourraient être les leçons à tirer des conceptions élaborées par Keynes sur le principe de causalité liant les divers concepts mis en place dans la Théorie générale, à la fois pour éclairer ces débats contemporains et pour mieux comprendre l’œuvre même de Keynes. 4. Par Anna Carabelli particulièrement, qui mentionne un ensemble de notes manuscrites réunies sous le titre Induction, causation and hypothesis, comprennant deux notes ayant pour titre et ; ces manuscrits dateraient de 1905-06, environ, et faisaient partie du fonds de la Marshall Library, à Cambridge, maintenant déménagé à la King’s College Library (Carabelli, 1985, 154; 1988, 91-2, 305). 5. Entre autres, les volumes suivants: Bateman et Davis (1991), Crabtree et Thirwall (1980), Carabelli (1988), Lawson (1985), Mini (1991), O’Donnell (1989), O’Donnell (1991) et Vercelli (1991). I. Marcil La causalité dans la Théorie générale de J.M. Keynes 3 I Des travaux d’érudition récents ont mis en lumière la grande richesse et l’importance fondamentale des écrits philosophiques et méthodologiques de Keynes pour la compréhension des fondements de sa théorie économique. L’étude des conceptions de la causalité chez Keynes sera éclairée par l’examen du Treatise on probability (Keynes, 1921) et d’un texte posthume important de 1938, (id., 1938). Le Treatise, mal connu des économiste jusqu’à une époque récente, est une œuvre fondamentale dans l’histoire de la philosophie des mathématiques et de la probabilité6. Écrit en 1921, il a été réédité plusieurs fois et traduit en allemand7. Si son importance fut grande pour les mathématiques et la philosophie, elle ne le fut pas moins pour son auteur. En effet, Keynes y travailla sur une période d’environ quinze ans (de 1905 à 1921); à cet égard, le travail sur les questions de probabilité nécessita au moins autant d’énergie que celui sur la Théorie générale. Tout le Treatise s’articule autour d’une conception ‘épistémologique’ ou cognitive de la probabilité. Keynes, dans son ouvrage, distingue la probabilité logique, qui est l’objet de son étude, de la probabilité ‘scientifique’ (Lawson, 1985, 117), conception courante appliquée au monde réel. Toutefois, la relation de probabilité keynésienne demeure à mi-chemin entre la proposition subjective (où la probabilité d’un événement n’est que le produit de l’intellect de l’agent) et la proposition objective (où la probabilité d’un événement est un fait de la nature, de la chose observée). L’observation du monde extérieur est nécessaire à la construction 6. Sa position dans les Collected writings est significative: bien que les éditeurs aient voulu conserver un ordre chronologique pour les livres publiés par Keynes (tomes 1 à 7), le Treatise (vol. 8) paraît après la Théorie générale (vol. 7), alors que l’ordre chronologique aurait nécessité qu’il fusse placé entre les volumes 2 et 3. Une mesure de l’importance de Keynes dans l’histoire des mathématiques est la présence d’un extrait du Treatise (précisément le chap. 26) dans une grande anthologie universelle des 133 textes mathématiques les plus significatifs, en quatre volumes et 2500 pages, parue en 1956 et rééditée en 1988 (Newman 1956, vol. 2, 1339-51). 7. Le Treatise a été édité en 1921, 1929, 1951, 1952, en Angletterre, et en 1921, 1950, 1962 et 1979 aux États-Unis. Une traduction allemande est parue en 1926, sous le titre Über Wahrscheinlichkeit, chez Johann Ambrosius Barth, à Leipzig, trad. de F. M. Urban. Une traduction japonaise était annoncée en 1989, à Tokyo, chez Toyo Keizai Shinpo-sha (Keynes, Collected writings, v. XXX, 1989, 32-3). I. Marcil La causalité dans la Théorie générale de J.M. Keynes 4 d’une proposition de probabilité, mais l’action de l’agent sur cette observation l’est tout autant. Nous pouvons penser dès lors que la conception de la causalité keynésienne sera reliée à ces idées, la situant entre celles de David Hume et John Stuart Mill. En effet, les positions de ces deux grands philosophes (qui ont, comme on le sait, influencé profondément la pensée économique) s’opposent dans leur conceptions de la causalité, dans la dialectique subjectif/objectif; Mill (1843) se distinguait de Hume (1748), en proposant une représentation objective de la causalité, indépendante de l’agent, alors que la conception, révolutionnaire, de Hume mettait de l’avant une théorie parfaitement subjective de la causalité, cette relation étant issue de l’habitude de l’agent à observer la coexistence récurrente de certains événements. Anna Carabelli (1985, 151) explique cette tension par le rejet de l’empiricisme et du rationalisme par Keynes, entre Mill et Hume, illustré par un . Les idées keynésiennes sur la probabilité ne peuvent se comprendre qu’à partir des concepts de ‘niveau des connaissances disponible’, de ‘conception subjective du monde extérieur’ par les agents, et de ‘conviction rationnelle’ (rational belief). En effet, la probabilité keynésienne est un argument relationnel logique entre des propositions (il ne s’agit donc pas d’un lien ontologique, mais bien d’un lien formel, logique). Keynes spécifie que ce lien s’établit entre des propositions, et non pas entre des événements (1921, 5). De là, cette conception de l’esprit est fonction du niveau des connaissances disponible au moment de la production de la relation logique. Une relation de probabilité simple se décrit comme suit: l’agent dispose d’un ensemble de propositions h comme prémisses, et d’un ensemble de propositions a comme conclusion, alors la connaissance de h justifie une ‘croyance rationnelle’ dans a, de degré α, nous pouvons dire qu’il y a une relation de probabilité (probability-relation) de degré α entre a et h8 (Keynes, 1921, 4). Cette croyance rationnelle est donc l’acte subjectif de l’agent dans la construction de la probabilité établie entre les propositions (tout en uploads/Philosophie/ causalite-dans-la-theorie-generale-de-keynes-29p-pdf.pdf
Documents similaires







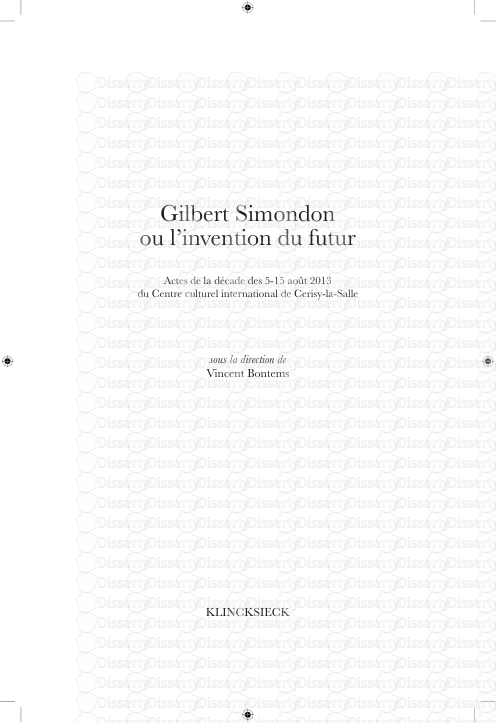


-
93
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 16, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0779MB


