1 Introduction : l’épistémologie sociale de Pierre Bourdieu FABRICE CLÉMENT A p
1 Introduction : l’épistémologie sociale de Pierre Bourdieu FABRICE CLÉMENT A paraître dans F. Clément, F. Schultheis, M. Roca & M. Berclaz (eds), L’inconscient académique, Genève / Zürich : Seismo. 2 Penser en porte-à-faux Les murs prestigieux du Collège de France rappelaient-ils trop à Pierre Bourdieu ceux de l’internat de Pau où, jeune interne, il découvrit les «nécessités de la lutte pour la vie: l’opportunisme, la servilité, la délation, la trahison, etc.»? (Bourdieu 2004: 117) C’est ce qu’on pourrait croire en relisant sa conférence inaugurale où, une fois de plus, il se sent contraint par une « force supérieure » de dévoiler l’arbitraire de l’institution qu’il est censé encensé (ibid. p. 138). Cette « envie de dissidence », cette tentation « de casser le jeu » chaque fois que des signes de soumission sont attendus de lui, Bourdieu les doit en partie à ce désenchantement des anciens pensionnaires qui, à dix ans, savent tout de la société (Bourdieu & Wacquant 1992). Il les doit également à ce sourire un peu ironique (qu’il reconnut chez son maître Canguilhem) que son pays natal ramenait sur son visage lorsque le monde académique « faisait son spectacle ». Ce même Béarn qui lui avait appris « par corps » la « vertu de rétivité », glorifiée par toute la tradition locale (Bourdieu 2004: 116). Pris entre deux mondes, habité par un « habitus clivé », Bourdieu était certes bien « placé » pour garder sur le monde académique un regard distancé et critique. Mais rien ne pouvait laisser présager l’ampleur et le caractère radical de l’oeuvre à venir du jeune philosophe qui, après un éprouvant et dessillant séjour en Algérie, se plongea dans la sociologie. L’art (1965, 1966, 1992), l’école (1964, 1970, 1984, 1989), ou encore le langage (1982) et l’état (1973, 1981, 2000) sont autant d’institutions à qui il fit perdre leur majuscule grâce à l’observation détaillée des mécanismes qui participent à leur naturalisation, à cette impression «d’aller de soi» dont il si difficile de se déprendre. Tout au long de ce travail de dévoilement, Pierre Bourdieu et son équipe s’attachèrent à mettre au coeur de l’analyse les éléments du paysage social devenus invisibles à force d’être familiers, révélant au passage l’oubli de la nature profondément politique des principes de catégorisation avec lequel le monde social se « donne » à nous. Ce travail de mise à distance critique de évidences du monde social s’est accompagné d’une réflexion théorique qui, par bien des aspects, rejoint les ambitions du jeune philosophe qu’il a été. C’est notamment le cas de sa remarquable théorie de l’action qui, en s’opposant aussi bien au subjectivisme sartrien qu’à l’objectivisme structuraliste, propose de mettre au coeur de l’analyse du comportement social l’habitus, « système de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes » (1980, p. 88; 1994). Système de croyances « faites corps », le sens pratique est ainsi « sens du jeu », immersion dans un système de règles — objectives — qui préexistent à l’agent et qui définissent ainsi un jeu dans lequel on est né et que l’on ignore 3 — phénoménologiquement — en tant que tel. Les concepts développés par Bourdieu, tels ceux d’ « habitus », de « champ », d’ « illusio » ou encore de « capital symbolique », permettent ainsi de mieux comprendre jusqu’à quel point les structures sociales imbibent les strates psychiques qui constituent ce que les sujets considèrent comme étant du domaine de leur intimité (Bourdieu 1979). Tels les galets dont les cercles finissent pas rejoindre les rives de l’étang, la portée théorique de l’analyse de Bourdieu a fini par rejoindre la pratique scientifique elle-même. Il y a en effet beaucoup à gagner dans l’application de la méthode sociologique au champ scientifique; les sciences, et les sciences humaines en particulier, constituent un jeu qui est marqué par un type particulier d’illusio, par des hiérarchies et des tenus pour vrai spécifiques à la pratique académique. Un tel champ structure, le plus souvent à leur insu, les discours des participants, comme Bourdieu en avait déjà proposé une impressionnante démonstration dans Homo Academicus. Cette volonté de mieux comprendre les déterminations qui pèsent sur les producteurs d’objectivité rapproche en fait Bourdieu des ambitions originelles de la sociologie, telles qu’elles étaient énoncées par Emile Durkheim: fonder un savoir objectif sur la connaissance des mécanismes sociaux qui déterminent la manière dont le monde se présente « naturellement » à nos yeux. Vers un intellectuel collectif Dans les Formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim avait pour but de montrer que les catégories de l’entendement, qui sont « comme les cadres solides qui enserrent la pensée » (p.13), ne sont pas être recherchées en nous, mais hors de nous (27). Dans le cas des peuplades primitives, ces catégories fondamentales de l’entendement, indispensables outils de la vie en commun, pénètrent l’esprit des hommes au cours de cérémonies rituelles qui auraient précisément pour fonction de rendre disponibles ces cadres de pensée aux membres de la communauté (Rawls 1996). Certes, Bourdieu ne vise pas à prouver que les catégories qui sont au fondement de la métaphysique occidentale depuis Aristote sont, stricto sensus, de nature sociale. Par contre, il montre que la manière dont les disciplines scientifiques découpent le monde, le soupèsent et l’analysent repose sur des schèmes cognitifs si profondément intégrés par les savants durant leur période de formation qu’ils en deviennent invisibles. Cet héritage, acquis lors d’une longue initiation scolaire, varie selon les époques et les endroits, formant autant de « transcendentaux historiques » (2000) qui ont en commun de ne pouvoir être perçus que de l’extérieur, par des observateurs étrangers aux pratiques de découpage du réel et d’administration de la preuve accomplies d’un commun - et silencieux - accord. Les systèmes de schèmes cognitifs qui sont au principe de la construction d’une réalité disciplinaire 4 constituent ainsi un véritable « inconscient académique » que les disciplines scientifiques, qui visent in fine à la vérité, ont un intérêt de principe à illuminer. Bourdieu a très tôt mis l’accent sur l’aveuglement à considérer qu’une discipline pourrait échapper à un enracinement dans un temps, un lieu et une structure de pouvoir spécifiques. Le texte que nous reproduisons ici, « Système d’enseignement et système de pensée », publié initialement en 1967 déjà, contient les jalons essentiels de sa sociologie de la connaissance. A la religion se substitue l’institution qui, selon Bourdieu, transmet aujourd’hui les « formes élémentaires de la classification »: l’École (Bourdieu, ce volume). C’est en effet la culture scolaire qui, de manière inégale, « dote les individus dote les individus d’un corps commun de catégories de pensée qui rendent possible la communication » (ibid.). Ce sont les programmes scolaires qui dotent les individus d’un programme homogène de perception, de pensée et d’action au sein d’un « entraînement » de longue haleine qui, dans le domaine des disciplines scientifiques, passent par l’acquisition pratique de paradigmes, d’exemples exemplaires, métonymies de manières de faire et de penser propres à la communauté (Kuhn 1983; Polanyi 1967). Cette causalité souterraine ne laisse personne indemne, même ceux qui se pense au- dessus de telles contingences. Pierre Bourdieu l’a admirablement montré dans sa magistrale lecture du « cas Heidegger », où il démontrait combien la pensée du philosophe allemand s’inscrit dans un champ de pouvoir, un Zeitgeist et un champ philosophique où son habitus d’universitaire de première génération constituait un tel impetus que sa trajectoire, au sein de l’espace des possibles de l’époque, l’amena à proposer une « révolution conservatrice » en philosophie (1988). Cette critique de l’illusion de la toute puissance de la pensée a amené Bourdieu a régulièrement prendre à parti une philosophie par trop imbue d’universel, jusqu’à ses incontournables Méditations pascaliennes (1997). Vers la fin de sa vie, son questionnement s’orienta de plus en plus vers l’élaboration d’une méthode capable d’apporter aux sciences, et aux sciences humaines en particulier, un éclairage réflexif susceptible de les amener à mettre au jour les impensés qui orientent leurs enquêtes. Mais comment mettre à jour des schèmes cognitifs qui, par définition, sont inconscients et donc inaccessibles à l’analyse réflexive? Comment avoir prise sur ces automatismes de la pensée qui « peuvent régir et régler les opérations intellectuelles sans être consciemment appréhendés et maîtrisés » (ce volume)? Malgré un exercice courageux et exigeant effectué sur lui-même dans son Esquisse pour une socio-analyse, Bourdieu, filant la métaphore de l’inconscient, en conclut que la « psychanalyse » des sciences humaines ne peut que s’effectuer à plusieurs, dans un ballet dont les mouvements sont encore à déterminer. L’art est difficile tant la distance entre les observateurs de ceux qui ont pour métier d’objectiver doit être calculée avec justesse. Que 5 leurs mondes de référence diffèrent de trop, et l’incompréhension sera de mise car les enjeux seront incommensurables; la quête des uns paraîtra futile, et leur passion incompréhensible, aux yeux d’un analyste trop extérieur au jeu. Mais que les enjeux soient trop similaires et l’on court le risque de trop bien se comprendre, laissant dans l’ombre de grandes uploads/Philosophie/ clement-2007.pdf
Documents similaires






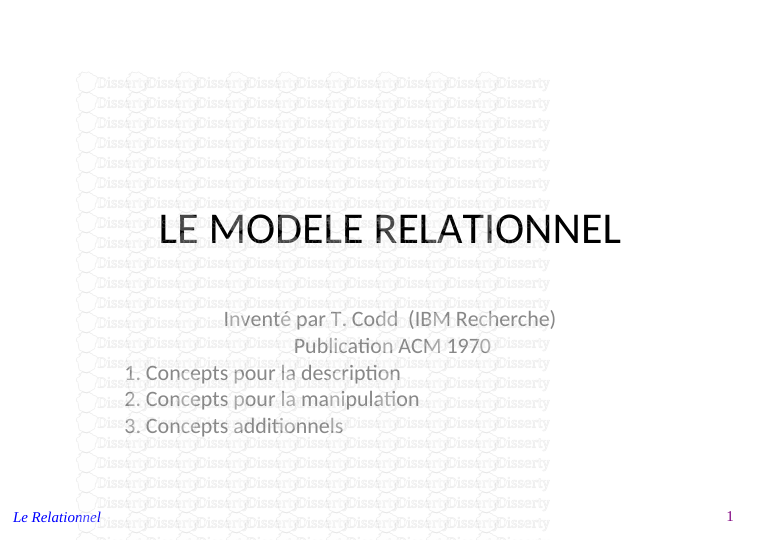



-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 05, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1363MB


