Commentaire de Bachelard, MR, Introd. XII Page 1 sur 15 Vers le milieu du XXe s
Commentaire de Bachelard, MR, Introd. XII Page 1 sur 15 Vers le milieu du XXe siècle, Gaston Bachelard publie son ultime ouvrage épistémologique : Le matérialisme rationnel. Dans la dernière partie de l’Introduction intitulée « Phénoménologie et matérialité », il annonce la thèse qu’il va développer dans le prolongement de ses travaux antérieurs : depuis sa constitution scientifique au XVIIIe siècle dont A. Lavoisier est habituellement tenu pour un héraut, la chimie a connu une nouvelle révolution par laquelle elle définit désormais un « matérialisme rationnel ». Déjà en 1940, Bachelard a ainsi pensé ce qu’il appelle alors « les prodromes d’une chimie non-lavoisienne. »1 Désormais, le « matérialisme rationnel » est situé globalement de plain-pied avec le « nouvel esprit scientifique » que, dès la fin des années 1920, Bachelard attribue en physique aux effets de la « mécanique non-newtonienne » ou « révolution einsteinienne ».2 A l’inverse du « matérialisme naïf » attribué à la connaissance commune, que la Conclusion du livre confronte à la connaissance scientifique, la chimie physique s’oriente depuis la seconde moitié du XIXe siècle vers un « matérialisme instruit ». C’est une science renouvelée et réorganisée, voire recommencée. Son rationalisme est proprement un « rationalisme appliqué »3 en ceci qu’il est inséparable de la technicité des méthodes caractérisant l’intense socialisation de la raison scientifique moderne. La technique mise en œuvre par « l’union des travailleurs de la preuve »4 interagit constamment avec la technique proprement dite, laquelle lui apporte à la fois ses modèles, ses résultats et ses problèmes, et à laquelle elle soumet réciproquement les siens. En 1951, dans L’Activité rationaliste de la physique contemporaine, Bachelard a déjà fourni l’exemple, appartenant à toute la pensée scientifique du XXe siècle, d’une telle « dialectique » entre expérimentation et rationalisation. Ici, dans le sillage d’un livre plus ancien sur Le pluralisme cohérent de la chimie moderne (1932), prenant appui sur la « dialectique » spécifique à celle-ci, 1 Voir La Philosophie du non, PUF, 1940, chap. III. Prenant pour archétype du « non » en science le cas historique des géométries non-euclidiennes du XIXe siècle, Bachelard indique (III, V) : « une chimie non-lavoisienne, comme toutes -les activités scientifiques de la philosophie du non, ne méconnaît pas l'utilité ancienne et actuelle de la chimie classique. Elle ne tend qu'à organiser une chimie plus générale, une panchimie, comme la pangéométrie tend à donner le plan de toutes les possibilités d'organisation géométrique. » 2 Voir Le Nouvel esprit scientifique, PUF, 1934. 3 Le rationalisme appliqué, PUF, 1949. 4 Ibid., chap. III. Commentaire de Bachelard, MR, Introd. XII Page 2 sur 15 Bachelard oppose au postulat d’unité —qui serait l’exigence du philosophe— le travail pluralisant qu’exerce la communauté des chimistes, moins pour accroître les connaissances par accumulation, moins encore pour les réduire à la simplicité d’un principe purement spéculatif, que pour les enrichir en les ordonnant et en les complexifiant. Dans la lignée constante de l’épistémologie bachelardienne, sont ainsi étudiés les rapports d’une part entre science et philosophie, d’autre part entre unité, pluralité, et complexité. Moyennant quoi sont questionnés l’histoire de la pensée et de la recherche, les attitudes, méthodes et procédés intellectuels, ainsi que les « obstacles épistémologiques » —illusions des images premières, métaphores et analogies précipitées, conscientes et inconscientes— auxquels doit s’affronter le savoir.5 Telle est la trame sur laquelle est posé ce que Bachelard nomme le « problème de l’unité de la matière ». * Ce problème est présenté en propre comme étant celui des « philosophes », sans guère de précision : c’est « l'esprit philosophique traditionnel » qui voudrait trouver l’origine de la cohérence des doctrines « du côté de l'unité de matière. » C’est ce problème « qui a tant préoccupé les philosophes », et dont le progrès de la science, en montrant au contraire qu’il se pose en des termes sans cesse différents, doit permettre à chaque génération de comprendre qu’il était mal posé par la précédente. La « simplicité », dont la perte hante la nostalgie du philosophe au regard de ces progrès, désigne la même notion ou le même idéal ; ce qui le conduit à se poser « ces “grands problèmes” de l'unité de l'être » sur lesquels la science n’aurait rien à lui apprendre. De là viendrait une déception devant « la pauvreté philosophique de la pensée scientifique. » Que dire de cette caractérisation de l’esprit philosophique, du problème qui serait le sien, et de sa manière de le poser, eu égard à l’esprit scientifique ? On notera d’abord l’oscillation des termes même dans lesquels ils sont présentés : on passe de l’unité de la matière à l’unité de l’être, en passant par la simplicité. En l’absence d’exemples, des perspectives qu’ouvre l’histoire des doctrines philosophiques peuvent éclairer la recherche du sens de ces caractérisations. Au premier chef, la perspective que propose Aristote (IVe s. av. 5 Voir La Formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1938. Commentaire de Bachelard, MR, Introd. XII Page 3 sur 15 notre ère) dans le livre A de la Métaphysique sur la base d’une histoire de la recherche menée par ses prédécesseurs en vue de savoir au juste « ce qui est », ou « ce qu’est l’être » (ti to on). Elle permet, au moins, de comprendre pourquoi Bachelard passe si aisément du « problème de l’unité de la matière » aux « grandes questions de l’être. » Le point de départ en sont les philosophes dits Présocratiques, et leurs diverses réponses, qui sont monistes en ceci que leur recherche porte sur une unique cause première (ou principe unique) de toutes les choses. Ainsi, la réponse des tenants de la seule cause matérielle : « Ceux qui les premiers ont philosophé pensèrent, pour la plupart, que dans l’idée de matière se trouvent les uniques principes de toute chose (tas en hulès eidei monas … archas… pantôn.) »6 Aristote indique ce qui fonde rationnellement cette position qu’on peut appeler (bien avant la lettre) matérialiste : « ce à partir de quoi tous les êtres sont primordialement engendrés et en quoi finalement ils périssent, tandis que demeure la substance (ousia) affectée de changements, c’est ça qu’ils appellent l’élément (stoïchéion) et le principe (archè) qui sont les leurs ; car ils ont par-là l’idée que rien n’est engendré ni rien ne périt, puisque cette nature (phusis) qui est la leur se conserve toujours. »7 Ce qu’Aristote tient ainsi pour « l’axiome commun » des premiers philosophes, revient à affirmer abstraitement que rien ne vient de rien et, réciproquement, que rien n’est anéanti.8 Mais qu’est-ce qui est ainsi éternellement ? Parmi les premiers philosophes, figurent ceux qu’Aristote appelle les « naturalistes » (phusikoi), au premier chef les Présocratiques qui n’admettent qu’un seul élément : l’eau comme Thalès, l’air comme Anaximène, le feu comme Héraclite, la terre comme d’autres. Mais l’élémentarisme ancien se heurte aussitôt au problème que pose le rapport entre l’un et le multiple : comment d’un seul élément inférer la pluralité de ses manifestations ? ; et réciproquement : comment réduire la pluralité des qualités sensibles à l’unité élémentaire ? Comment sans contradiction l’être peut-il être qualifié ainsi d’humide ou de sec, de froid ou de chaud, etc. si, comme Parménide peu après en fait un impératif absolu de la raison, l’être étant strictement un, on ne peut rien affirmer de lui 6 Aristote, Métaphysique, 983b-5 sq. 7 Ibid. 8 Voir Physique, I, 191-a. Commentaire de Bachelard, MR, Introd. XII Page 4 sur 15 sinon qu’« il est » simplement et tautologiquement ? Pythagore peut-être, et plus tard assurément Empédocle qui parle d’une « quadruple racine », s’efforcent d’identifier toute chose à une unité problématique des quatre éléments, selon que leurs propriétés opposées peuvent se combiner, voire s’harmoniser, pour se ramener au moins à… un couple de contraires (agent et patient…). Avec, en arrière-plan, l’exigence d’unité ontologique, l’antique fiction théorique des éléments paraît donc en bute au problème de l’unité de matière. Des penseurs monistes et de leurs apories Aristote passe ensuite aux Académiciens qui, se proclamant « amis des formes », opposent un pluralisme à ceux que leur premier maître, Platon, appelle anonymement « les fils de la terre » : dualisme du sensible et de l’intelligible, multiplicité des « formes » (eidè), rapports entre ces formes purement intelligibles et rapports de celles-ci à l’Un. C’est ainsi que le Stagirite en vient à sa propre doctrine de la substance (ou de l’essence : ousia.) Mais c’est précisément pour montrer qu’une telle substance ne peut être identifiée à ce qu’il est le premier à nommer la « matière » (en lexicalisant la métaphore du « bois » de construction : hulè). En effet, ce qui caractérise pour lui avant tout celle-ci est son manque de détermination, non moins que sa dépendance à l’égard de « formes » dont elle est dans chaque cas inséparable. C’est une telle « forme » en vue de laquelle advient « l’état accompli » d’une substance et qui explique véritablement que celle-ci soit ce qu’elle est. Le tableau aristotélicien aborde uploads/Philosophie/ commentaire-de-bachelard-mr-introd-xii.pdf
Documents similaires

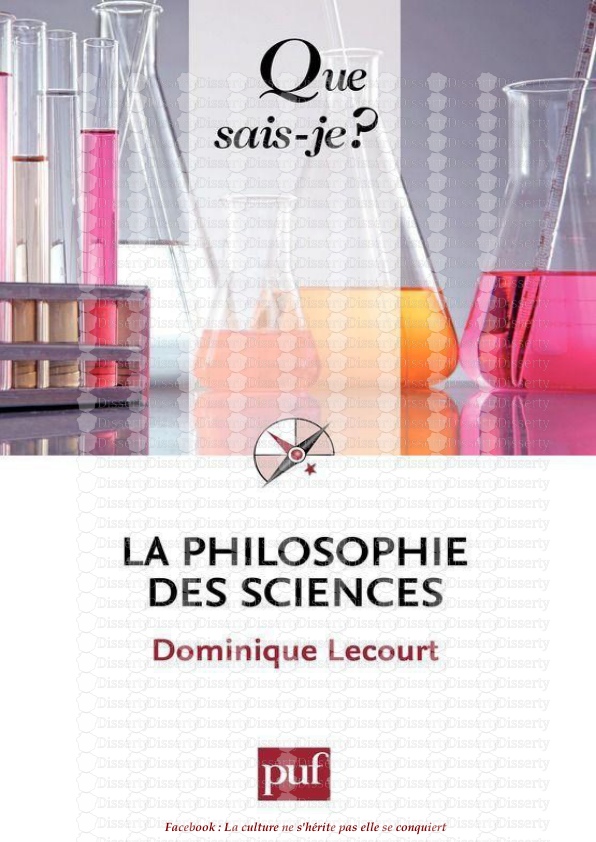








-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 11, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2584MB


