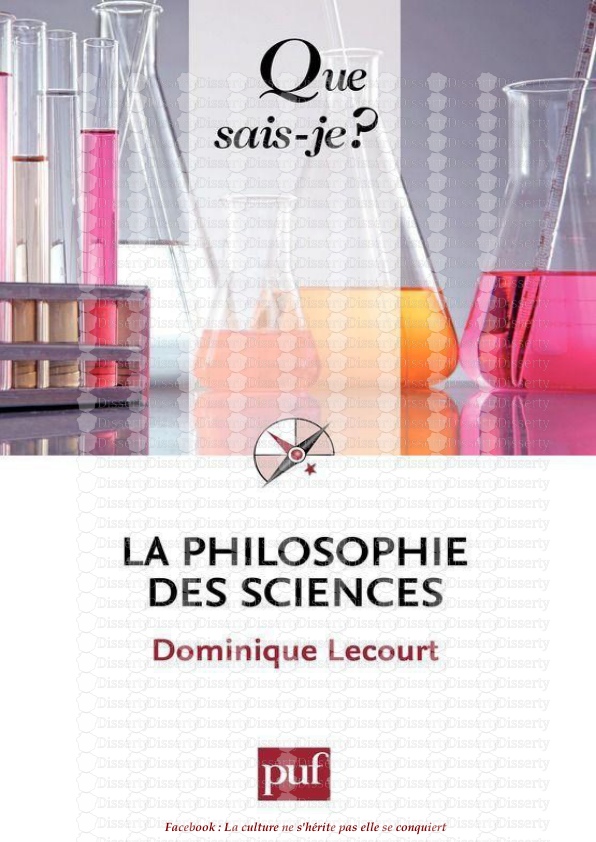Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert QUE SAIS-JE ? Facebook
Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert QUE SAIS-JE ? Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert La philosophie des sciences Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert DOMINIQUE LECOURT Professeur de philosophie à l’Université Paris-Diderot (Paris VII) Directeur du Centre Georges-Canguilhem Cinquième édition 13e mille Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Du même auteur L’épistémologie historique de Gaston Bachelard (1969), Paris, rééd. Vrin, 11e rééd. augmentée, 2002. Bachelard. Épistémologie, textes choisis (1971), Paris, rééd. PUF, 6e rééd., 1996. Pour une critique de l’épistémologie : Bachelard, Canguilhem, Foucault (1972), Paris, rééd. Maspero, 5e éd., 1980. Une crise et son enjeu, Paris, Maspero, 1973. Bachelard, le jour et la nuit, Paris, Grasset, 1974. Lyssenko, histoire réelle d’une « science prolétarienne » (1976), Paris, rééd. PUF, « Quadrige », 1995. Dissidence ou révolution ?, Paris, Maspero, 1978. L’ordre et les jeux, Paris, Grasset, 1980. La philosophie sans feinte, Paris, Albin Michel, 1982. Contre la peur. De la science à l’éthique, une aventure infinie (1990), Paris, 4e rééd., PUF, « Quadrige », 2007. L’Amérique entre la Bible et Darwin (1992), Paris, 3e rééd., PUF, « Quadrige », 2007. À quoi sert donc la philosophie ? Des sciences de la nature aux sciences politiques, Paris, PUF, 1993. Les infortunes de la raison, Québec, Vents d’Ouest, 1994. Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Prométhée, Faust, Frankenstein : Fondements imaginaires de l’éthique (1996), Paris, 3e rééd., Le Livre de poche, « Biblio-Essais », 1998. L’avenir du progrès, Paris, Éd. Textuel, 1997. Déclarer la philosophie, Paris, PUF, 1997. Science, philosophie et histoire des sciences en Europe, sous la direction de D. Lecourt (1998), Bruxelles, rééd. European Commission, 1999. Encyclopédie des sciences, sous la direction de D. Lecourt, Paris, le Livre de poche, 1998. Les piètres penseurs, Paris, Flammarion, 1999. Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, sous la direction de D. Lecourt (1999), Paris, rééd., PUF, « Quadrige », 4e éd. augmentée, 2006. Prix Gegner de l’Académie des sciences morales et politiques (2000). Rapport au ministre de l’Éducation nationale sur l’enseignement de la philosophie des sciences (2000) : http://media.education.gouv.fr/file/94/7/5947.pdf. Sciences, mythes et religions en Europe, sous la direction de D. Lecourt, Bruxelles, European Commission, 2000. Humain post-humain, Paris, PUF, 2003. Dictionnaire de la pensée médicale, sous la direction de D. Lecourt (2004), Paris, rééd. PUF, « Quadrige », 2004. Bioéthique et liberté, en collaboration avec Axel Kahn, Paris, PUF, « Quadrige », 2004. Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert La science et l’avenir de l’homme, sous la direction de D. Lecourt, Paris, PUF, « Quadrige », 2005. L’erreur médicale, sous la direction de Claude Sureau, D. Lecourt, Georges David, Paris, PUF, « Quadrige », 2006. Georges Canguilhem, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2008. Charles Darwin. Origines - Lettres choisies 1828-1859, introduction et édition française dirigée par D. Lecourt, Paris, Bayard, 2009. L’âge de la peur. Science, éthique et société, Paris, Bayard, 2009. La mort de la clinique ?, sous la direction de D. Lecourt, G. David, D. Couturier, J.-D. Sraer, C. Sureau, Paris, PUF, « Quadrige », 2009. La santé face au principe de précaution, sous la direction de D. Lecourt, Paris, PUF, 2009. Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert 978-2-13-061454-8 Dépôt légal — 1re édition : 2001 5e édition : 2010, février © Presses Universitaires de France, 2001 6, avenue Reille, 75014 Paris Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Sommaire Page de titre Du même auteur Page de Copyright Introduction Chapitre I – Les sciences dans la philosophie I. – La science antique et médiévale II. – La science moderne Chapitre II – Les commencements de la philosophie des sciences Chapitre III – Le mot d’« épistémologie » Chapitre IV – Une philosophie conquérante : Auguste Comte I. – Trois « méthodes de philosopher » II. – « Science, d’où prévoyance ; prévoyance, d’où action » Chapitre V – Une philosophie de crise : Ernst Mach I. – Critique du mécanisme II. – Économie de pensée III. – La « preuve » physiologique d’une thèse philosophique IV. – La querelle de l’atome Chapitre VI – Une philosophie scientifique ? I. – Le Cercle de Vienne II. – La « nouvelle logique » Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert III. – Vérification et signification IV. – « Éliminer la métaphysique » V. – Épurer le langage de la science Chapitre VII – Wittgenstein face au positivisme logique : un malentendu I. – Le « mystique » II. – Langage et logique III. – Les jeux de langage Chapitre VIII – Vienne en Amérique : de Carnap à Quine Chapitre IX – La question de l’induction I. – Formulation classique : David Hume II. – Formulation contemporaine : Bertrand Russell III. – La question de la confirmation Chapitre X – De la prédiction à la projection : Goodman Chapitre XI – Naturaliser l’épistémologie ? Chapitre XII – De la philosophie de la science à la science de la pensée Chapitre XIII – Logique ou méthodologie des sciences ? I. – Karl Popper a-t-il été membre du Cercle de Vienne ? II. – La falsifiabilité ou réfutabilité III. – Une épistémologie évolutionniste Chapitre XIV – Méthodologie raffinée : Lakatos Chapitre XV – La méthodologie en procès : Feyerabend Chapitre XVI – L’exigence historique : Hanson et Toulmin Chapitre XVII – Kuhn et la tentation sociologique I. – Les paradigmes Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert II. – Discontinuité, réalisme et relativisme III. – Sociologie des sciences Chapitre XVIII – Une tradition française I. – L’histoire philosophique des sciences II. – Une épistémologie historique : Bachelard III. – La philosophie du non IV. – « La science crée de la philosophie » V. – Le philosophe dans la cité scientifique VI. – La question de la logique VII. – L’expérimentation Chapitre XIX – Une épistémologie génétique : Jean Piaget Chapitre XX – Philosophie de la biologie et philosophie biologique I. – Une distinction II. – Canguilhem bachelardien III. – La connaissance de la vie IV. – La question du vitalisme V. – Descendance et dissidences Chapitre XXI – Une rencontre désormais possible Chapitre XXII – La philosophie dans les sciences Indications bibliographiques Notes Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Introduction Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, il semble bien qu’une situation de divorce se soit installée entre sciences et philosophie dans le monde contemporain. Des sciences, on attend qu’elles apportent toujours plus de connaissances positives, si possible applicables au bénéfice de tous ; on leur demande aussi de prévoir, et le cas échéant de prévenir, les risques auxquels nous exposent nos efforts pour maîtriser la nature aussi bien en nous-mêmes qu’en dehors de nous. De la philosophie, on entend qu’elle nous éclaire sur les questions ultimes de l’existence individuelle et collective. On s’accorde à lui assigner pour domaine propre la réflexion sur la religion, le droit, la politique, l’art et la morale. Certains lui attribuent l’exclusivité de l’interrogation sur le sens de nos actes, voire de notre vie. Nombreux sont les hommes de science qui, dans ces conditions, dénient à leur travail toute dimension philosophique. Même ceux qui, comme Ernst Mach (1838- 1916) en son temps ou plus près de nous le prix Nobel de physique Richard P. Feynman (1918-1998), ont fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle dans la saisie philosophique des questions que pose la connaissance du monde physique. On ne compte plus les philosophes qui, de leur côté, croient pouvoir rayer les sciences de leur souci. Les uns invoquent l’excuse de la spécialisation et la technicité des recherches actuelles ; les autres s’empressent d’accepter une version caricaturale de la thèse du philosophe allemand Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Martin Heidegger (1889-1976) selon laquelle la « science ne pense pas » pour mieux se réserver le privilège de la pensée1. Mais cette situation ne prévaut véritablement que depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale. Période clé de l’histoire des sciences contemporaines où l’on a vu s’instituer la Big science, cette physique qui met en œuvre de lourds équipements aux budgets énormes et impose une nouvelle division des tâches. Le laboratoire-caserne de Los Alamos a permis le succès du Manhattan-project développant la première bombe atomique avec une rapidité inattendue. Il fait figure de modèle même pour la recherche fondamentale. La priorité dès lors revient à la production de résultats expérimentaux. La carrière des chercheurs est suspendue au nombre et à la cadence de leurs publications (« publish or perish »). L’enseignement des sciences s’en trouve affecté. Loin de s’engager sur la voie de la présentation historique et réflexive des concepts et des théories dont avait rêvé Louis Pasteur (1822-1895) au siècle précédent, les institutions ont imposé un enseignement dogmatique essentiellement orienté vers la maîtrise des techniques de calcul et des démonstrations. Depuis la fin des années 1960, on a commencé à découvrir uploads/Philosophie/ la-philosophie-des-sciences-dominique-lecourt.pdf
Documents similaires










-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 10, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0568MB