© Studia Hegeliana, vol. III (2017), pp. 71-88. ISSN: 2444-0809 Sociedad Españo
© Studia Hegeliana, vol. III (2017), pp. 71-88. ISSN: 2444-0809 Sociedad Española de Estudios sobre Hegel La liberté du concept The Concept’s Freedom I. Le discours philosophique de la totalité L ’Encyclopédie des sciences philosophiques est l’exécution du programme, formulé par la Préface de la Phénoménologie de l’esprit et justifié par la Logique, d’un système de la science exposé du point de vue non de telle ou telle position subjective singulière (ce serait alors un système), mais de l’esprit saisi en son absoluité, comme processus dialectique de constitution de soi. Une telle science est véritablement une science de l’absolu, puisque l’absolu, dont l’esprit est « la définition la plus haute »1, s’y énonce pour lui-même selon ses [1] Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften [Enzyklopädie], § 384 Anm., Gesammelte Werke [GW] 20, Hamburg, Meiner, 1992 p. 382 ; Encyclopédie des Sciences philo sophiques, t. 3 [Encyclopédie 3], Paris, Vrin, 1988, p. 179. JEAN-FRANÇOIS KERVEGAN Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne kervegan@univ-paris1.fr RESUMEN: La primera edición de la Enciclo pedia define la Lógica como la “ciencia de la libertad”. Este estudio trata de explicar esta for mulación investigando la concepción hegeliana del Sistema filosófico como un “círculo de cír culos”, la de la Lógica como una “Onto-logía”, y luego la del Concepto como un autodesarrollo “subjetivo” del pensar “objetivo”. PALABRAS CLAVE: CONCEPTO; LIBER TAD; LÓGICA; MEDIACIÓN; SUBJETIVI DAD; SISTEMA. ABSTRACT: The first edition of the En cyclopedia defines Logic as the «science of freedom». The paper intends to explain this formula by investigating Hegel’s conception of the philosophical system as a ‘circle of circles’, that of Logic as an ‘Onto-Logic’, then that of the Concept as a ‘subjective’ self-development of ‘objective’ thinking. KEY WORDS: CONCEPT; FREEDOM; LOGIC; MEDIATION; SUBJECTIVITY; SYSTEM 74 JEAN-FRANÇOIS KERVEGAN Studia Hegeliana vol. III (2017) déclinaisons majeures : logique, nature, esprit. Voici comment l’Introduction de la deuxième édition de l’Encyclopédie décrit cette science : La science de [l’absolu] est essentiellement système, parce que le vrai en tant que concret est seulement en tant qu’il se déploie en lui-même et se recueille et retient dans l’unité, c’est-à-dire en tant que totalité […] Une démarche philosophique sans système ne peut rien être de scientifique ; outre que pour elle-même une telle démarche philosophique exprime davantage une manière de penser subjective, elle est, suivant son contenu, contingente. Un contenu a seulement comme moment du Tout sa justification mais, en dehors de ce dernier, a une présupposition non fondée ou une certitude subjective ; de nombreux écrits philosophiques se bornent à exprimer d’une telle façon seulement des manières de voir et des opinions. – Par système, on entend faussement une philosophie ayant un principe borné, différent d’autres principes ; c’est au contraire le principe d’une philosophie vraie que de contenir en soi tous les principes particuliers.2 On peut tirer trois enseignements de ce passage. 1) Il n’y a de science, au sens fort du terme, que de la totalité du réel (ou plutôt de l’effectif) ; la philosophe seule peut revendiquer cette qualification, à condition toutefois de ne pas être une philosophie, ordonnée à un principe particulier, mais le système intégrant ces principes en un tout unitaire. 2) Seule une telle science philosophique de la totalité échappe au risque d’abstraction inhérent à toute démarche de pensée. Les sciences positives, si fécondes que soient leurs opérations, ne sont jamais des sciences au sens plénier du terme : non parce qu’elles sont positives – c’est au contraire la garantie de leur fécondité – mais parce qu’elles sont constituti vement « sans système », car ordonnées à un point de vue régional. C’est encore plus vrai des philosophies ordonnées à un « principe borné » ; elles sont néces sairement des vues sur l’absolu, et non le savoir de l’absolu. 3) La systématicité consiste en ce que le tout du savoir découle d’un unique principe. Il n’y a donc, en toute rigueur, qu’une seule philosophie dont chaque philosophie particulière n’expose qu’un aspect : les Leçons sur l’histoire de la philosophie développent cette vue de manière conséquente en présentant la « philosophie Une » (die Eine Philosophie) comme le procès dont les philosophies particulières sont les moments, au sens à la fois logique et chronologique du terme. La systématicité n’est donc pas seulement une exigence du temps présent, elle est l’expression de la nature intemporelle d’un philosopher qui ne se donne pourtant à connaître que dans le temps, historiquement. D’où la thèse à première vue démentielle d’une correspondance entre les moments de l’idée logique et la succession des [2] Hegel, Enzyklopädie, § 14, GW 20, p. 56 ; Encyclopédie des Sciences philosophiques, t. 1 [Encyclopédie 1], Paris, Vrin, 1970, p. 180-181. 75 La liberté du concept Studia Hegeliana vol. III (2017) systèmes philosophiques réduits à leur unique principe, d’une homologie de la philosophie et de l’histoire de la philosophie : Je soutiens que la succession des systèmes philosophiques dans l’histoire est la même que la succession des déterminations conceptuelles de l’idée dans sa déri vation logique […] L’histoire de la philosophie est la même chose que le système de la philosophie.3 La question se pose alors, bien entendu : faut-il identifier le système de Hegel à cette philosophie une et universelle dont les philosophies particulières ne sont que les moments ? La philosophie de Hegel est-elle la philosophie ? La réponse à cette question décisive est complexe. D’un côté, Hegel, en raison même des thèses qu’il professe quant à la nature du système, doit identifier sa pensée (qui de ce fait n’est pas sa pensée) à la science de l’absolu : c’est seule ment lorsque l’on a accédé au point de vue de la totalité que l’on peut cerner la véritable signification de la systématicité. Mais, inversement, une telle vision de l’achèvement hégélien de la philosophie interromprait d’une manière forcément arbitraire le dynamisme processuel de la raison s’ex-posant dans l’histoire. On rencontre ici en son expression cruciale le dilemme du hégélianisme : il ne peut pas et pourtant ne peut que se penser comme ultime figure de la philosophie. Quoi qu’il en soit, le système hégélien comporte une organisation originale, notamment par rapport au monisme de la Doctrine de la science fichtéenne et au dualisme méthodologique professé à Iéna par Schelling (la philosophie pouvant être exposée soit du point de vue subjectif de la philosophie transcendantale, soit du point de vue objectif de la Naturphilosophie4). Dès l’achèvement de la Phénoménologie de l’Esprit, la structure tripartite du système est acquise : il se compose de « la logique en tant que philosophie spéculative et [des] deux autres parties de la philosophie, les sciences de la nature et de l’esprit »5. La science philosophique se décompose donc en trois parties dont chacune est « un cercle se fermant sur lui-même » et expose néanmoins « l’Idée philosophique […] dans une déterminité ou un élément particulier »6 : la logique, « science de l’Idée en et pour soi », la philosophie de la nature, « science de l’idée en son [3] Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie. Introduction, trad. Marmasse, Paris, Vrin, 2004, p. 41 et 105. [4] Voir Schelling, Système de l’idéalisme transcendantal, Préface, Louvain, Peteers, 1978, p. 000 (SW 3, p. 331) ; Exposition de mon système de la philosophie, Vrin, 2000, p. 33-34 (SW 4, p. 108). [5] Hegel, «Selbstanzeige», in Phänomenologie des Geistes [PhG], édition Wessels- Clairmont, Meiner, 1988, p. 550 ; PhE J/L, p. 24. [6] Hegel, Enzyklopädie, § 15, GW 20, p. 56 ; Encyclopédie 1, p. 181. 76 JEAN-FRANÇOIS KERVEGAN Studia Hegeliana vol. III (2017) être-autre », et la philosophie de l’esprit, où l’idée « de son être-autre, fait retour à soi-même »7. Que signifie cette division inédite de la philosophie ? La logique, telle que la conçoit Hegel, n’a pas d’équivalent dans la tradi tion. Elle prend la place, dit-il, de la métaphysique traditionnelle, donc de la « science de l’être en tant qu’être » ou, selon une dénomination plus récente, de l’ontologie ; le terme, comme on le sait, est dû à Wolff et s’applique à la mé taphysique générale, distinguée de la métaphysique spéciale. Mais, en même temps, la logique est autre chose qu’une métaphysique ou qu’une ontologie, si l’on entend par là un discours portant sur un certain domaine d’objectivité, si éminent soit-il : elle prétend être une onto-logique, le logos même de l’être. On pourrait dire que la logique est la réflexion de l’être, le terme « réflexion » étant à entendre, en un sens non psychologique, comme libre retour sur lui- même d’un double processus (celui de l’être et celui de la pensée) qui parvient seulement ainsi à se ressaisir en son unité fondamentale. La logique n’est donc certainement pas un « art de penser » ou un organon ; elle présente plutôt, en leur liaison systématique, l’ensemble des conditions, ontiques aussi bien que noétiques, sous lesquelles la pensée de l’être peut se déployer ; elle développe ainsi une « pensée objective »8. La philosophie de la nature constitue la part maudite du système hégélien. Son discrédit uploads/Philosophie/ dialnet-laliberteduconcept-7797142.pdf
Documents similaires

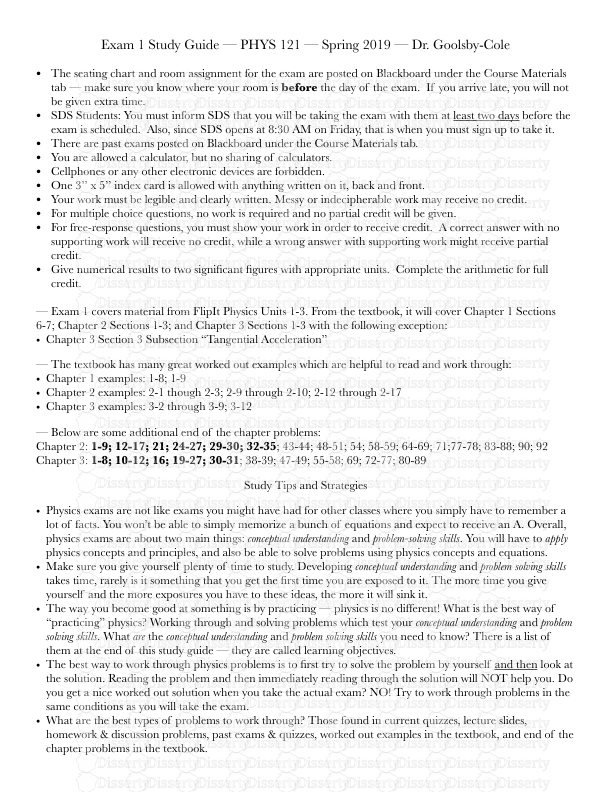





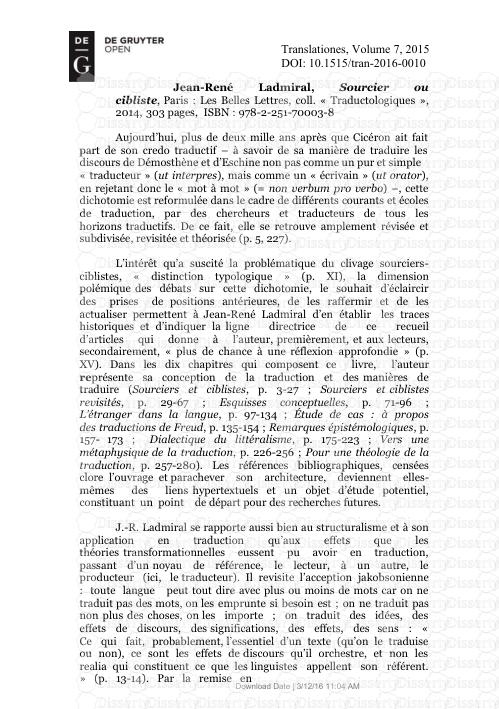


-
71
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 12, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2772MB


