18. L’amour André Comte-Sponville Ancien élève de l’École Normale Supérieure et
18. L’amour André Comte-Sponville Ancien élève de l’École Normale Supérieure et agrégé de philosophie, André Comte-Sponville fut longtemps métré de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Il se consacre aujourd’hui à l’écriture. Il a également publié, aux PUF, un Traité du désespoir et de la béatitude et un Dictionnaire philosophique. 1 Le sexe ni le cerveau ne sont des muscles, ni ne peuvent l’être. Il en découle plusieurs conséquences importantes, dont la moindre n’est pas celle-ci : on n’aime pas ce qu’on veut, mais ce qu’on désire, mais ce qu’on aime, et qu’on ne choisit pas. Comment choisirait-on ses désirs ou ses amours, puisqu’on ne peut choisir — fût-ce entre plusieurs désirs différents, entre plusieurs amours différents — qu’en fonction d’eux ? L’amour ne se commande pas, et ne saurait en conséquence être un devoir . Sa présence dans un traité des vertus devient dès lors problématique ? Peut-être. Mais il faut dire aussi que vertu et devoir sont deux choses différentes (le devoir est une contrainte, la vertu, une liberté), nécessaires toutes deux, certes, solidaires l’une de l’autre, évidemment, mais plutôt complémentaires, voire symétriques, que semblables ou confondues. Cela est vrai, me semble-t-il, de toute vertu : plus on est généreux, par exemple, et moins la bienfaisance apparaît comme un devoir, c’est-à-dire comme une contrainte . Mais c’est vrai a fortiori de l’amour. « Ce qu’on fait par amour s’accomplit toujours par-delà le bien et le mal », disait Nietzsche . Je n’irais pas jusque-là, puisque l’amour est le bien même. Mais par-delà le devoir et l’interdit, oui, presque toujours et c’est tant mieux ! Le devoir est une contrainte (un « joug », dit Kant) , le devoir est une tristesse, alors que l’amour est une spontanéité joyeuse. « Ce que l’on fait par contrainte, écrit Kant, on ne le fait pas par amour. » Cela se retourne : ce qu’on fait par amour, on ne le fait pas par contrainte ni, donc, par devoir. Chacun le sait, et que certaines de nos expériences les plus évidemment éthiques n’ont pour cela rien à voir avec la morale, non parce qu’elles la contredisent, certes, mais parce qu’elles n’ont pas besoin de ses obligations. Quelle mère nourrit son enfant par devoir ? Et quelle plus atroce expression que celle de devoir conjugal ? Quand l’amour est là, quand le désir est [1] [2] [3] [4] [5] là, qu’a-t-on besoin du devoir ? Qu’il y ait une vertu conjugale, en revanche, qu’il y ait une vertu maternelle, et dans le plaisir même, et dans l’amour même, oui, assurément ! On peut donner le sein, on peut se donner soi, on peut aimer, on peut caresser, avec plus ou moins de générosité, plus ou moins de douceur, plus ou moins de pureté, plus ou moins de fidélité, plus ou moins de prudence, quand il en faut, plus ou moins d’humour, plus ou moins de simplicité, plus ou moins de bonne foi, plus ou moins d’amour... Qu’est-ce autre que nourrir son enfant ou faire l’amour vertueusement, c’est-à-dire excellemment ? Il y a une manière médiocre, égoïste, haineuse parfois de faire l’amour. Et il y en a une autre, ou plusieurs autres, et autant que d’individus ou de couples, de le faire bien, ce qui est bien faire, et ce qui est vertu. L’amour physique n’est qu’un exemple, qu’il serait aussi absurde de surévaluer, comme beaucoup font aujourd’hui, qu’il l’a été, pendant des siècles, de le diaboliser. L’amour, s’il naît de la sexualité, comme le veut Freud et comme je le crois volontiers, ne saurait s’y réduire, et va bien au-delà, en tout cas, de nos petits ou grands plaisirs érotiques. C’est toute notre vie, privée ou publique, familiale ou professionnelle, qui ne vaut qu’à proportion de l’amour que nous y mettons ou y trouvons. Pourquoi serions-nous égoïstes, si nous ne nous aimions nous-mêmes ? Pourquoi travaillerions-nous, n’était l’amour de l’argent, du confort ou du travail ? Pourquoi la philosophie, n’était l’amour de la sagesse ? Et si je n’aimais la philosophie, pourquoi tous ces livres ? Pourquoi celui-ci, si je n’aimais les vertus ? Et pourquoi le lirais-tu, lecteur, si tu ne partageais tel ou tel de ces amours ? L’amour ne se commande pas, puisque c’est l’amour qui commande. 2 Cela vaut aussi, bien sûr, dans notre vie morale ou éthique. Nous n’avons besoin de morale que faute d’amour, répétons-le, et c’est pourquoi, de morale, nous avons tellement besoin ! C’est l’amour qui commande, mais l’amour fait défaut : l’amour commande en son absence, et par cette absence même. C’est ce que le devoir exprime ou révèle, qui ne nous contraint à faire que ce que l’amour, s’il était là, suffirait, sans contrainte, à susciter. Comment l’amour pourrait-il commander autre chose que lui-même, qui ne se commande pas, ou autre chose du moins que ce qui lui ressemble ? On ne commande que l’action, et cela dit l’essentiel : ce n’est pas l’amour que la morale prescrit ; c’est d’accomplir, par devoir, cette même action que l’amour, s’il était là, aurait déjà librement accomplie. Maxime du devoir : Agis comme si tu aimais. 3 Au fond, c’est ce que Kant appelait l’amour pratique : « L’amour envers les hommes est possible, à vrai dire, mais il ne peut être commandé, car il n’est au pouvoir d’aucun homme d’aimer quelqu’un simplement par ordre. C’est donc simplement l’amour pratique qui est compris dans ce noyau de toutes les lois. […] Aimer le prochain signifie pratiquer volontiers tous ses devoirs envers lui. Mais l’ordre qui nous en fait une règle ne peut pas non plus commander d’avoir cette intention dans les actions conformes au devoir, mais simplement d’y tendre. Car le commandement que l’on doit faire quelque chose volontiers est en soi contradictoire. » L’amour n’est pas un commandement : c’est un idéal (« l’idéal de la sainteté », dit Kant) . Mais cet idéal nous guide, et nous éclaire. [6] [7] 4 On ne naît pas vertueux ; on le devient. Comment ? Par l’éducation : par la politesse, par la morale, par l’amour. La politesse, on l’a vu, est un semblant de morale : agir poliment, c’est agir comme si l’on était vertueux . Par quoi la morale commence, au plus bas, en imitant cette vertu qui lui manque et dont pourtant, par l’éducation, elle s’approche et nous approche. La politesse, dans une vie bien conduite, a pour cela de moins en moins d’importance, quand la morale en a de plus en plus. C’est ce que les adolescents découvrent, et nous rappellent. Mais ce n’est que le début d’un processus, qui ne saurait s’arrêter là. La morale, pareillement, est un semblant d’amour : agir moralement, c’est agir comme si l’on aimait. Par quoi la morale advient et continue, en imitant cet amour qui lui manque, qui nous manque, et dont pourtant, par l’habitude, par l’intériorisation, par la sublimation, elle s’approche et nous approche, elle aussi, au point parfois de s’abolir dans cet amour qui l’attire, qui la justifie, et la dissout. Bien agir, c’est faire d’abord ce qui se fait (politesse), puis ce qui doit se faire (morale), enfin parfois c’est faire ce que l’on veut, pour peu qu’on aime (éthique). Comme la morale libère de la politesse en l’accomplissant (seul l’homme vertueux n’a plus à agir comme s’il l’était), l’amour, qui accomplit à son tour la morale, nous en libère : seul celui qui aime n’a plus à agir comme s’il aimait. C’est l’esprit des Évangiles (« Aime, et fais ce que tu veux ») , par quoi le Christ nous libère de la Loi, explique Spinoza, non en l’abolissant, comme l’a voulu stupidement Nietzsche, mais en l’accomplissant (« Je ne suis pas venu abolir mais accomplir… ») , c’est-à-dire, commente Spinoza, en la confirmant et en l’inscrivant à jamais « au fond des cœurs » . La morale est ce semblant d’amour, par quoi l’amour devient possible, qui en libère. Elle naît de la politesse et tend à l’amour : elle nous fait passer de l’une à l’autre. C’est pourquoi, même austère, même rebutante, nous l’aimons. [8] [9] [10] [11] 5 Encore faut-il aimer l’amour ? Sans doute, mais nous l’aimons en effet (puisque nous aimons au moins être aimés), ou la morale ne peut rien pour qui ne l’aimerait pas. Sans cet amour de l’amour nous sommes perdus, et c’est peut-être la définition vraie de l’enfer, je veux dire de la damnation, de la perdition, ici et maintenant. Il faut aimer l’amour ou n’aimer rien, aimer l’amour ou se perdre. Quelle contrainte autrement ? Quelle morale ? Quelle éthique ? Sans l’amour, que resterait-il de nos vertus ? Et que vaudraient-elles, si nous ne les aimions pas ? Pascal, Hume et Bergson sont plus éclairants ici que Kant : la morale vient du sentiment davantage [12] [13] Eros que de la logique, du cœur plus que de la raison , et la raison elle-même n’y commande (par l’universalité) ou n’y sert (par la prudence) que pour autant que nous le uploads/Philosophie/ andre-comte-sponville-amour.pdf
Documents similaires








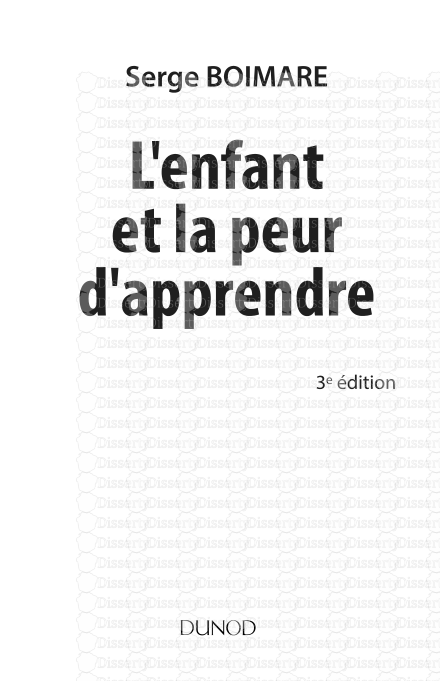

-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 11, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5266MB


