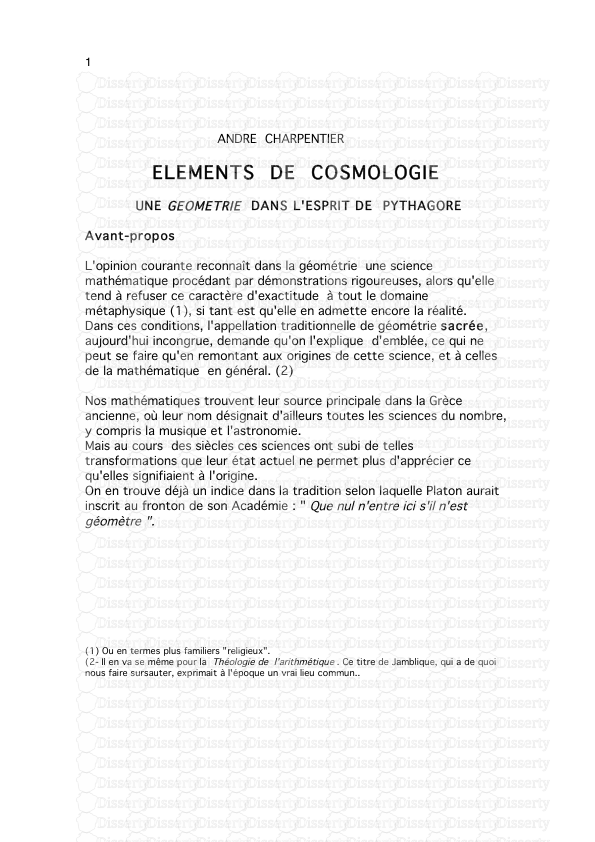1 1 ANDRE CHARPENTIER ELEMENTS DE COSMOLOGIE UNE GEOMETRIE DANS L'ESPRIT DE PYT
1 1 ANDRE CHARPENTIER ELEMENTS DE COSMOLOGIE UNE GEOMETRIE DANS L'ESPRIT DE PYTHAGORE Avant-propos L'opinion courante reconnaît dans la géométrie une science mathématique procédant par démonstrations rigoureuses, alors qu'elle tend à refuser ce caractère d'exactitude à tout le domaine métaphysique (1), si tant est qu'elle en admette encore la réalité. Dans ces conditions, l'appellation traditionnelle de géométrie sacrée, aujourd'hui incongrue, demande qu'on l'explique d'emblée, ce qui ne peut se faire qu'en remontant aux origines de cette science, et à celles de la mathématique en général. (2) Nos mathématiques trouvent leur source principale dans la Grèce ancienne, où leur nom désignait d'ailleurs toutes les sciences du nombre, y compris la musique et l'astronomie. Mais au cours des siècles ces sciences ont subi de telles transformations que leur état actuel ne permet plus d'apprécier ce qu'elles signifiaient à l'origine. On en trouve déjà un indice dans la tradition selon laquelle Platon aurait inscrit au fronton de son Académie : " Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ". (1) Ou en termes plus familiers "religieux". (2- Il en va se même pour la Théologie de l'arithmétique . Ce titre de Jamblique, qui a de quoi nous faire sursauter, exprimait à l'époque un vrai lieu commun.. 2 2 Or cette école entendait enseigner la sagesse, et non quelque technique de calcul, ni même une philosophie des sciences (1) comme on en trouve dans nos universités. Et le but de la sagesse, c'est le bonheur. Platon précise donc, dans son Epinomis, que sans les sciences mathématiques il est impossible d'être parfaitement heureux. (2) Autre déclaration étrange pour nous, qui ressentons de plus en plus le caractère menaçant de nos techno-sciences.… Heureusement, dans le même ouvrage, Platon nous renseigne sur la nature de ce bonheur : " L'art du calcul ne doit pas être traité à la manière du vulgaire, mais de façon à conduire les hommes à la contemplation de l'essence des Nombres ; donc, non pas en vue du commerce, comme font les marchands (3) mais pour le bien de l'âme, en lui donnant les moyens de s'élever de l'ordre des choses qui passent, vers la vérité et l'Etre." (4) Cette faculté est le propre de l'homme, car "l'animal, qui ne sait rien du nombre, ne sera jamais en état de rendre raison d'aucune chose, ne la connaissant que par les sens et la mémoire. Privé de la vraie raison, il ne deviendra jamais sage." (5) (1) Ce n'est pas seulement le concept de science qui s'est transformé. En effet, le terme de philosophie, dont l'invention était attribuée à Pythagore, signifiait "amour de la sagesse". Une sagesse dont les philosophes actuels donnent rarement l'exemple… (2) Pour les citations, voir République VII, 525 B, Epinomis 977 C et 992 A. Voir en particulier le début de l'Epinomis, dont la philologie officielle conteste l'attribution à Platon, comme si cela jetait un doute sur la valeur de son contenu purement pythagoricien. La béatitude dont il s'agit est d'ailleurs toute relative, vu ses limitations naturelles. Pline le jeune (Lettres) se disait, lui et sa famille, "heureux, autant qu'il est permis à des mortels" : quantum mortalibus licet, beati.… (3) Ceci tendrait à classer parmi ceux-ci une majorité de nos scientifiques, stimulés avant tout par l'espoir de "retombées" profitables, qu'elles soient commerciales ou honorifiques, sous forme de "Nobels".. (4) Rabelais se montre donc fidèle disciple de Platon en expliquant son rire par " une certaine gaîté confite en ( = fondée sur ) mépris des choses fortuites". (5) Voilà qui est dangereusement "pré-cartésien" Comme si l' infaillible instinct de la "bête" n'était pas une forme de sagesse ( qu'à bien des égards nous aurions avantage à imiter,) 3 3 Mais qu'est-ce donc que cette "géométrie" qui doit permettre à l'homme de surpasser sa condition éphémère ? Est-ce bien la science qu'on enseignait naguère dans les écoles sous le nom d'Euclide, science apparemment profane enseignant à "mesurer les formes terrestres" ? En prenant cette étymologie au pied de la lettre et dans son sens le plus "terre à terre", les archéologues se sont imaginé que la géométrie trouvait son origine dans les techniques d'arpentage. Pour le dire platement, cette discipline aurait donc été, elle aussi, inspirée avant tout par l'instinct de propriété. (1) Or, cela est directement contraire au désintéressement si nettement professé par Platon, et qui inspire également sa notion du bonheur. (2) Et c'est sans doute pour éviter l’avilissement de sa discipline que Platon, sans vouloir changer le terme consacré de géométrie , nous met en garde contre son caractère "parfaitement ridicule ". (3) Propos véritablement stupéfiant, et qui n'est là que pour susciter la réflexion. (1) Les éthologistes nous ont montré le rôle déterminant de l'instinct territorial dans le comportement animal . Mais d’'nnombrables documents prouvent que l'arpentage, avant de devenir le monopole de nos "immobiliers", est resté longtemps une activité sacerdotale, et donc essentiellement humaine. . (2) Aristote, si souvent présenté comme un contradicteur de Platon ( alors qu’ils s’entendaient sur le fond comme initiés en Confrérie), va plus loin encore que son maître. Alors que ce dernier fait du bonheur le fruit de la Sagesse, le Stagirite va jusqu’à en en faire le critère en écrivant : « Tu reconnaîtras la vérité de ton chemin à ce qu’il te rend heureux ». Cette déclaration, qui servira aussi de conclusion à notre ouvrage, serait inacceptable si ce bonheur n’était qu’un sentiment purement subjectif, et donc illusoire. (3) Epinomis, 990 A. " (…) Sphodra geloion onoma géométrian…" 4 4 En effet, ce que Platon entend par "géométrie" est en fait une cosmologie à part entière, dont le but véritable n'est pas de "mesurer notre terre", mais bien de définir les lois qui régissent la manifestation tout entière. (1) Encore ne s'agit-il pas de considérer l'univers comme un donné , sans se préoccuper de ses antécédents (2) , mais de montrer comment il émane tout entier de sa Cause transcendante. On nous objectera que c'est là le rôle des religions plutôt que des mathématiques, ce qui revient à entériner une fois de plus l'antagonisme moderne du sacré et du profane. Mais Platon est à cent lieues de cette dichotomie, et s'il considère la cosmologie comme une clé du bonheur, c'est qu’elle traite des origines et des "fins dernières" de l'homme Car celui-ci, s'il ignore "d'où il vient et où il va ", ne pourra jamais jouir que d’un bonheur purement animal. (1) Le grec Gè désigne à la fois le sol arable et le monde, qu'l s'agisse de notre planète bleue, ou même de l'univers tout entier. Le latin mundus, comme son équivalent grec cosmos, exprime la parfaite beauté du Grand Tout, qui résulte de son Unité foncière ( Hen to Pan ). C'est ce que montrent, dans un registre plus trivial, les dérivés im-monde ( dépourvu d'harmonie) et cosmétique ( produit de beauté). Nous avons montré,, dans Lers Mystères du Panthéon Romain, que les Géorgiques de Virgile ( en grec " Les travaux de la terre " ) jouent de cette équivoque, et de façon tout à fait délibérée. Car ce "traité d'agriculture" n'est que la"couverture extérieure" d'une cosmologie en bonne et due forme, où la Terre représente tout l'univers connu. Ces Travaux représentent donc avant tout l'organisation du monde, y compris au sens politique du terme. En dehors de cette interprétation ésotérique, toute la seconde partie du chant IV - ce merveilleux couronnement de l'œuvre - ne présente pas le moindre sens acceptable.. (2) Notre cosmologie profane s'interdit, à juste titre, d'évoquer la vraie question des origines. Elle fait "démarrer" le monde physique une fraction de seconde après son fameux big bang. Mais il y avait forcément avant cela ( In Principio ) .un quelque chose dont on ne peut rien dire qu'en en termes de métaphysique, cette Science Première dont on en es venu à négliger la réalité, quand on ne la nie pas a priori. 5 5 Cela pourrait encore se défendre, si l’on tient l’homme pour un animal comme les autres, ou pour un "singe nu". . Mais dans le même temps, les adeptes de l’ éthique nous répètent sur tous les tons que sans une vision acceptable de notre raison d'être, tout manque de sens . Et il faut en effet être insensé pour trouver normal d'être né par l'opération d'un improbable hasard statistique, et destiné à disparaître sans laisser de traces, (1) L'inanité de cette croyance est d'ailleurs établie par la physique la plus élémentaire, quand elle reconnaît que, si tout se transforme, rien pourtant ne se perd ni ne se crée. C'est pourtant là tout ce que nos sciences ont à nous proposer, en laissant aux religions le soin de consoler les naïfs de leur finitude. Or ces religions usent d'un langage symbolique, parfaitement vrai dans le fond, mais dont nos contemporains, dans leur immense majorité, ont désappris l'usage et qu'on leur présente du coup comme une survivance de siècles peu éclairés. (2) Il nous manque donc une cosmologie sérieuse, i.e. une "explication du monde" véritablement scientifique, on veut uploads/Philosophie/ elements-de-cosmologie-andre-charpentier.pdf
Documents similaires










-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 17, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 8.6686MB