Page 1 Notes sur l’hybridité par Marc Bernardot, Hélène Thomas in Asylon(s), La
Page 1 Notes sur l’hybridité par Marc Bernardot, Hélène Thomas in Asylon(s), La revue des deux asiles, n° 13. « Trans-concepts : lexique théorique du contemporain » sous la direction de Bernardot M., Le Marchand A., Thomas H. Novembre 2014-Septembre 2016, http://www.reseau-terra.eu/article1327.html Mots-clés (auteur) : Hybridité, indigénisation, postmodernité, création, mobilités, migrations, capitalisme cognitif, États, subalternes, réseaux, numérique, métissage, créolité, itinérance. L’hybridation est le nom donné à un processus clé de la vie biologique. Il consiste en la transmission de patrimoine génétique entre des individus d’espèces différentes. L’hybridation est non seulement un mécanisme central mais aussi une technique décisive à l’échelle humaine, au moins depuis la révolution néolithique, associée à la capacité à sélectionner des espèces végétales ou animales et à les domestiquer. C’est plus largement un processus cognitif et technologique, à l’œuvre dans les mutations des cultures et des civilisations depuis bien avant la Renaissance occidentale et plus que jamais actif dans l’actuelle globalisation, dont l’un des moteurs est justement la révolution génomique. Elle va de pair avec (et participe à) l’accélération de la circulation des marchandises, comme avec l’accroissement des connexions en réseaux et des échanges de biens ou d’informations entre communautés d’experts (peer to peer), et enfin avec la multiplication d’acteurs non-humains. L’hybridation a ainsi été envisagée comme l’une des caractéristiques centrale et emblématique de la globalisation (Hannertz 1996, Pieterse 1995, Kraidy 2005, Canclini 1995, 2000, 2009), en lien avec les révolutions simultanées de l’informatisation des techniques bancaires et actuarielles et de l’économie financière (pool to pool) d’une part et avec les mutations des cultures et des identités et avec le développement des mobilités et des migrations d’autre part. L’hybridation est devenue une notion nodale dans plusieurs courants de pensées contemporains des plus stimulants en sciences humaines, telles les postcolonial studies. Elle s’est aussi affirmée dans les science studies avec la figure du cyborg, hybride d’organisme et de machine qui caractériserait la post-humanité. L’hybridation a enfin accédé au statut de mot clé des civilisations contemporaines, car les penseurs du global et de ses ethnoscapes voient des hybrides partout. Ce qui était post- est devenu trans-. Des superhéros et des constructions sémiotiques aux territoires et aux transports urbains, en passant par les modèles stratégiques et managériaux, les objets électroniques, les formes d’enseignement et de divertissement, et même les structures politiques, tous sont hybrides. L’on pourrait presque avancer, à la manière de Zygmunt Bauman (2005), que tout s’est hybridé dans le liquide amniotique de la mondialisation. Page 2 A l’occasion d’une journée d’étude sur l’hybridation des réseaux itinérants organisée à l’université du Havre en novembre 2013, Arnaud Le Marchand a proposé d’appliquer cette notion à la question de l’appropriation des pratiques numériques par des groupes marginaux, parce qu’à la fois minoritaires et itinérants. Il résumait ainsi la question dans l’appel à communication : comment les « nomades » utilisent-ils ces technologies « nomades », généralisées, miniaturisées et (évidemment) hybridées ? Les thèmes et les groupes sociaux abordés durant cette journée d’étude ne sont pas tous réductibles à l’idée de nomadisme au sens strict. Cependant tous les groupes mobiles, tels les marins et les bateliers, les travailleurs migrants et déplacés, les diasporas s’affrontent aux questions pratiques de la réticularité des échanges (poor to poor). Leurs formes de communication et de déplacement, à la fois virtuelles et réelles, et tant collectives qu’individuelles sont hybrides (Waldinger 2011, Portes 1999, Tarrius 2002). Pour répondre aux questions générées par le concept d’hybridité il nous a semblé nécessaire de chausser les bottes de sept lieux de la théorie. Certes la globalisation pose de nombreux problèmes, épistémologiques et méthodologiques, que nous n’aborderons pas ici : les conditions de production du discours sociologique dans « un monde inégal » (Patel 2010), les phénomènes interliés de spécialisation des champs scientifiques, de transdisciplinarité et de traduction conceptuelle ou linguistique (Ivekovic 2009, Sakai & Salomon 2007) ou encore la nécessité d’adapter les outils d’études classiques des sciences sociales à des nouveaux objets/sujets sociaux numériques (Wiewiorka 2013, Valluy 2013). Le fait d’utiliser une notion comme l’hybridation dans une réflexion de sciences humaines et sociales n’est pas sans poser problème. Edward Saïd (2000) et Hélène Thomas (2008, 2010, 2012) ont montré que ces notions typiquement voyageuses, « nomades » même, telle celle d’hybridité, perdent parfois en chemin leur sens initial, gagnent en sens littéral voire font « image » jusqu’à « empoisonner » le message : elles sont le Pharmakon des langues. Ce genre de termes dont l’usage se généralise sur une courte période, passant et proliférant indifféremment des sciences de la vie aux sciences humaines, d’une discipline scientifique à l’autre, de la langue des poètes à celle des experts, du langage des marchands aux parlers populaires, deviennent des tropes envahissant tous les discours. Les aller-retours et les boucles des sciences de la nature aux sciences sociales, forcément métaphoriques, impliquent des manipulations et des translations qui occultent une partie des sens initiaux sans pour autant les faire disparaître. Elles donnent à ces notions l’efficace de la magie, la vivacité du conte et la puissance du simulacre leur conférant finalement l’énergie propre au déplacement de la pensée pour l’écrire à la manière d’un Paul Page 3 Ricœur ou d’un Gilles Deleuze. Cependant cette tendance prononcée aux accès de fièvre sémiotique constitue aussi leur « talon d’Achille », en raison de la mise en abyme et en écho chiral perpétuel de leur sens initial [1]. Ainsi va de l’hybride qui s’hybride à son tour, portant toujours plus loin le sens dans un mouvement méta de méta, sans parvenir pour autant à s’éloigner suffisamment du fracas de la guerre idéologique totale dont il est à la fois l’objet, le déclencheur, le vecteur et l’arme fatale. L’emploi métaphorique du terme d’hybridité est donc complexe et risqué car il déborde toujours de son champ sémantique initial compliquant terriblement la tâche du lecteur, planté dans « le bois de la langue » selon l’expression d’Henri Meschonnic (2008). Le terme est saturé de sens et sa généralisation dans la période récente achève de rendre son usage délicat. Malgré ces difficultés, et le fait que les travaux sur la notion sont très nombreux, nous pensons pouvoir utilement contribuer au débat par une approche hybride et à quatre mains tentant de lier des usages disciplinaires habituellement séparés. Étant nous-mêmes des itinérants, nous nous plaçons pour cet article sous la protection d’un saint patron en la personne de Charles Perrault et de deux de ses personnages bien connus, le Chat Botté et le Petit Poucet. Les deux sont des voyageurs émérites et des hybrides comme seuls peuvent l’être les figures des fables, des contes et légendes. Un troisième personnage les relie, ce sont les bottes, celles du Chat et celles de l’Ogre dérobées par le Petit Poucet, hybrides elles aussi. Dotées de pouvoirs surhumains et capables de s’adapter aux pieds qui les portent, elles nous renvoient à Hermès et à Persée et à leurs chevilles ailées. Elles confèrent la vitesse nécessaire pour couvrir sans fatigue de longues distances et la précision indispensable dans l’orientation du voyageur. Munis de ces chausses prodigieuses, qui dotent les deux créatures aux mille tours d’un système de positionnement global et local avant l’heure, nous nous sommes transportés au pays de l’hybridité pour découvrir et redécouvrir quelques fragments de ce territoire considérable, où l’hybridation constitue soit un item central soit une occurrence significative. Nous cherchons ici à cartographier les usages réticulés de la notion et à discerner son intérêt et ses limites. Des principes biologiques à ceux de la sémiologie, des sciences de la vie aux sciences humaines et sociales contemporaines, nous évoquons dans un premier temps les multiples significations du terme et de ses dérivés saturés de sens. L’idée, le processus comme la technique sont objets de détestation pour certains tandis que d’autres les portent au pinacle en faisant l’analyseur central du monde contemporain. Nous testons dans un second temps la notion d’hybridation au sens d’indigénisation. Nous nous focalisons sur les cas de mutations et Page 4 de transformations politiques, économiques et culturelles de la postmodernité dont elle rend compte et décrivons ses formes concernant tant les institutions qui articulent des dispositifs étatiques et des procédures marchandes que des groupes subalternes mobiles qui combinent réseaux anciens et pratiques numériques. 1. L’hybridation comme processus : du biologique au global L’hybridité s’avère être un mot clé pour la pensée scientifique, dans la mesure où il désigne tant un processus de reproduction/fécondation interspécifique du vivant qu’une forme de conception des identités sociales ou culturelles. Les usages du terme incorporent des significations variées et parfois contradictoires qui sont potentiellement actives dans différents champs scientifiques. Du sang mêlé au bizarre, les étymologies queer de l’hybridité Commençons par la signification biologique de l’hybridation qui est caractérisée par deux phénomènes : l’introgression et l’hétérosis. Pour qu’il y ait hybridation il faut premièrement une introgression, c’est-à-dire une fusion dans une nouvelle espèce des particularités héréditaires de deux espèces différentes (à savoir l’expression d’une information génétique composite et la transfusion des potentialités de chaque génome). Celles-ci doivent être relativement proches car une homologie suffisante est nécessaire entre uploads/Philosophie/ helene-thomas-notes-sur-l-x27-hybridite.pdf
Documents similaires



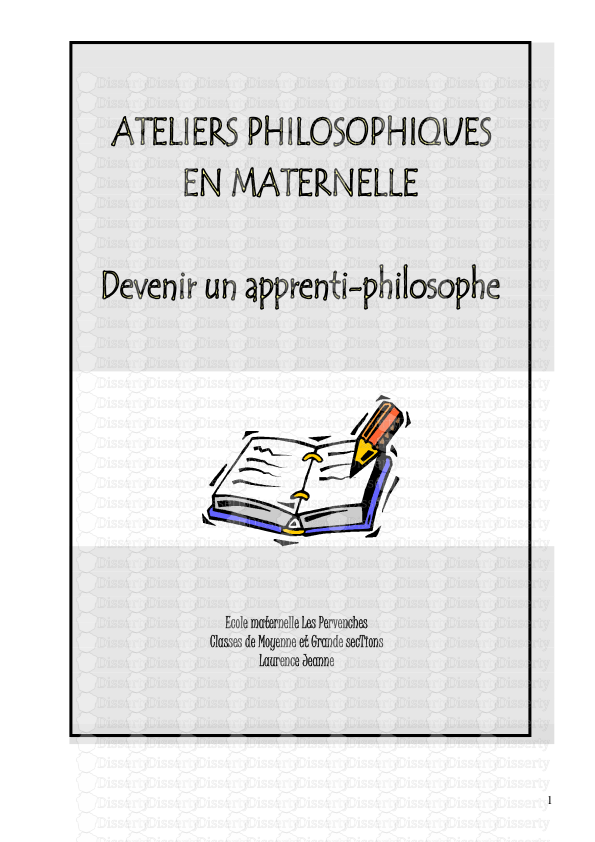






-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 02, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2850MB


