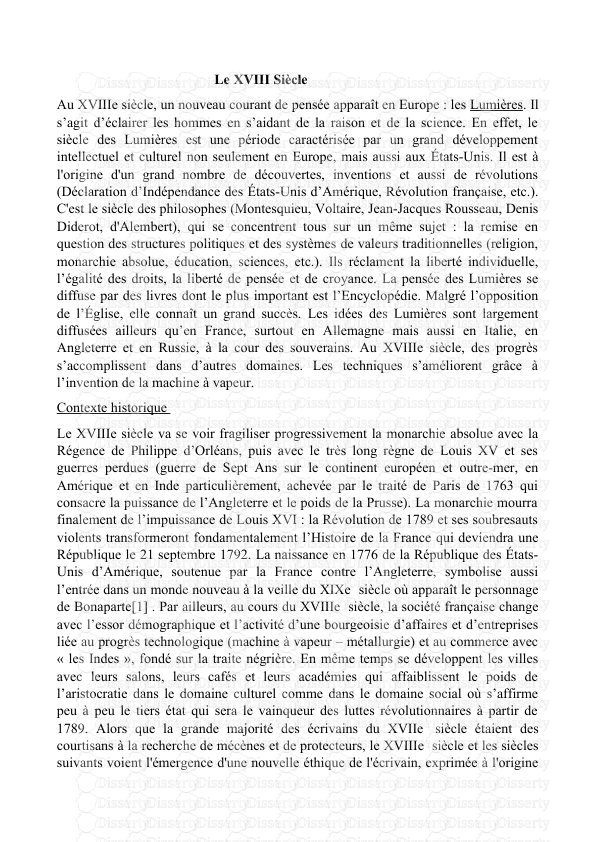Le XVIII Siècle Au XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée apparaît en Euro
Le XVIII Siècle Au XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée apparaît en Europe : les Lumières. Il s’agit d’éclairer les hommes en s’aidant de la raison et de la science. En effet, le siècle des Lumières est une période caractérisée par un grand développement intellectuel et culturel non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il est à l'origine d'un grand nombre de découvertes, inventions et aussi de révolutions (Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique, Révolution française, etc.). C'est le siècle des philosophes (Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, d'Alembert), qui se concentrent tous sur un même sujet : la remise en question des structures politiques et des systèmes de valeurs traditionnelles (religion, monarchie absolue, éducation, sciences, etc.). Ils réclament la liberté individuelle, l’égalité des droits, la liberté de pensée et de croyance. La pensée des Lumières se diffuse par des livres dont le plus important est l’Encyclopédie. Malgré l’opposition de l’Église, elle connaît un grand succès. Les idées des Lumières sont largement diffusées ailleurs qu’en France, surtout en Allemagne mais aussi en Italie, en Angleterre et en Russie, à la cour des souverains. Au XVIIIe siècle, des progrès s’accomplissent dans d’autres domaines. Les techniques s’améliorent grâce à l’invention de la machine à vapeur. Contexte historique Le XVIIIe siècle va se voir fragiliser progressivement la monarchie absolue avec la Régence de Philippe d’Orléans, puis avec le très long règne de Louis XV et ses guerres perdues (guerre de Sept Ans sur le continent européen et outre-mer, en Amérique et en Inde particulièrement, achevée par le traité de Paris de 1763 qui consacre la puissance de l’Angleterre et le poids de la Prusse). La monarchie mourra finalement de l’impuissance de Louis XVI : la Révolution de 1789 et ses soubresauts violents transformeront fondamentalement l’Histoire de la France qui deviendra une République le 21 septembre 1792. La naissance en 1776 de la République des États- Unis d’Amérique, soutenue par la France contre l’Angleterre, symbolise aussi l’entrée dans un monde nouveau à la veille du XIXe siècle où apparaît le personnage de Bonaparte[1] . Par ailleurs, au cours du XVIIIe siècle, la société française change avec l’essor démographique et l’activité d’une bourgeoisie d’affaires et d’entreprises liée au progrès technologique (machine à vapeur – métallurgie) et au commerce avec « les Indes », fondé sur la traite négrière. En même temps se développent les villes avec leurs salons, leurs cafés et leurs académies qui affaiblissent le poids de l’aristocratie dans le domaine culturel comme dans le domaine social où s’affirme peu à peu le tiers état qui sera le vainqueur des luttes révolutionnaires à partir de 1789. Alors que la grande majorité des écrivains du XVIIe siècle étaient des courtisans à la recherche de mécènes et de protecteurs, le XVIIIe siècle et les siècles suivants voient l'émergence d'une nouvelle éthique de l'écrivain, exprimée à l'origine par Voltaire, consistant en son autonomisation progressive par rapport aux pouvoirs (politiques, religieux). Cette éthique se construit dans le cadre de la lutte pour la liberté d'expression avec en corollaire une responsabilité accrue de ces écrivains dont les pouvoirs veulent désormais qu'ils répondent de leurs œuvres. Les mentalités évoluent elles aussi avec le développement de l’éducation et des sciences (Newton, Watt, Volta, Leibniz, Buffon, Lavoisier, Monge…) et la diffusion des œuvres de l’esprit, par le colportage et par le théâtre. La foi dans le Progrès que symbolisera l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert correspond à une déchristianisation Littérature française du XVIIIe siècle 2 progressive de la société que révèlent les conflits entre le haut et le bas clergé, ou les tensions avec les Jésuites (expulsés du royaume en 1764) ou l’évolution du statut des protestants, admis à l’état-civil en 1787. Mais l’Église catholique reste un pouvoir dominant qui lutte contre les Lumières en faisant interdire leurs œuvres et en obtenant, par exemple, la condamnation à mort du huguenot Jean Calas en 1762 ou, pour blasphème, celle du chevalier de La Barre en 1766, barbaries qui susciteront l’indignation de Voltaire. Serment du Jeu de paume, 20 juin 1789. À la même période, les conquêtes coloniales intéressent toutes les puissances européennes (voir Guerre de Sept Ans) et introduisent l’exotisme et le thème du bon sauvage qui nourriront les arts et la littérature, de Robinson Crusoé à Paul et Virginie par exemple. Les échanges se multiplient et les influences étrangères sont importantes autant pour la marche des idées que pour l’évolution des genres littéraires : c’est vrai en particulier pour l’influence anglaise avec ses avancées démocratiques (monarchie constitutionnelle) et la création romanesque ou poétique que découvrent beaucoup d’écrivains qui séjournent en Angleterre tout au long du siècle. L’influence allemande est aussi importante : elle nourrit le changement préromantique des sensibilités avec un apport marqué dans le domaine du fantastique et du sentiment national qui s’accentuera au siècle suivant. La vie sociale et intellectuelle Trois ordres existent en France : la noblesse (300 000 personnes), le clergé (130 000 personnes) et le Tiers Etat (25 millions de personnes). Une très forte hétérogénéité existe à l'intérieur de chaque ordre (entre grande et petite noblesse, prélats et curés de campagnes, bourgeois et paysans). La domesticité représente 10% de la population des villes. La France continue à avoir un rayonnement culturel à travers l'Europe. On copie ses œuvres, ses châteaux, on parle français dans les principales cours, Frederic II de Prusse invite Voltaire, Catherine II reçoit Diderot à Saint-Pétersbourg. Inversement, les philosophes français s'intéressent à l'étranger, à l'Angleterre notamment. C'est un siècle cosmopolite. En France, les lieux d'échanges intellectuels se déplacent. Ce ne sont plus seulement les salons des grands nobles (même ceux-ci pratiquent un échange plus libre, moins cérémonieux), mais aussi les académies (comme celle de Dijon pour laquelle Rousseau écrira en 1750 son Discours sur les sciences et les arts) ou les cafés (voir leur description dans Le neveu de Rameau, de Diderot). Ces nombreux lieux révèlent l'indifférence à l'égard du statut social de ses membres : les rencontres y sont plus libres, les sujets des conversations aussi (cour de francais). Le livre subit d'importantes modifications de forme et de fond. Le nombre de lecteurs augmente, ainsi que le nombre de livres (multiplié par 3 entre 1700 et 1770). La presse et les entreprises éditoriales des dictionnaires jouent un rôle grandissant. Le tirage d'un livre varie entre 500 et 4000 exemplaires. On publie de nombreuses "feuilles", billets volants, textes courts, facilement diffusés. Les écrivains continuent à se référer aux grands genre (tragédie, épopée, etc), mais leur modernité (et leur succès jusqu'à nous) réside dans la création de nouvelles formes littéraires, souvent brêves, notamment le conte ou le roman philosophique (mélange d'un récit et d'un savoir, Jacques est fataliste, Candide est optimiste, et les événements mettent à l’épreuve leur philosophie. La censure concerne surtout les ouvrages traitant de religion. Elle peut être à priori (avant la publication, refus du privilège royal) ou a posteriori (saisie, autodafé...). Voltaire, Diderot et Rousseau seront emprisonnés à la Bastille. Mais la Librairie royale (la censure) aura souvent une attitude de compromis. Notons aussi une nuance importante : si beaucoup d'écrivains ont été "persécutés", la plupart aussi ont connu une gloire importante et noué des amitiés avec des grands) L'écrivain profite encore du mécénat, essentiel durant tous le XVIIème, et qui se maintient, tout en se développant et se diversifiant au XVIIIème. Mais un manuscrit commence à rapporter. En 1777, le privilège de publication est transféré de l'éditeur à l'auteur, moment essentiel vers la reconnaissance du droit d'auteur. L'écrivain joue un rôle de plus en plus important, reconnu comme tel (prestige international de Voltaire, interventions multiples dans les affaires politiques, judiciaires ou religieuses, voir encore Voltaire dans l'affaire Calas). L'écrivain assure une domination morale en concurrence avec le clergé. Se dessine enfin à cette époque la figure du grand écrivain, à qui l'on rend visite, auquel on voue un culte. La pensée des Lumières Tout au long du siècle, des questions communes agitent les écrivains, questions qu'ils formulent de manière nouvelle, souvent laïcisée. Ils s'interrogent sur : La raison et l'expérience. Pour les philosophes, le mépris de la raison rend fanatique. Partant de l'expérience, seule source de connaissance (alors qu'au siècle précédent, on estimait que Dieu avait fourni l'esprit aux hommes), ils en viennent à écarter Dieu (c'est ce qu'on appelle l'empirisme). Les philosophes se sont donc occupés de science (voir Buffon) et, avec L'encyclopédie, "d'exposer l'ordre et l'enchaînement des connaissances", de façon à expliquer la nature, que des préjugés et des superstitions nous cachent ou nous obscurcissent. La nature est conçue comme une norme, une valeur idéale, une référence dans tous les domaines (ce qui permet de se passer de Dieu et des enseignements de l'Eglise). L'homme, la société, l'art, tout doit "suivre la nature". Après 1750, l'attention portée aux paysages et à la nature sauvage est un des signes du préromantisme. Dieu. Deux positions s'affrontent parmi les philosophes. Les déistes, dont Voltaire, qui suit l'enseignement de Newton pensent que l'architecture savante de l'univers suppose un dieu créateur, un "grand horloger". Ce dieu, sans rapport avec celui des dogmes des uploads/Philosophie/ le-xviii-siecle.pdf
Documents similaires










-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 23, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2507MB