1 Giordano Bruno (1548-1600) ne fut pas seulement un copernicien convaincu ; il
1 Giordano Bruno (1548-1600) ne fut pas seulement un copernicien convaincu ; il fut le premier à considérer l’univers comme infini et peuplé d’innombrables mondes, ouvrant ainsi la voie à notre conception moderne de l’espace. Pour cette thèse audacieuse, et pour quelques autres encore, cet esprit libre fut condamné par le terrible tribunal de l’inquisition. Refusant de se renier, il mourut sur le bûcher à Rome le 17 février 1600. 400 ans ont passé depuis sa mort : il importe encore de mieux connaître cette pensée magnifique, toujours mobile, à la frontière de la physique et de la philosophie. Cherchant passionnément à s’émanciper des vieux dogmes, Bruno pose en toute liberté des questions essentielles sur le monde et sur l’homme. Des questions encore actuelles… Statue de Giordano Bruno par Ettore Ferrari (1845-1929), élevée… en 1889 sur le Campo dei Fiori à Rome, lieu de son supplice. Mots-clés : Aristote, astronomie, Copernic, Église, hérésie, infini, Inquisition, physique, Ptolémée, Renaissance, théologie, voyage ***N 24 1999 2 SOMMAIRE Introduction. 3 Giordano Bruno, son époque, sa vie (1548-1600) 4 Le monde est-il fini ou infini ? Etat de la question au temps de Bruno 8 La sphère des étoiles fixes d’Aristote Aristote christianisé par Thomas d’Aquin L’aristotélisme au XVIème siècle : une forteresse encore debout. Copernic : une “révolution cosmologique” inachevée L’univers infini et animé de Bruno. 13 Le moment où la notion de sphère des étoiles fixes vola en éclats La nouvelle physique de Bruno Un univers doté d’une âme, une nature artiste La philosophie de Bruno Une pensée en liberté. 20 L’autorité ultime : sa propre raison Misère et grandeur de l’humanité : la morale de Bruno Philosophie et poésie Dans les griffes de l’inquisition 25 Bruno et l’Eglise catholique : des rapports plus complexes qu’il n’y paraît Les procès de Venise et de Rome (1592-1600) Une mort assumée Postérité de Giordano Bruno 28 Conclusion 30 Index 31 Bibliographie 32 - - - - - - - Auteurs : Benoît Mély avec la collaboration du chantier BT2 de l’ICEM Coordination du projet : Annie Dhénin Collaborateurs de l'auteur : Marité Broisin, Isabelle Dordan, Claude Dumond, François Perdrial et leurs élèves, ainsi qu’Yvette Afchain, Annie Dhénin, Colette Hourtolle, Michel Mulat, Christine Seeboth. Coordination générale du chantier BT2 de l’institut coopératif de l’Ecole moderne Michel Mulat Iconographie : Infographie : Annie Dhénin (d’après projets BT2) p.5, 8, 12, 17. Illustrations sous licence creative Commons / Wikipedia non attribuées : p. 3 G et D, 12, 14, 20. Illustrations sous licence Creative Commons / Wikipedia attribuées : p 1 (Rémi Jouan), 8 (Sailko), 13 (Marcin Szala), 16 (NASA), 24 (Werner B. Sendker), 29D (Torvindus). DR ; photos p. 29G Maquette : Annie Dhénin, février 2010 3 Introduction De Giordano Bruno, l’histoire a retenu d’abord sa fin tragique, à Rome, sur un bûcher de l’Inquisition catholique, le 17 février 1600, en la huitième année du règne du pape Clément VIII. Mais l’homme que le fanatisme religieux voulut ainsi réduire au silence définitif, qui était-il ? Quelle force le poussa à rompre avec l’Eglise et à parcourir l’Europe, publiant, enseignant, débattant sans relâche ? Aujourd’hui, quatre siècles après qu’elle s’est tue, sa voix a-t-elle encore quelque chose à nous dire ? Cet ouvrage voudrait donner des éléments de réponse à ces questions. Cela suppose d’entrer dans un univers culturel et mental quelque peu déroutant : celui de la Renaissance. Période passionnante mais complexe, faite de ruptures radicales avec le moyen-âge, parfois désigné comme le “temps des barbares”, et de continuités insoupçonnées, de novations hardies et de retours aux plus diverses traditions de l’antiquité. Bruno, penseur critique de la Renaissance, est pleinement immergé dans son époque. Entendre sa voix suppose de l’écouter, en quelque sorte, avec une oreille du XVIème siècle. Un seul exemple, lié à ce qu’il revendiquait comme son identité la plus profonde : le mot de philosophe. On comprendrait mal son projet, écrire et vivre en philosophe, si on ne percevait pas que ce mot, au XVIème siècle, ne recouvrait pas tout-à-fait la même réalité qu’aujourd’hui. En particulier, la différence tranchée que nous connaissons entre philosophie et physique était alors totalement inconnue. La physique (encore appelée philosophie naturelle) était traditionnellement considérée comme l’une des branches de la philosophie. A ce titre elle traitait du nombre d’éléments dans la nature, de la matière qui compose les astres, de la forme de l’univers… Bruno à son tour aborde ces questions en philosophe. Mais il les aborde en homme qui a lu Copernic, et qui a été convaincu par son idée fondamentale : la Terre n’est pas au centre du monde. Bruno ajoute même : nul astre, pas même le soleil, n’est “au centre du monde” : l’univers est infini. De cette intuition a jailli une œuvre multiforme, au carrefour de la physique et de la philosophie, inspirée par une nouvelle conception des rapports de l’homme et de l’univers. Une œuvre libre, qui mérite assurément d’être explorée. Nicolas Copernic, astronome polonais (1473-1543) « « Portrait de Giordano Phillipo Bruno d’après une gravure du "Livre du recteur" (1578, Université de Geneva) peut-être inspirée d’un portrait aujourd’hui perdu. On ne dispose d’aucun portrait de Bruno réalisé de son vivant. De rares témoignages le décrivent comme un homme petit, au visage mince, à la parole abondante. 4 Giordano Bruno, son époque, sa vie (1548-1600) Une formation religieuse Giordano Bruno, de son vrai prénom Filippo, naît en 1548 à Nola, en Italie, près de Naples, au pied du Vésuve. Son père est un sous-officier de l’armée du vice-roi d’Espagne (le royaume de Naples est alors intégré à la couronne d’Espagne), sa mère possède quelques terres. Après des études secondaires à Naples, il entre à 17 ans dans le plus grand couvent de la ville, de l’ordre des Dominicains1. Il y entreprend des études générales, puis de théologie2. Dans l’enseignement, donné en latin (comme dans toutes les universités d’Europe au XVIème siècle), deux autorités dominent : le philosophe grec Aristote et Thomas d’Aquin, l’illustre théologien dominicain qui en 1274 avait fini ses jours dans ce couvent même. Ordonné prêtre en 1573, Bruno, qui a pris le nom de frère Giordano, soutient avec succès en 1575 une thèse sur Thomas d’Aquin3. Le voilà à 27 ans docteur en théologie. La rupture avec l’Église (1576-1578) Remarqué de ses supérieurs, et peut-être même du pape Pie V, pour sa vaste culture et sa mémoire exceptionnelle, Bruno a devant lui une brillante carrière de théologien. Mais il se signale aussi par son indocilité. A la suite d’une querelle avec un autre Dominicain, devant qui il n’a pas hésité à défendre son droit à lire des auteurs condamnés pour hérésie4, il juge préférable de quitter le couvent pour Rome (février 1576). On retrouve peu après, cachés dans sa cellule, des ouvrages interdits, contenant notamment des passages d’Erasme5. S’estimant en danger, Bruno s’enfuit de Rome. Officiellement excommunié, c’est- à-dire rejeté hors de l’Eglise, il gagne le Nord de la péninsule italienne. Il vit de leçons particulières à Gênes, Venise, Padoue, Chambéry… Après avoir cherché un accommodement, il rompt totalement avec son ordre - mais garde le prénom de Giordano qu’il s’était choisi. Errances à travers l’Europe (1579-1592) Au printemps 1579, Bruno gagne Genève, haut-lieu du protestantisme. Il se convertit au calvinisme et s’inscrit à l’université, tout en gagnant sa vie comme correcteur d’imprimerie. Peut-être a-t-il vu dans la ville de Calvin un havre de tolérance religieuse. Mais la désillusion est rapide et brutale. Pour avoir dénoncé publiquement l’incompétence d’un enseignant de philosophie, proche des autorités religieuses, il est bientôt à nouveau excommunié par celles-ci, et doit à nouveau s’enfuir de crainte d’un procès (septembre 1579). Bruno s’établit alors à Toulouse, où il obtient par concours une chaire d'enseignant de philosophie (1579-81).Mais la menace d’une reprise de la guerre ouverte entre protestants et catholiques français le pousse à se rendre à Paris. Il y publie un traité (en latin) consacré à l’art de la mémoire, De l’ombre des Idées. Le roi Henri III est séduit. Amateur de culture italienne, et sans doute politiquement intéressé à laisser s’exprimer un philosophe rejeté à la fois par les catholiques et les calvinistes, il crée pour Bruno un poste de “lecteur extraordinaire” (c’est-à-dire exceptionnellement dispensé d’assister à la messe) au Collège des lecteurs royaux, le futur Collège de France. Bruno publie alors plusieurs œuvres, dont sa comédie Le Chandelier. 1 Dominicains, ou ordre des prêcheurs : ordre religieux fondé en 1216 par Saint Dominique, destiné à former des prédicateurs voués à la défense de la foi. 2 théologie : étude des questions religieuses à partir des textes sacrés d’une religion. 3 Intitulé de sa thèse principale : “Que tout ce que dit le Docteur Thomas dans sa ‘Somme contre les Gentils’ [les non-chrétiens] est vrai ”. Il était en effet interdit aux étudiants en théologie de l’ordre dominicain de s’écarter en quoi que ce soit de la pensée de Saint Thomas, surnommé le Docteur Angélique. 4 hérésie : opinion condamnée par une religion comme contraire à ses croyances fondamentales ou dogmes. 5 Erasme de uploads/Philosophie/ n24-giordano.pdf
Documents similaires

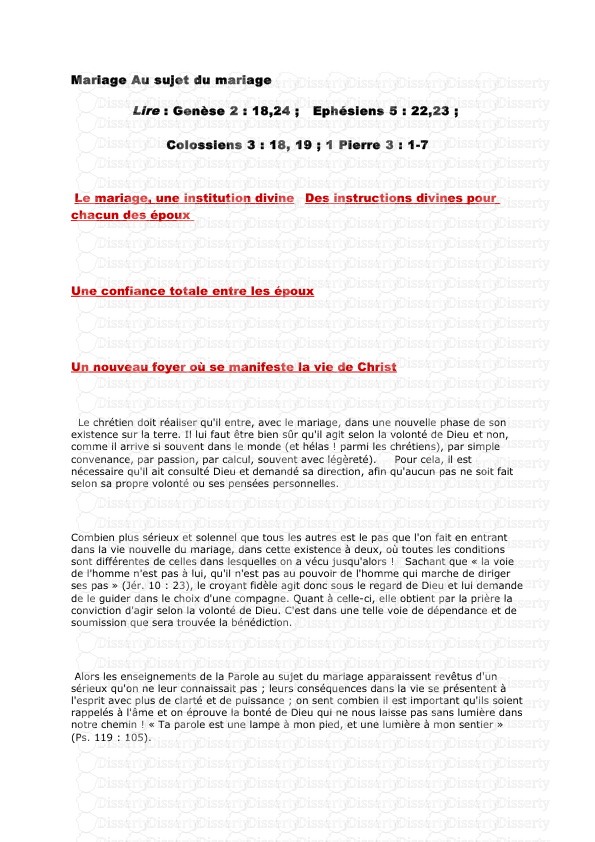








-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2023
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.9482MB


