AMBIVALENCE DU CALCULABLE ET CRISE DU JUGEMENT Jean Lassègue Centre Sèvres | «
AMBIVALENCE DU CALCULABLE ET CRISE DU JUGEMENT Jean Lassègue Centre Sèvres | « Archives de Philosophie » 2019/2 Tome 82 | pages 255 à 274 ISSN 0003-9632 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2019-2-page-255.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Centre Sèvres. © Centre Sèvres. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre Sèvres Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre Sèvres Ambivalence du calculable et crise du jugement Jean Lassègue Centre georg simmel, CnRs uMR 8131 – eHess, Paris Le but de cet article est de ressaisir sous un angle épistémologique les débats actuels sur la digitalisation du droit et de la justice pour essayer de prendre la mesure des transformations qui, dans ce domaine, mettent aujourd’hui en crise la notion de jugement. Cette crise peut être décrite d’un mot: c’est la délégation aux machines qui semble priver les humains d’une de leurs prérogatives les plus fondamentales, à savoir la capacité de produire un jugement de façon autonome. La notion actuelle de calcul et ses consé- quences dans la sphère du droit constituent donc le centre de gravité des pages qui suivent. Historiquement, on montrera que le projet de mécanisa- tion du jugement s’est constitué dès l’âge classique mais que ce sont les limi- tations internes de la calculabilité telles qu’elles ont été mises au jour dans les années 30 du siècle dernier qui ont, de façon paradoxale au premier abord, renforcé à l’extrême la tendance à la mécanisation, aggravant la crise qui affecte la notion de jugement en droit. On montrera cependant que ce moment de crise a l’avantage de révéler le cadre collectif nécessaire à l’ins- titution de l’instance juridique de jugement. s’il y a crise du jugement, il y a donc aussi moyen d’y pallier et de renouveler de l’intérieur le régime même de la légalité juridique. 1. IntéRêt de La nOtIOn de CaLCuLabLe POuR La PHILOsOPHIe du dROIt aCtueL Pour réussir à envisager la situation propre à la digitalisation du droit et de la justice contemporaine dans un cadre tel qu’une évaluation philoso- phique devienne possible, il nous paraît nécessaire de revenir au cœur épis- témologique de cette digitalisation, à savoir le concept de calculabilité. Il nous faut néanmoins commencer par justifier ce retour à l’épistémologie en répondant à deux objections préalables qui visent, à l’opposé, à tenter de séparer l’aspect épistémologique et l’aspect juridique de la notion de jus- tice digitale. Pour nous, c’est précisément cette séparation qui est l’indice Archives de Philosophie 82, 2019, 255-274 Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre Sèvres Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre Sèvres d’une crise dans la notion de jugement et c’est donc elle dont il faut d’abord commencer par prendre la mesure. 1.1. Le besoin d’épistémologie une première objection consiste à dire que l’on n’a pas besoin de connaî- tre les arcanes du concept logico-mathématique de calculabilité pour analy- ser les effets sociaux d’un tel concept sur le droit et la justice et que l’on peut donc sans dommage s’en tenir à ce seul domaine, déjà suffisamment vaste en lui-même quand on voit la multitude des changements opérés sur le droit par l’introduction de la digitalisation (dans le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle, la fiscalité, l’arbitrage, le procès, etc.). Cependant, cette objection, parce qu’elle suppose une dichotomie a priori entre le niveau conceptuel dont on est censé pouvoir faire l’économie et le niveau proprement social du droit est elle-même sujette à caution: sans cher- cher à réduire le conceptuel au social, ce sont au contraire les modalités sans cesse à renégocier de leur rapport qui permettent, selon nous, une évalua- tion philosophique de la situation juridique contemporaine. une étape épis- témologique ayant le concept de calculabilité pour objet est donc souhaita- ble dans l’analyse du droit et de la justice à l’ère digitale. une deuxième objection consiste à défendre l’idée selon laquelle invo- quer le concept de calculabilité dans le cas du droit et de la justice revient à leur tailler un costume trop grand car l’ère digitale touche également bien d’autres domaines, de la cartographie à la finance en passant par les trans- ports et le cinéma, et ne vise donc pas prioritairement le domaine juridique. Là encore, il s’agirait de dissocier le droit et la justice de l’épistémologie de la calculabilité en laissant entendre que leur digitalisation ne requiert pas d’analyse proprement épistémologique préalable, sauf à l’envisager d’un point de vue très général comme un cas parmi beaucoup d’autres. Il est éga- lement possible de répondre à cette objection et de préciser du même coup notre projet. Le domaine du droit et celui de la justice possèdent un objet spécifique qui les distingue de tous les autres domaines: la perpétuelle redé- finition de la norme sociale. Or c’est précisément du point de vue de la redéfinition de la norme en général que se situe le rapprochement philoso- phique possible avec l’épistémologie du concept de calculabilité: nous envi- sagerons en effet le concept de calculabilité du point de vue de la norme qu’il cherche à instituer en rupture avec le droit traditionnel et non des prouesses techniques que son incarnation informatique permet de réaliser. Quelle est cette norme? 256 Jean Lassègue Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre Sèvres Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre Sèvres bien que cela soit tout d’abord contre-intuitif dans le cas d’un concept de nature mathématique, le concept de calculabilité tel qu’il a été mis en lumière dans les années trente du siècle dernier, en particulier par turing 1, enveloppe une injonction, celle, pour résoudre un problème quelconque, de se mettre à la place de ce qu’exécute une machine effectuant un calcul sans signification (un algorithme). turing distingue radicalement le niveau des marques graphiques dont la combinaison s’opère en suivant des règles auto- matiques qui ne requièrent aucune intelligence d’une part et le résultat de cette combinaison que le calculateur humain interprète comme porteur de signification de l’autre. L’injonction contenue dans le concept de calculabi- lité issue de ce dualisme devenu radical 2 est donc bien l’expression d’une norme que l’on pourrait appeler l’« injonction de la réduction au mécanique » – le mécanique étant entendu ici comme combinatoire strictement gra- phique 3. aussi, contrairement aux apparences, ce point de vue normatif qui se trouve au fondement du concept de calculabilité a-t-il un sens social et son épistémologie se situe-t-elle de plain-pied avec la réflexion sur ce que la norme juridique tente d’instituer. Concevoir un rapport entre épistémolo- gie de la calculabilité et théorie juridique de la norme a donc philosophique- ment un intérêt parce qu’en situant la crise du jugement dans la compéti- tion entre les deux types de norme, il devient aussi possible d’envisager comment surmonter le problème. une fois ces objections levées et le rapport – encore à préciser – entre norme du calcul et norme juridique envisagé, il nous faut décrire plus avant ce que l’on pourrait appeler le « sens social » du concept de calculabilité pour rendre possible l’analyse des rapports qu’il entretient avec la norme juridique. 1.2. L’éthique du déterminisme et de la prédictibilité nous reprenons ici à notre compte l’expression d’« éthique » associée à des notions épistémologiques, comme a pu le faire david R. Lachterman dans The Ethics of Geometry quand il tentait de replacer la pratique 1. alan M. tuRIng, « On Computable numbers with an application to the entscheidungs - problem », Proceedings of the London Mathematical Society, Volumes 2-42, Issue 1, 1 January 1937, p. 230-265. 2. Historiquement, outre ses bases métaphysiques, ce dualisme est le fruit de l’idée de for- malisation telle qu’elle a été progressivement mise en place dans les travaux de Hilbert à par- tir du début du xxe siècle. Cf. antoine gaRaPOn et Jean Lassègue, Justice digitale, Paris, PuF, 2018. 3. sur ce point Jean Lassègue & giuseppe LOngO, « What is turing’s Comparison bet- ween Mechanism and Writing Worth? » dans barry s. Cooper, anuj dawar, and benedikt Löwe (eds.), How the W orld Computes, berlin, Heidelberg, springer, 2012, 450-462. L’ambivalence du calculable et la crise du jugement 257 Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 203.87.115.174 - 05/07/2020 01:42 - © Centre uploads/Philosophie/ambivalence-du-calculable.pdf
Documents similaires
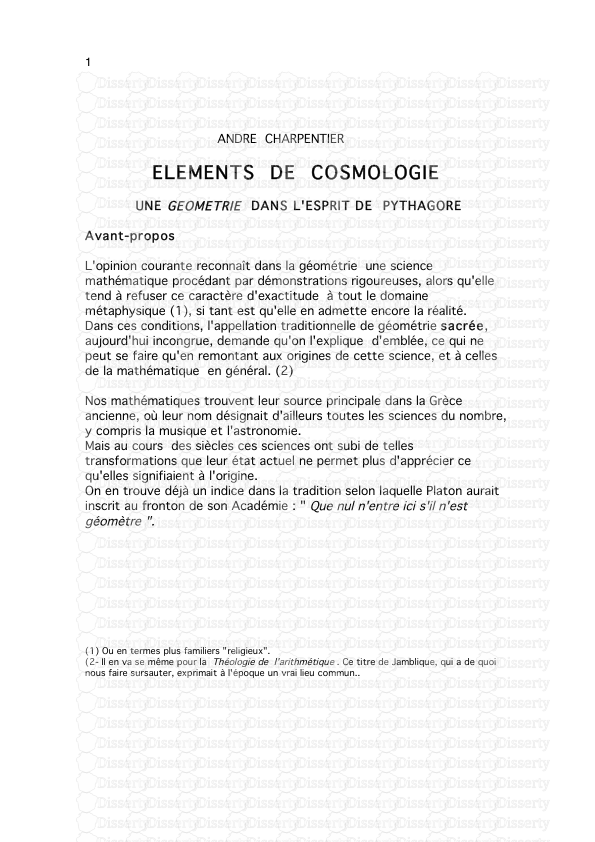









-
60
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 14, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4143MB


