Revue d'histoire des sciences et de leurs applications L'évolution de la pensée
Revue d'histoire des sciences et de leurs applications L'évolution de la pensée scientifique et l'histoire des sciences. Arnold Reymond Citer ce document / Cite this document : Reymond Arnold. L'évolution de la pensée scientifique et l'histoire des sciences.. In: Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, tome 1, n°2, 1947. pp. 97-113; doi : https://doi.org/10.3406/rhs.1947.2606 https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1947_num_1_2_2606 Fichier pdf généré le 07/04/2018 L'évolution de la pensée scientifique et l'histoire des sciences Le présent exposé n'est pas ce que l'on peut appeler une conférence. Il rentre dans le cadre des travaux qui sont discutés au Centre de Synthèse. En effet, les réflexions que je désire soumettre à votre examen sont nées des circonstances suivantes. Il y a douze ans, j'avais été chargé par l'Académie internationale d'Histoire des Sciences de voir comment l'enseignement historique des sciences pourrait être pratiquement réalisé, non seulement à l'Université, mais aussi dans les classes supérieures des établissements secondaires. Il m'apparut d'emblée qu'un tel enseignement ne pouvait viser à être complet, que pour être fructueux il devait s'en tenir aux traits essentiels du développement de la science, c'est-à-dire marquer les découvertes cruciales et l'éclosion de méthodes nouvelles. Dans ces conditions la première chose à faire, m'a-t-il semblé, était de fixer ces données essentielles sous la forme d'un schéma destiné à représenter non pas l'histoire même des sciences, mais plutôt les étapes de la pensée scientifique. Ce schéma une fois tracé serait communiqué aux savants que la question intéresse, puis remanié en tenant compte des critiques faites et des adjonctions proposées. Les tragiques événements qui ont bouleversé notre monde ont empêché la réalisation de ce projet. J'ai pu, cependant, publier (1) le texte primitif que j'avais exposé en juin 1935, dans une séance tenue ici même, et l'accompagner, sous forme de notes, des obser- (1) Philosophie spiritualiste, t. I, pp. 305-337. T. I. — 1947 98 revue d'histoire des sciences rations qui m'avaient été communiquées, soit oralement, soit par écrit à la suite de cette séance. Je voudrais reprendre la question à la lumière de ces critiques- el observations. * * * Que l'on me permette tout d'abord de rappeler la distinction que j'avais établie entre l'histoire de la pensée scientifique et l'histoire des sciences. « Cette dernière, disais-je, s'efforce de donner par époques et par régions un tableau aussi complet que possible de chaque science particulière, énumérant tous les savants qui lui ont voué leurs efforts et retraçant aussi bien leurs échecs que leurs victoires. « L'histoire de la pensée scientifique, au contraire, essaie de mettre en lumière les grands courants d'idées qui, pendant une période plus ou moins longue, déterminent la marche des sciences- au point de vue expérimental et théorique. « Cela dit, la pensée scientifique possède dans les diverses- étapes qu'elle franchit des caractères essentiels qui peuvent servir de cadre à l'histoire des sciences proprement dite et lui donner les points de référence dont elle a besoin. En d'autres termes, pour une période donnée, les caractéristiques de la pensée scientifique jouent vis-à-vis de l'histoire des sciences le rôle d'hypothèses ou d'idées directrices, exactement comme dans la physique ou la chimie, par exemple, une théorie sert à grouper des faits déjà connus et permet au savant de contrôler les faits nouveaux. « Mais, de même que ceux-ci peuvent ébranler la théorie dont ils sont censés dépendre, voire en provoquer l'abandon, de même aussi une étude plus approfondie de l'histoire des sciences peut modifier les caractères fondamentaux qui avaient été jusqu'alors attribués à la pensée scientifique de telle ou telle époque. Toutefois,, si imparfaitement que puissent être marqués ces caractères, ils n'en restent pas moins un guide précieux pour l'historien des sciences- dans les recherches spéciales qu'il effectue. » Je concluais ces considérations en disant : « Si maintenant l'on envisage la pensée scientifique dans son évolution, je crois qu'il est possible d'y distinguer les 5 grandes phases ou périodes que voici ', 1. La préhistoire. — 2. Les civilisations orientales. — 3. La civilisation gréco-romaine. — 4. La Renaissance et les temps modernes. — 5. La fin du xixe siècle et le xxe siècle. » l'évolution de la pe.xsée scientifique 99 * * * Trois problèmes surtout se posent au sujet des vues qui viennent d'être rappelées. Le premier est relatif au domaine que la pensés- scientifique doit embrasser. Le second concerne la légitimité qu'il y a d'envisager en elle-même l'évolution de la pensée scientifique ~ Le troisième enfin se rapporte au bien fondé des divisions proposées pour marquer les étapes de cette pensée. Au sujet de l'extension même de la matière à traiter, M. Henri Berr dans les observations qu'il voulut bien m'adresser, remarquait que la pensée scientifique doit embrasser non seulement les mathématiques, la physico-chimie et la biologie, mais aussi les sciences de l'esprit. M. Léon Brunschvicg est moins catégorique : « Je poserais, m'écrit-il, la question des limites de la science ou plutôt des limites du sens du mot, large ou étroit. Je ne suis pas sûr que la psychologie et la sociologie, même la biologie, aient atteint un positivisme du même ordre que les disciplines physico-chimiques. >»• La question reste difficile à trancher. En fait, nous constatons! que le terme de science s'emploie à propos de n'importe quel groupe de connaissances plus ou moins organisées. On parle en' effet de sciences mathématiques, mécaniques, etc. ; mais on parle1 aussi de sciences occultes, morales, esthétiques, etc. On use même- d'expressions telles que la science du savoir-vivre, la science de- l'équitation. Pour chercher à préciser la signification et l'étendue de e?- qu'est la science, s'adressera-t-on à la philosophie ? Mais on se- heurte alors à la même difficulté. Au xvine siècle, par exemple,, lorsque la philosophie défrayait les conversations mondaines, elle servait à désigner n'importe quoi et un traité de jardinage s'intitulait volontiers « philosophie du jardinage ». Ce qui est certain, c'est que depuis l'antiquité à nos jours, le- savoir scientifique a été compris différemment par les philosophes.. Aristote, par exemple, fait rentrer la métaphysique dans la science :. il la considère même comme la science première. Kant, au contraire, dénie à la métaphysique la possibilité même de se constituer comme - science ; il considère que seul le monde phénoménal perçu par ■ l'intuition sensible est capable d'être l'objet d'une connaissance - scientifique. Étant donné ces divergences, faut-il alors s'en tenir aux disciplines qui, tenues pour valables par le monde des savants, peuvent 100 REVUE D'HISTOIRE DES SCIENCES être classées systématiquement les unes par rapport aux autres ? Mais nul n'ignore combien une pareille classification est ardue. Tout d'abord, quels critères choisir pour opérer le groupement ? Auguste Comte, comme on le sait, vise à fonder une classification qui soit strictement objective, c'est-à-dire qui découle des caractères intrinsèques à la matière même de chacune des sciences à ordonner et il découvre ces caractères dans la généralité décroissante et la complexité croissante. Bacon estime, au contraire, qu'il est impossible de faire abstraction du sujet pensant et qu'il faut prendre comme critère de classement les facultés humaines (mémoire, imagination, etc.) mises respectivement en jeu pour acquérir telle ou telle science. Sous une forme naïve, Bacon soulève le même problème auquel se heurte aujourd'hui la physique du microcosme quand il s'agit de discerner dans les faits observés ce qui appartient en propre à l'objet et ce qui vient du sujet. Le tableau dressé par Ampère avec sa distinction entre sciences cosmologiques et sciences noologiques, paraît au premier abord opérer une heureuse synthèse entre l'objectif et le subjectif ; mais cette synthèse n'est qu'apparente. L'économie sociale, par exemple, est rattachée par Ampère aux disciplines noologiques et pourtant elle relève autant du domaine physique que du domaine psychique. Si le choix des critères de groupement reste très délicat, d'autres difficultés se présentent. Une bonne classification devrait pour les sciences jouer le même rôle que la table de Mendeléief pour les corps chimiques, c'est-à-dire prévoir la place qu'occuperont les sciences non encore constituées. Or, nous savons que l'espoir d'arriver à un pareil résultat est chimérique. Si utile qu'elle puisse être, une classification des sciences n'a jamais qu'une valeur provisoire, relative à l'époque où elle a vu le jour. Sur l'état actuel du problème qui nous occupe, les indications fournies par les dictionnaires usuels sont nettement insuffisantes : par contre, le dictionnaire philosophique de M. André Lalande peut nous orienter fructueusement. Celui-ci énumère les diverses acceptions du terme « science » pouvant signifier dans un sens large, soit le savoir en général, soit l'adaptation intuitive de la conduite à tenir, soit encore l'habilité technique, et dans le sens restreint qui, seul, nous intéresse ici : « un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité et susceptible d'amener les hommes l'évolution de la pensée scientifique 101 qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, ces conclusions étant de telle nature qu'elles ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels qui sont communs aux hommes en question, mais de relations objectives qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes uploads/Science et Technologie/ arnold-reymond-histoire-des-sciences.pdf
Documents similaires
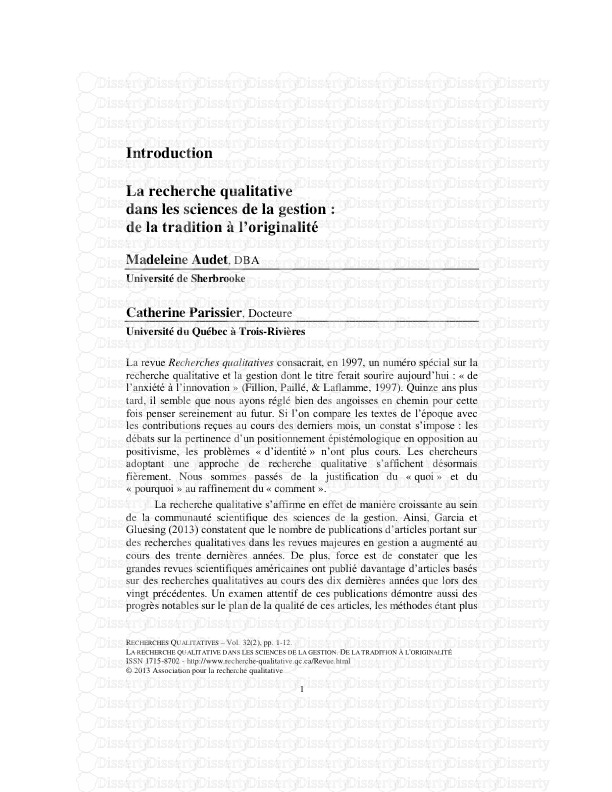









-
136
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 23, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9180MB


