_ :~ <~ ___ ~.::~~ _:_~_ ... > =--= __ è~~ PHI LOS 0 PHI EDE L . E S P RIT :1.1
_ :~ <~ ___ ~.::~~ _:_~_ ... > =--= __ è~~ PHI LOS 0 PHI EDE L . E S P RIT :1.1,1 COLLECTION FONDÉE PAR L. L1YELLE ET R. LE SENNE lU ~ ~ GENÈSE ET STRU81:URE . ) . DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE DE L'ESPRIT DE HEGEL par . 1 JEAN HYPPOLITE TOME 1 ... AUBIER, ÉDITIO~S MONTAIGNE, PARIS PHILOSOPHIE DE L'ESPRIT COLLECTION DIRIGÉE PAR L. LAVELLE ET R. LE SENNE JEAN HYPPOLITE GENÈSE ET STRUCTURE DE LA P~fNOMfNOLOtil( Dt L'tSPRIT DE HEGEL * AUBIER, ÉDITIONS MONTAIGNE, PARIS Droits de reproduction réservés pour tous pays. Copyright 1946 by Éditions Montaigne. A la mémoire de Lf:ON BRUNSCHVICG A M. f:MILE BRf:HIER. hommage respectueux. TABLE. DES MATIERES Pages PREMIÈRE PARTIE GÉNÉRALITÉS SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE Chapitre premier.- Sens et méthode de la Phénoméno- logie· .. , . . . . . .. . . . 9 11. - Histoire et Phénoménologie. . . 31 III.- Structure de la Phénoménologie. 54 DEUXIÈME PARTIE LA CONSCIENCE OU LA GENÈSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE DU CONCEPT 1 ntroduclion . . . . . . . . . . . . . Chapitre premier. - La certitude sensible. 11. - La Perception .. II 1. ----: L'Entendement. . . . . TROISIÈME PARTIE DE LA CONSCIENCE DE SOI NATURELLE A LA CONSCIENCE DE SOI UNIVERSELLE lnlroduclion.- Passage de la conscience à la conscience de 79 81 100 116 soi. . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Chapitre premier. - Conscience de soi et vie. L'indépen- dance de la conscience de soi. . . . . 151 II. - La liberté de la conscience de soi. Stoï- cisme et Scepticisme. . . 172 Ill. -La Conscience malheureuse. . . . . . • 184 592 TABLE DES MATIÈRES QUATRIÈME PARTIE LA RAISON SOUS L'ASPECT PHÉNOMÉNOLOGIQUÈ Chapitre premier. - La Raison et l'Idéalisme . . . . . . 211 II.- L'observation de la Nature. . . . . . . 223 III. - L'observation de 1 'individualité humaine. 250 IV.- La raison active. L'individualisme mo- derne . . . . . . . . . . . . . . . 262 V:~ L'œuvre humaine et la dialectique de l'aoc. tion. . . . . . . . . . . . . . . . 286 CINQUIÈME PARTIE L'ESPRIT. DE LA SUBSTANCE SPIRITUELLE AU SA VOIR DE SOI DE L'ESPRIT Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Chapitre premier.~ L'esprit immédiat. . . . . . · 323 II. -La première forme du Soi spirituel. 353 III.- Le monde de la culture et de l'aliénation. 364 IV. - L' « Aufklarung >> ou le combat des lu- . mières avec la superstition . . . 413 V. - La Liberté absolue et la Terrem, ou le deuxième type de Soi spirituel . 439 SIXIÈME PARTIE DU SAVOIR DE SOI DE L'ESPRIT A L'ESPRIT. ABSOLU Chapitre premier. -La Vision morale du monde. . . . . 453 Il.- L'esprit certain de lui-même. Le Soi ou la · Liberté (3e type du Soi spirituel). . . 475 .Ill.- La Religion. Mysticisme ou Humanisme. 511 SEPTIÈME PARTIE Conclusion. - Phénoménologie et Logique. Le savoir ab- w~. . . . 5M LISTE DES OUVRAGES UTILISÉS • • • • • • • • • • • • 584 Imprimé en France par ÜFFSE'l' NAUDEAn-REDON, à Poitiers. D. L., 4e trim. Ig56. - Imprimeur, no 110 PREMIJ1:RE PARTIE . GENERALITES SUR LA « PHENOMENOLOGIE » CHAPITRE PR EMIER SENS ET M:f:THODE DE LA PH:f:NOM:f:NOLOGIE Nous savons que la préface (1) de la Phénoménologie est posté- rieure à la rédaction de l'œuvre. Elle a été écrite après coup, quand Hegel a pu lui-même prendre conscience de son « voyage de découverte »;Elle est surtout destinée ,à assurer la liaison entre la Phénoménologie qui ,paraIt seule comme « première partie de la science» et la Logique qui, se plaçant à un autre point de vue que la Phénoménologie, doit constituer le premier moment, d'une encyclopédie. On conçoit donc que dans cette préface qui e,st un'e charnière entre la Phénoménologie et la Logique, Hegel se soit imtout préoccupé de donner une, idée générale de tout son. système. De même que dans la Différence de la philosophie de Fichte et de Schelling il s'élevait déjà au-dessus de ses devanciers, et en paraissant adopter le point de, vue même de Schelling le dépassait en réalité, de même dans cette. préface, mais cette fois-ci avec une pleine conscience, il se situe parmi les philosophes de son temps et manifeste sa propre originalité philosophique. Reve- nant aussi sur bien des points obscurs de la Phénoménologie, il y donne des indications précieuses sur la signification pédagogique de cette œuvre, sur sa relation avec l'histoire du monde en géné- ral, et sur sa conception propre de la négativité. L'introduction à la Phénoménologie (2) a été au contraire conçue en même temps que l'œuvre et r.édigée en premier lieu; elle nous paraIt donc renfermer la première pensée d'où toute l'œuvre est sortie. Elle est vraiment, au sens littéral, une intro- duction aux trois premiers moments de l'œuvre - c'est-à-dire: la conscience, la conscience de soi et la raison -; quant à la dernière pa'rtie de la Phénoménologie qui renferme les développe- ments particulièrement importants' sur l"Esprit et la Religion, (1) • Vorrede '. - Nous reviendrons plus tard sur l'histoire de la rédaction de la Phénoménologie de l'Esprif (chap. III, Ire parUe: Slruelure de la Phéno- ménologie). ' , (2) « EinleUung '. 10 GÉNÉRALITÉS SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE elle dépasse p,ar son contenu la Phénoménologie telle qu'elle est définie stricto sensu dans cette introduction. Hegel paraît avoir fait rentrer dans le cadre du développement phénoménologique ce qui tout d'abord n'était pas destiné à y, trouver place. Nous comptons revenir sl!r ce problème en étudiant la structure de l'œuvre. Nous nous contentons, ici de cette indication indispen- sable pour comprendre la portée exacte de cette « introduction» que nous nous proposons d'analy~er d'aussi près que possible. Son étude, beaucoup plus que celle de la préface, nous permettra en effet de déterminer le sens de l'œuvre que Hegel a voulu écrire, et III technique qui est pour lui celle du développement phéno- ménologique. L'introduction n'est pas en effet un hors-d'œuvre comme la préface qui contient toujours des renseignements géné- raux sur le but que l'auteur s'est proposé et les relations que son œuvre ·soutient avec d'autres traités philosophiques sur le même sujet (2). L'introduction fait au contraire partie intégrante de l'œuvre, elle est la position même du problème et détermine les moyens mis en œuvre pour le résoudre. En preIilier lieu Hegel définit dans cette introduction comment se pose pour lui le pro- blème de la .connaissance. Nous voyons comment il revient à cer- tains égards au point de vue de Kant et de' Fichte. La Phénomé- nologie n'est pas une nouménologie ou une ontologie; cependant . elle reste encore une connaissance de l'Absolu, car qu'y aurait- il d'autre à connaître puisque « l'Absolu seul est vrai, ou le vrai seul est Absolu (3) »? Mais au lieu de présenter le savoir de l'Absolu en soi et pour soi, Hegel considère le savoir tel qu'il est dans la conscience, et c'est de ce savoir phénoménal se critiquant lui-même qu'il s'élève au savoir absolu. En deuxième lieu Hegel définit I.a Phénoménologie comme développement et culture de la conscience naturelle vers la science, c'est-à-dire le savoir phi- losophique, le savoir de l'Absolu; il indique à la fois la nécessité d'une évolution de la conscience et le terme de cette évolution. En dernier lieu enfin Hegel précise la technique du développe- ment phénoménologique, il montre en quel sens ce développe- ment est l'œuvre même de la conscience qui est engagée dans l'expérience, en quel sens il est susceptible d'être repensé dans sa nécessité par la philosophie. I. Le problème de la connaissance. Idée d'une Phénoménologie. - Dans ses œuvres philosophiques d'Iéna, Hegel avait critiqué toute propédeutique à.la philosophie. On ne saurait rester sans cesse comme Reinhold sur le parvis du temple. La philosophie (1) Phénoménologie de l'Esprit, édition Aubier, t. l,p. 5 .. C'est désormais à cette traduction que nous renverrons. (2) Phénoménologie, l, p. 67. SENS ET MÉTHODE DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE Il n'est ni une logique comme « organ on » qui traite de l'instru- ment du savoir avant le savoir, ni un amour de la vérité qui n'est pas la possession même de la vérité. Elle est science et, comme le veut Schelling, science de l'Absolu. Au lieu d'en rester à la réflexion, au savoir du savoir, il faut s'enfoncer directement et immédiatement dans l'objet à connaître, qu'on le nomme Nature, Univers ou Raison absolue. Telle était la conception ontologique que Schelling opposait depuis ses essais de philosophie de la Nature à la philosophie de la réflexion qui était celle de Kant et de Fichte. Tel était également le point de vue de Hegel aussi uploads/Science et Technologie/ jean-hyppolite-genese-et-structure-de-la-phenomenologie-de-l-esprit-de-hegel-tome-1-aubier-1946-pdf.pdf
Documents similaires







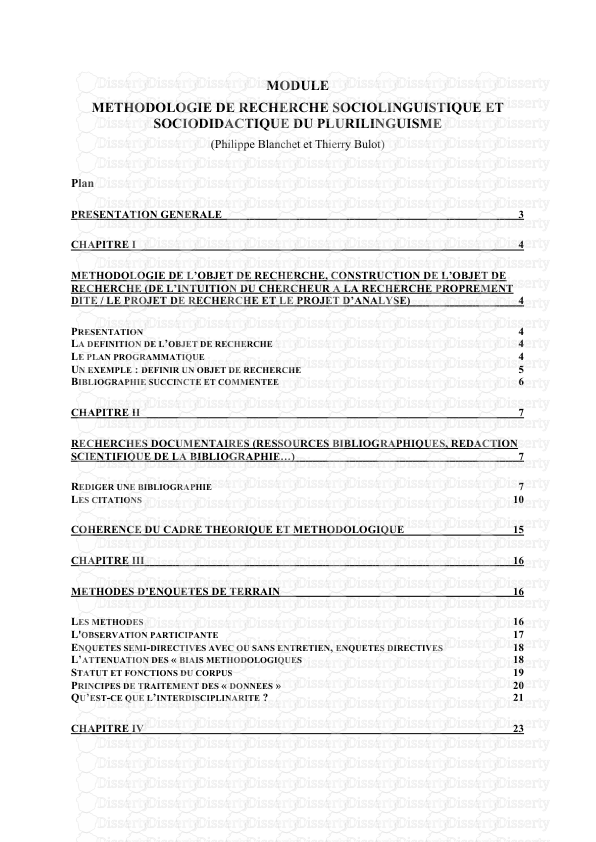


-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 20.6146MB


