Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-
Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 LES GRANDS PENSEURS DES SCIENCES HUMAINES La Petite Bibliothèque de Sciences Humaines Une collection dirigée par Véronique Bedin Sous la direction de Nicolas Journet Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 Dessins/vignettes de Clément Quintard (©Sciences Humaines). Maquette couverture et intérieur : Isabelle Mouton. Distribution : Volumen En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement, par photocopie ou tout autre moyen, le présent ouvrage sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français du droit de copie. © Sciences Humaines Éditions, 2016 38, rue Rantheaume BP 256, 89004 Auxerre Cedex Tél. : 03 86 72 07 00/Fax : 03 86 52 53 26 ISBN = 978-2-36106-382-5 Retrouvez nos ouvrages sur www.scienceshumaines.com http://editions.scienceshumaines.com/ 9782361063849 Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 5 PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE Les sciences humaines sont les plus jeunes d’entre toutes les sciences : elles n’ont que deux siècles, durant lesquels la recherche des faits, l’observation directe, l’expérience et le laboratoire deviennent leur marque de fabrique et les sciences naturelles, leur boussole. Mais leur divorce d’avec la philosophie ne les dis- pense pas de recouper sa route chaque fois que l’esprit de science se heurte à la complexité du fait humain. Le xixe siècle est celui de l’histoire et de l’évolution. Au tour- nant du xxe siècle, les disciplines s’airment : sociologie, linguis- tique, psychologie, économie, anthropologie connaissent leur âge « classique ». Le xxe siècle est celui des écoles, des courants et des grands récits : positivisme, behaviorisme, libéralisme, marxisme, structuralisme, néoévolutionnisme, cognitivisme… Ils rivalisent souvent et se succèdent sur le devant de la scène, avant de laisser la place à un grand doute : et si le progrès du savoir sur l’homme n’était au fond qu’illusion ? À cette autocri- tique les sciences humaines se sont montrées résilientes, et ont résisté par la spécialisation. Mais tous les chercheurs ne s’y sont pas résignés et l’ambition d’une nouvelle synthèse est toujours présente. Sans prétendre être exhaustif, ce livre ofre une présentation de 50 penseurs à travers les concepts majeurs qu’ils ont forgés, leurs recherches et leurs ouvrages : un indispensable vademecum de culture générale ! Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 7 En 1759 paraît la héorie des sentiments moraux, le premier ouvrage du philosophe écossais Adam Smith. Immédiatement, le livre connaît un succès international. Son objet : déinir les principes de la morale, saisir les vertus nécessaires au bon fonction- nement de la société et comprendre d’où vient le sens moral. Le principe de sympathie est au cœur de la héorie, car il permet l’existence du lien social. Ce n’est pourtant pas cet ouvrage que retiendra la postérité, mais l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), considéré par les économistes comme l’œuvre fondatrice de leur discipline. Tel est le paradoxe : l’auteur de la héorie des sentiments moraux est perçu comme l’inventeur de l’économie en tant que science indépendante de la philosophie morale et politique. Il en aurait fait une science positive, neutre, dégagée des interrogations morales qui préva- laient auparavant1. Un pas semble donc franchi avec La Richesse des nations… Comment Smith, philosophe et moraliste de for- mation, est-il devenu le père de la science économique ? Contre les mercantilistes Pour comprendre, il faut revenir sur la trajectoire intel- lectuelle qui l’a conduit d’un ouvrage à l’autre. Sa renommée vaut à Smith d’être choisi comme précepteur du jeune duc de Buccleuch. Il démissionne alors de l’université et entreprend de voyager en Europe. Il y rencontre Hume et Voltaire, d’Alembert, d’Holbach, Helvétius, Necker, Morellet, Turgot, Quesnay… 1- Voir les ouvrages de A. Hirschman, Les Passions et les Intérêts, Puf, 1980, de É. Halévy, La Formation du radicalisme philosophique, 3 vol., 1901-1904, rééd. Puf, 1995, et de L. Dumont, Homo Aequalis, 2 vol., Gallimard, 1977-1978, qui ont favorisé cette représentation. ADAM SMITH (1723-1790) De la morale à l’économie Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 Les grands penseurs des sciences humaines 8 François Quesnay (1694-1774), médecin à la cour de Louis XV, est le chef de ile des « physiocrates », qui font de l’agri- culture la source de la richesse. Si Smith n’adhère pas à ce cou- rant de pensée, il ne le voit pas non plus comme un danger très sérieux. Il juge en revanche le « système mercantile » comme réellement nuisible à l’intérêt général. Pour les « mercantilistes », l’accroissement de la richesse nationale passe par l’excédent de la balance commerciale et l’accumulation de métaux précieux. Ils sont donc favorables au protectionnisme, contre lequel Smith s’inscrit. Pour lui, la seule source de création de richesse est le travail. Accroître la richesse suppose ainsi en premier lieu d’ac- croître la productivité du travail et/ou la proportion de la popu- lation occupée à des tâches productives. Au premier rang des moyens permettant d’accroître la productivité du travail vient la division du travail, comme l’illustre bien le célèbre exemple de la manufacture d’épingles (voir encadré). L’enrichissement résulte donc des progrès de la productivité du travail et de la part de la population occupée à des tâches productives. Or, c’est l’accumulation du capital qui permet d’employer toujours plus de personnes à des tâches productives. L’accumulation capita- liste a sa source dans la recherche du proit par les marchands. Le désir d’enrichissement d’une classe de la société, les marchands, devient ainsi compatible avec l’intérêt général. C’est cette idée qu’illustre « la main invisible (du marché) », mécanisme par lequel des actes individuels intéressés peuvent contribuer à la richesse collective sans avoir d’intention bienveillante. L’économiste reste un philosophe La « main invisible » est une notion souvent interprétée comme étant au fondement du libéralisme économique : le maxi- mum de liberté accordée aux agents économiques, marchands en particulier – c’est-à-dire le minimum d’intervention de l’État dans l’économie – conduit au maximum de bien-être pour tous, grâce à ce mécanisme qualiié alors de « providentiel ». Mais Smith était-il vraiment ce libéral attaché à défendre le désir d’enrichissement marchand ? « Ce n’est pas de la bienveil- lance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 9 Adam Smith nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. » Cette citation de La Richesse des nations igure dans tous les manuels. Et la messe semble dite : non seulement Smith ne voit pas d’inconvénients à l’égoïsme, mais il airme au contraire que c’est un principe bienfaisant. On a donc souvent fait de Smith le fondateur du libéralisme économique et de La Richesse des nations un plaidoyer en faveur des propriétés auto- régulatrices des marchés. Avec Smith, les désirs capitalistes de quelques-uns étant favorables à tous, il devenait possible d’étu- dier les mécanismes marchands en ignorant la question morale liée à l’enrichissement, et de séparer ainsi la science économique de la philosophie morale. Cette vision est aujourd’hui battue en brèche. Le philosophe Michaël Biziou2 montre que la « main invisible » de Smith ne prétend pas être l’incarnation de la providence : Smith sait que les comportements individuels ont des conséquences qui peuvent aussi bien être bénéiques que nuisibles à la société. L’opinion qu’il a des marchands est méiante, et liée au fait que leurs agis- sements, s’ils ne sont pas encadrés par l’État, lui semblent plutôt nuisibles. Smith croit aussi au rôle de la vertu dans la régulation sociale, qui n’est pas entièrement assurée par les mécanismes marchands. Cette nouvelle lecture de Smith remet donc en cause la présentation habituelle de La Richesse des nations, qui ne devrait pas être séparée de la héorie des sentiments moraux. Smith n’a sans doute jamais pensé que la science économique devait tourner le dos à toute considération morale, ni épargner aux individus le souci d’être vertueux, et n’a pas airmé que la main invisible était capable à elle seule d’assurer l’équilibre et la prospérité générale des sociétés. Le Smith économiste ne doit pas éclipser le philosophe… Dorothée Picon 2- M. Biziou, Adam Smith et l’origine du libéralisme, Puf, 2003. Voir aussi son article consacré à A. Smith dans Penseurs de la société, éd. Sciences Humaines, coll. « PBSH », 2015. Ce document est la propriété exclusive de DANE SARR (danesarr@hotmail.fr) - 07-09-2016 Les grands penseurs des sciences humaines 10 La théorie du libre marché Porteur d’une double casquette d’économiste et de philosophe poli- tique, Adam Smith a donc laissé un héritage complexe, destiné à être dis- persé par la recherche d’une science économique plus autonome, capable de décrire les mécanismes de la croissance industrielle. Plus que par ses idées politiques – qui uploads/Science et Technologie/ les-grands-penseurs-des-sciences-humaines-pdf.pdf
Documents similaires








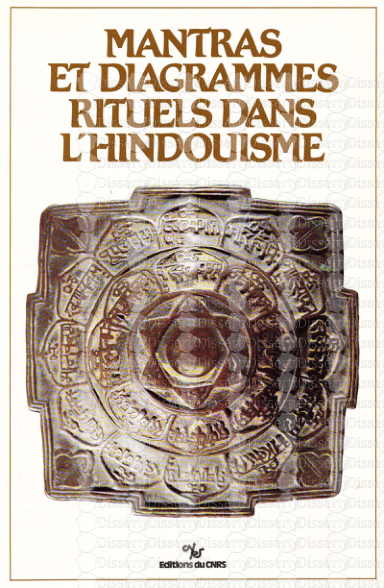

-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 15, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4128MB


