Partant d’un conte et de recherches lexicales guidées par des indices et des de
Partant d’un conte et de recherches lexicales guidées par des indices et des devinettes, cette activité permet de découvrir de nombreux mots emprun- tés. Elle conduit à la construction de la notion d’emprunt linguistique. A la découverte des mots venus d’ailleurs 1 Henriette Walter, Gérard Walter, Dictionnaire des mots d’origine étrangère, Larousse, 1998 1 2 EOLE — A la découverte des mots venus d’ailleurs © 2003 - SG / CIIP A la découverte des mots venus d’ailleurs Domaine EOLE Evolution des langues. Objectifs centraux Savoir repérer, à partir de différents indices linguis- tiques, des mots d’origines diverses. Connaître et comprendre la notion d’emprunt lin- guistique. Langues utilisées Albanais, allemand, anglais, français. Ancrage disciplinaire Français (lexique), histoire, géographie. Liens avec d’autres activités Vol. I (1H / 4H), Quelle langue parlons-nous donc ? traite aussi de la notion d’emprunt linguistique. Enjeux Les mots – comme les objets, les aliments, les idées et les humains – voyagent d’une région à une autre, d’une culture à une autre, d’une langue à une autre. Aucune langue n’est fermée sur elle-même. Toutes « empruntent » des mots à d’autres langues, voisines ou plus éloignées, et leur en « prêtent » en retour. Connaître des exemples de mots empruntés par le français à d’autres langues (mais aussi par d’autres langues au français), repérer les indices qui les signalent et prendre conscience globalement de ce mécanisme permet aux élèves de mieux comprendre comment les langues évoluent (le lexique en parti- culier), les relations étroites qu’elles entretiennent entre elles et la valeur de chacune. Mise en situation Le plus gros des mensonges Situation – recherche 1 A la recherche des mots voyageurs Situation – recherche 2 Des mots empruntés au français ? Synthèse Accueillir des mots, en donner, échanger Annexe documentaire 34 Qu’est-ce qu’un emprunt linguistique ? Script audio 10 45 min 30 min 20 min 30 min 45 min 3 5 7 8 Ecouter un conte et repérer des emprunts linguistiques. Construire une première définition de la notion d’emprunt. A l’aide d’indices, découvrir de nombreux emprunts et leurs origines. Inventer et rédiger une nouvelle partie du conte. Ecouter, dans d’autres langues, 3 textes inspirés du conte, (anglais, allemand, albanais) et repérer les emprunts au français. A l’aide d’une fiche de constat, faire « le point » sur ce qui a été découvert et appris. Audio 1 et 2 (CD 2 / 23-24) Doc. El. 1 Doc. 1 Doc. El. 2 Dictionnaires Audio 3, 4, 5 (CD 2 / 25-27) Doc. El. 3 Doc. 2 Doc. El. 4 Phases Durée indicative Contenu Matériel Page L’activité en un clin d’œil 3 EOLE — A la découverte des mots venus d’ailleurs © 2003 - SG / CIIP EOLE — A la découverte des mots venus d’ailleurs Déroulement 1. Passer l’enregistrement du conte « Le plus gros des mensonges » (Audio 1) ou distribuer le texte écrit (Document élève 1). Dans un premier temps, s’assurer de la compréhension générale de l’histoire. La discussion doit en particulier permettre aux élèves de comprendre pourquoi Assim a pu épouser la fille du roi. 2. Distribuer le Doc. El. 1, si cela n’a pas été fait, lire à nouveau le passage contenant le dernier mensonge. Demander aux élèves de porter leur attention sur le choix du lexique. Leur demander si quelque chose les frappe, s’ils ont des remarques à faire. Exploiter toutes les réponses qui permettent d’approcher la notion d’emprunt. Voici quelques pistes possibles : – mots qui représentent des choses que l’on ne « connaît » pas ici : jungle, iceberg, kangourou, litchis ; – mots peu ou pas connus (balafon) : la consultation du dictionnaire permet d’en connaître le sens et l’origine ; – graphies peu fréquentes dans l’orthographe fran- çaise : -wing (chewing gum), -walk (walkman), -ck (rock), -gg (jogging), -tch (litchis) ; – mots qui « sonnent » comme de l’anglais : walk- man, jogging, rock-and-roll. Si les réponses des élèves ne permettent pas cette 1re approche, les inciter à l’écoute plus fine des mots d’origine anglaise. (Audio 2 : le mensonge est relu). Objectifs Matériel Mode de travail Repérer dans un conte en français des mots provenant d’autres langues. Commencer à construire la notion d’emprunt linguistique. Audio 1 (le conte) + Audio 2 (seul le mensonge est répété) (CD 2 / plages 23-24). Doc. El. 1 (texte du conte). Groupe-classe. Cette phase est construite autour d’un conte dans lequel un roi promet sa fille à celui qui lui racontera le plus gros mensonge. C’est un jeune homme du nom d’Assim qui épousera la fille du roi, car son mensonge met en cause la dignité du souverain. Par ailleurs, Assim utilise dans son mensonge de nombreux emprunts que les élèves vont devoir découvrir. Mise en situation Le plus gros des mensonges Un emprunt linguistique Le mécanisme de l’emprunt suppose des contacts entre les langues et entre les personnes. Un emprunt est un mot ou une expression qu’un locuteur ou une communauté emprunte à une autre langue, sans le traduire, mais généralement en l’adaptant. Cette adaptation garde toutefois quelques « traces » du mot dans sa langue d’origine, c’est la raison pour laquelle de nombreux emprunts présentent des graphies peu courantes en français (p. ex. jogging, igloo). Souvent lorsqu’une langue emprunte un mot, elle emprunte en même temps « la chose » que le mot définit (p. ex. kiwi, kangourou). Pour des informations plus complètes sur la notion d’emprunt : cf. Annexe documentaire 34. 4 EOLE — A la découverte des mots venus d’ailleurs © 2003 - SG / CIIP Mots Hypothèses des élèves Origine du mot d’après quant à l’origine un dictionnaire etc… 3. Demander aux élèves de relever, dans le men- songe, tous les mots qui leur semblent provenir d’une autre langue. Pour cela ils devront émettre des hypothèses en observant la forme de certains mots et en se référant au lieu d’origine de ces mots. Sur une feuille, les élèves peuvent tracer un tableau à trois colonnes. Dans la première, ils notent tous les mots qu’ils imaginent être des emprunts et dans la deuxième leurs hypothèses sur l’origine de chaque emprunt. Dans un deuxième temps, ils remplissent la troi- sième colonne en indiquant l’origine donnée par les dictionnaires et effectuent ainsi une auto-correction de leur recherche. Les mots sont donnés ci-dessous dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le mensonge. L’origine des mots : comment est-elle indiquée dans un dictionnaire ? Tous les dictionnaires n’indiquent pas la même langue d’origine. Certains notent véritablement la langue d’origine, d’autres la langue par laquelle le mot a transité. Expliquer aux élèves que cer- tains mots peuvent avoir transité par une autre langue. Ici par ex. certains mots qui ont transité par l’anglais : jungle (hindi), iceberg (du norvé- gien), mocassin (de l’amérindien), kangourou (d’une langue aborigène australienne). De même de nombreux mots d’origine amérindienne et arabe nous sont parvenus par l’intermédiaire de l’espagnol. Il est important d’observer, avec les élèves, com- ment le dictionnaire qu’ils utilisent indique les emprunts, la langue d’origine. Mots Hypothèses des Origine du mot élèves quant à d’après un l’origine un dictionnaire jungle hindi, par l’anglais iceberg norvégien kangourou langue indigène d’Australie chewing-gum anglais orange arabe moccasins amérindien par l’anglais poncho espagnol walkman anglais rock-and-roll anglais jogging anglais balafon malinké (Guinéen) pagaie malais litchi chinois cravate allemand judo japonais épinard arabe EOLE — A la découverte des mots venus d’ailleurs 5 EOLE — A la découverte des mots venus d’ailleurs © 2003 - SG / CIIP Objectifs Matériel Mode de travail Découvrir de nombreux mots que le français a empruntés à d’autres langues. Découvrir l’origine de ces mots. Doc. El. 2 (séries d’indices). Doc. 1. Indices et devinettes (réponses). Dictionnaires. En groupes, en groupe-classe, puis individuel. Grâce à des séries d’indices qui leur sont distribués, les élèves découvrent de très nombreux emprunts. Ils les notent sur de grands posters, après avoir cherché leur langue d’origine dans un dictionnaire (cf. exemples ci-après). Situation-recherche 1 A la recherche des mots voyageurs 4. A l’issue de cette mise en situation, les élèves doivent aboutir à une 1re définition de la notion d’emprunt : C’est quand une langue accueille et intègre un mot d’une autre langue. Déroulement 1. Reprendre les emprunts trouvés dans le texte « Le plus gros des mensonges » et les faire noter par les élèves sur différents posters, préparés préalablement par l’enseignant selon le modèle ci-après. Chaque emprunt devra être suivi d’une parenthèse où sera inscrit le nom de la langue d’origine. Par exemple, sur le poster « langues asiatiques » inscrire : pagaie (malais). allemand, anglais langues hollandais, scandinaves francique Mots empruntés à des langues germaniques italien espagnol portugais Mots empruntés à des langues latines Titre et composition des différents posters à afficher en classe. Les mots qui figureront sur ces posters sont ceux que les élèves peuvent trouver à partir des indices (Document élève 2). Le terme « emprunt linguistique » peut commencer à faire partie de leur vocabulaire. La suite de l’ac- tivité permettra de compléter cette première défini- tion. (cf. Annexe documentaire 34) 6 EOLE uploads/Science et Technologie/ mots-ailleurs.pdf
Documents similaires







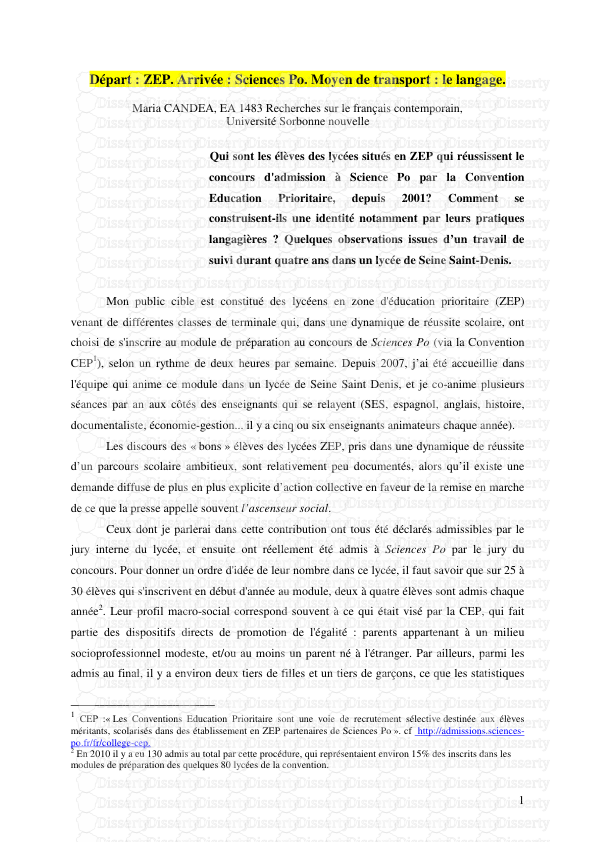


-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 28, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3194MB


