La maladie I «Avoir une maladie» et «être malade» II Les grandes maladies, de l
La maladie I «Avoir une maladie» et «être malade» II Les grandes maladies, de l’Antiquité à aujourd’hui III Peut-on donner un sens à la maladie et à la souffrance? Bibliographie Bruckner Pascal L’euphorie perpétuelle Canguilhem Le normal et le pathologique Descartes Méditation sixième Glucksmann André La fêlure du monde Lavelle Le mal et la souffrance Leibniz Essais de théodicée Nietzsche La généalogie de la morale Deuxième dissertation Ainsi parlait Zarathoustra Schopenhauer Le monde comme volonté et comme représentation Vergely Bertrand La souffrance Wolf Eric Le mal in Notions de philosophie III I «Avoir une maladie» et «être malade» La maladie peut être considérée comme une des formes du mal. Elle apparaît comme un accident majeur de notre vie, l’Evènement par excellence. Rien d’étonnant si, mortelle ou non, elle envahit la littérature et en particulier le roman. Si nous tentons une définition de la maladie, il conviendrait de distinguer entre «être malade» et «avoir une maladie». «Avoir une maladie»: cette première définition nous renvoie au discours médical. Pour le médecin, la maladie renvoie à un ensemble de symptômes à déchiffrer. Il s’agit d’une entité définissable, qui est toujours envisagée comme une altération, un dérangement, une perturbation de cet état qu’est la santé. La maladie apparaît alors comme un écart par rapport à une norme statistique et moyenne. Ajoutons que la médecine se propose une approche quantitative de la maladie, qui est considérée comme un objet mesurable et observable. Claude Bernard a illustré cette thèse en prenant l’exemple resté célèbre du diabète. Mais si l’attention au discours médical est nécessaire pour répondre à la question de la définition de l’état de maladie, il faut insister sur l’insuffisance de cette réponse qui ne constitue que la maladie et non pas le malade. Nous sommes renvoyés à la formule «être malade». La maladie, pour le malade, se vit dans le rapport qu’il entretient avec le monde et avec son corps souffrant. Dans sa thèse de médecine Le normal et le pathologique Canguilhem, prenant le contre-pied de l’approche quantitative de la maladie qui est celle de la médecine, la définit comme une relation qualitative du malade à son milieu. C’est au niveau de l’individu tout entier, non d’un organe, que la maladie est vécue comme un mal. «Etre malade, c’est vraiment pour l’homme vivre une autre vie, même au sens biologique du mot». La maladie, pour le malade, ne se réduit pas à une simple anomalie fonctionnelle, elle s’inscrit dans la totalité indivisible d’un comportement individuel. Et ce qu’elle exprime d’abord, c’est un sentiment direct et concret d’impuissance et de détresse, «sentiment de vie contrariée». Le malade est quelqu’un qui voit ses possibilités réduites, qui doit apprendre à vivre dans des conditions précaires, dans un champ rétréci. Le statut de malade, c’est d’abord l’expérience de la faiblesse, c’est pourquoi la loi prévoit des protections particulières pour le malade. Il faut qu’un statut juridique protège le malade, défende sa dignité, lui garantisse ce que peut-être il aurait du mal à obtenir dans l’état de dépendance qui est le sien. Ce que vit le malade, c’est d’abord un bouleversement de son rapport à son corps. Ce corps lui apparaît souvent comme étranger. Il vit sa maladie comme l’intrusion d’une altérité, comme une sorte d’hôte indésirable qui le possède. Son propre corps devient mystère, son intimité étrangeté. «Nous ne comprenons plus en nous ce qui se passe; nous sommes l’enjeu d’antagonismes où nous ne pouvons intervenir; notre sort se joue en nous, à notre insu, et malgré nous» note l’écrivain Claude Roy dans un livre où il relate sa propre expérience du cancer. Tout se passe dans un rapport au corps auquel il n’est plus possible de faire confiance. Le malade est celui que son corps trahit. On peut parler d’une expérience de dépossession, qui trouve en littérature une expression privilégiée dans le genre autobiographique. C’est «l’inquiétante étrangeté» pour reprendre les termes de Freud. C’est en ce sens que le malade devient un autre, le bouleversement du corps entraînant une radicale modification des rapports avec soi et avec les autres ( le regard des autres –pitié, gêne, dégoût, horreur- joue ici comme un miroir: il est verdict). La maladie renvoie toujours à ce que notre vie peut avoir d’irrémédiable, au fait qu’elle peut porter en elle sa propre mort. Avec l’irruption de la maladie, la vie nous annonce qu’elle est brève. La mort est ainsi inscrite au cœur du vivant. On comprend alors l’angoisse métaphysique que peut susciter la maladie. Descartes l’exprime dans la Méditation sixième. Le philosophe y avoue que la possibilité qu’il y ait des hydropiques le fait presque douter de la bonté de Dieu lui-même, «qui m’a donné une nature telle que je peux boire et, ce faisant, m’empoisonner tout en ressentant une soif inextinguible». La perte de la santé devient alors l’intolérable, l’insupportable et le scandaleux. Fritz Zorn, découvrant qu’il est atteint d’un cancer , exprime avec force sa haine de ce Dieu qui a pu laisser être un monde où l’homme est rongé par la maladie. «Dieu me frappe d’une maladie maligne et mortelle (…). Je suis le carcinome de Dieu. Rien qu’un petit carcinome, naturellement, à l’intérieur de ce vaste cadre, mais c’en est quand même un». II Les grandes maladies, de l’Antiquité jusqu’à nos jours Il n’est guère possible de parler de la maladie sans prendre des exemples concrets, tant les variétés et les variations de la maladie sont nombreuses. Il faudrait ici distinguer maladie chronique et maladie aiguë, maladie collective et maladie individuelle. Il faudrait aussi isoler ce qu’on appelle la grande maladie. André Glucksmann écrit dans La fêlure du monde «la grande maladie révèle sa grandeur en nouant une affection singulière à une corruptibilité générale et incoercible». Il est révélateur qu’à chaque époque semble correspondre un type de grande maladie spécifique: peste dans l’Antiquité et au Moyen-âge, tuberculose –mal romantique par excellence- au XIXème siècle, cancer et sida aujourd’hui, «abcès de fixation» en lesquels se cristallisent les préoccupations d’une société. On constate également qu’à travers les âges les modes d’interprétation de la maladie ont évolué. Les théories de causalité des maladies reflètent successivement les conceptions culturelles de l’ époque: la maladie châtiment divin dans les sociétés dominées par le sacré religieux, la maladie malédiction, sort jeté résultant du «mauvais œil» dans les sociétés archaïques, la maladie faute sociologique, contamination microbienne par négligence et absence de soins dans nos sociétés occidentales à partir du XIXème siècle. Les grandes maladies, comme les grandes guerres, sont toujours apparues comme des fléaux, des calamités. Ce fut d’abord, et dès l’Antiquité grecque, la peste, qui, par son intensité dévastatrice, apparaissait comme la maladie par excellence. L’Iliade d’Homère s’ouvre sur la description d’une pestilence décimant l’armée grecque devant Troie. Œdipe, dans la pièce de Sophocle Œdipe roi, doit affronter la peste collective dans sa ville de Thèbes. Thucydide, l’historien, décrit longuement la grande peste qui ravagea Athènes en 430 avant Jésus-Christ. On constate que dans le monde grec la peste prend toujours la forme d’une pestilence. Le terme est vague, mais doit être tenu pour essentiel. Car pour les Grecs le phénomène apparaît comme confus, polymorphe, impossible à cerner (incertitude qui concerne aussi bien les causes assignées que les remèdes appliqués). Comme l’écrit André Glucksmann dans l’ouvrage cité plus haut «telle est l’expérience grecque de la peste, qu’on ne sache d’où elle vient, qu’on ignore quand elle part, où elle va, et qu’ici et maintenant elle piège ses piégeurs». Si la peste est devenue symbole pour le monde grec, c’est d’abord parce qu’elle est maladie de la collectivité, celle en laquelle la collectivité se désagrège radicalement. Elle témoigne du chaos irréductible que toutes les sociétés portent en elles. En ce sens elle les confronte à un défi: rajeunir ou périr. Dans sa crise, dans son paroxysme, elle appelle le monde à se renouveler: d’où l’importance de toutes les cérémonies religieuses (entre autres celle du bouc émissaire), constituant une sorte d’auto exorcisme. La grande peste d’Athènes en 430 Au XIXème siècle s’impose la phtisie ou tuberculose. Cette maladie est d’abord l’objet d’une exaltation romanesque, voire romantique, qui héroïse et idéalise ceux qui en sont victimes. C’est le cas du héros de Thomas Mann dans La montagne magique dont la maladie fait un être à part, touché par la grâce. C’est Marguerite Gautier, la dame aux camélias, symbole de la «poitrinaire au grand cœur». Ainsi la tuberculose va être spiritualisée et auréolée de mystique. «Dans le panthéon médical du XXème siècle occidental, le cancer s’élève en alter ego et successeur de la tuberculose» constate André Glucsksmann. L’expérience du cancer en effet accumule et catalyse les angoisses. D’abord parce qu’il montre un corps habité par un autre corps, étranger et non intégrable (l’étymologie latine désigne un chancre, un cancrelat, qui ronge de l’intérieur). C’est une maladie qui ne frappe pas de l’extérieur, comme la peste, c’est pourquoi il est difficile de la diaboliser. Ensuite, le cancer s’entoure d’un mystère qui n’est pas encore entièrement dissipé. Il a constitué le premier grand échec de la médecine contemporaine. «L’homme occidental uploads/Sante/ philosophie-la-maladie.pdf
Documents similaires




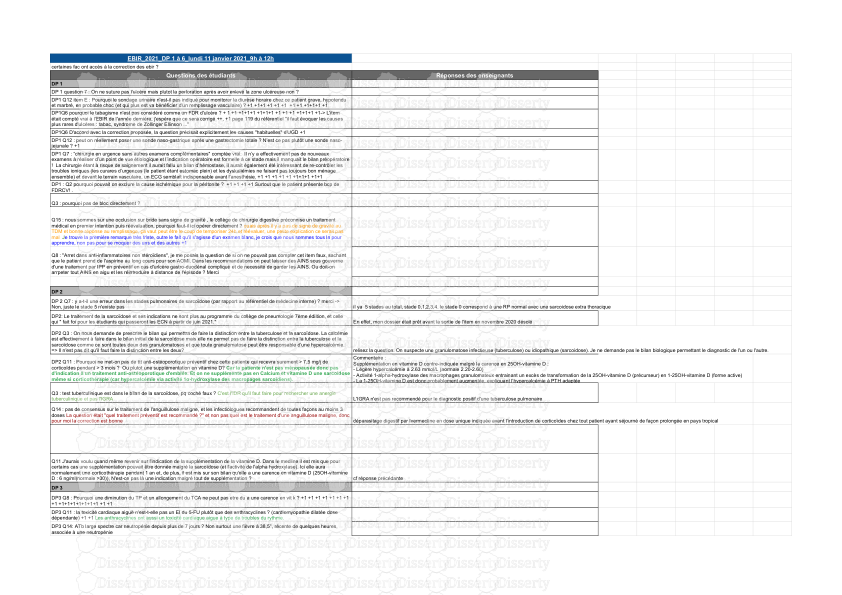





-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 23, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.2437MB


