Architecte-conseil Définition de la mission de l’architecte-conseil 74 Conseil
Architecte-conseil Définition de la mission de l’architecte-conseil 74 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement Haute-Savoie Architecture, villes & territoires • février 2021 Article 1er de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : "L'architecture est une expression de la culture. La création archi tecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public (…)." Retenons que : • L ’architecture, expression de la culture, répond aux attentes toujours renouvelées de la société qu’elle sert. Elle est de son temps et traduit les spécificités de la diversité des cultures. • L ’intérêt public est le cadre légitime qui enjoint la collectivité à veiller à ce que les intérêts privés s’inscrivent dans le respect du contexte territorial. Elle peut organiser les moyens humains nécessaires pour garantir l’atteinte de cette exigence. Article R.111-27 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exté rieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Retenons que : • Le projet ne se définit pas uniquement dans son rapport au pro gramme, au budget et aux règles. Il doit nécessairement porter une attention spécifique à son environnement architectural, urbain et paysager. L ’appréciation de la qualité de ce rapport rend légitime le recours à un professionnel, l’architecte-conseil, qui peut aider l’autorité compétente (le maire en général) à mesurer la pertinence du projet. Article R.431-8 du Code de l’urbanisme : "Le projet architectural comprend une notice précisant : 1. L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2. Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant appa raître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aména gements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement." Retenons que : • Il appartient au porteur de projet et à son concepteur (archi tecte ou non) de proposer une lecture objective et claire des éléments qui caractérisent le lieu du projet en pre mier lieu, et de justifier de l’ensemble des partis pris qui assurent l’intégration du projet dans cet environnement. La collectivité est en droit d’attendre cette démonstration. L ’ar chitecte-conseil peut aider les porteurs de projet dans cet exer cice et les accompagner vers une élaboration progressive du projet en lien avec le contexte. Éléments de contexte La Haute-Savoie est l’un des départements français où s’exerce l’une des pressions démographiques les plus fortes. Depuis plus de 20 ans, elle accueille en moyenne 10 000 habitants supplé mentaires chaque année. Cela correspond à la construction d’une ville de 100 000 habitants toutes les décennies dans un espace contraint par sa topographie, ses montagnes et ses lacs, et reconnu pour la qualité de ses patrimoines et de ses paysages. Le territoire doit organiser cet accueil tout en veillant à la maî trise de la qualité de son cadre de vie. La qualité architecturale, urbaine et paysagère de chaque transformation doit faire l’objet d’une étude attentive et exigeante. Le sens de l’action de l’archi tecte-conseil se fonde sur les attentes exprimées par la loi. L’architecte-conseil : partenaire du projet L ’institution construit le territoire en veillant aux équilibres entre développement et préservation de l’espace, entre innovation et maintien de la qualité des lieux. Elle définit le projet urbain et pay sager. Elle propose le cadre de cet essor et dispose pour cela d’ou tils techniques, juridiques et fiscaux avec lesquels elle écrit la règle commune : l’intérêt collectif. Quotidiennement, l’espace se construit de la succession des pro jets portés par celles et ceux, individus ou sociétés, qui répondent aux nécessités de leurs intérêts privés. Le permis de construire ou d’aménager sanctionne l’acceptation ou le refus de leurs proposi tions. Cette formalité administrative, nécessaire, cherche à assu rer une évolution maîtrisée du paysage. Elle n’est cependant pas la caution de la qualité architecturale ou paysagère. Tout au mieux permet-elle, dans le meilleur des cas, d’éviter que le plus inappro prié ne se réalise. L ’architecture s’accorde mal du manichéisme. Elle est une dis cipline de mesure, de débat, de confrontation, de contradiction parfois. Elle est le fruit d’une pensée synthétisant les enjeux com plexes du programme, les conditions du site, les attendus d’un commanditaire, et ne sait souffrir d’aucune vérité. La maturation du sujet, l’élaboration de ses arguments, la détermination judi cieuse des choix conduisent progressivement à la concrétisation de son dess(e)in. Son appréciation nécessite de rendre intelligible ce cheminement intellectuel. La règle s’en arrange mal, surtout si elle seule doit être l’outil de jugement. La demande d’autorisation d’urbanisme n’intervient qu’à l’aboutis sement du projet. Le maire en a la responsabilité. Il a le devoir de justifier sa décision. L ’architecte-conseil lui apporte sa compétence pour évaluer en toute objectivité la cohérence du projet. Il peut interroger son auteur pour obtenir de lui qu’il étaye son propos et justifie ses choix, techniques, esthétiques et volumétriques. Il peut, au besoin, débattre avec lui de la pertinence de son raisonnement. Il est le partenaire de l’élu auquel il propose des clés de compré hension qui peuvent fonder les bases d’un argumentaire décision nel. L ’accompagnant régulièrement, il l’aide également à forger les critères de son exigence. Il est le partenaire du porteur de projet qu’il reçoit, avec lequel il échange et vérifie que le projet répond de la manière la plus juste à son objet. Il peut animer sa réflexion en cours. Il est le partenaire de l’architecte concepteur, son interlocuteur éclairé, celui qui est en mesure de comprendre toute la complexité de sa mission et peut l’aider à formaliser les arguments d’un projet audacieux ou plus simplement à ouvrir de nouvelles voies d’inves tigations lorsque que le sujet le nécessite. Il est le partenaire des institutions, ABF et urbanistes, pour les quelles il est le révélateur de situations mal engagées en interve nant tôt dans le suivi du projet en cours de maturation. L ’architecte-conseil est un interlocuteur qu’il convient de rencon trer au plus tôt dans le processus de projet afin de pouvoir béné ficier du moment le plus favorable à la discussion entre tous les acteurs. Il est disponible gratuitement. Un réseau, régulièrement formé La Haute-Savoie compte actuellement 37 architectes-conseil, tous praticiens, réunis au sein d’un réseau. Ils apportent leurs compétences directement sur 213 des 280 communes du dépar tement. Pour les autres territoires, les porteurs de projet peuvent prendre rendez-vous avec un architecte-conseil au siège du CAUE. Les architectes-conseil sont réunis 2 fois par an pour échanger sur leurs pratiques, se rencontrer, et bénéficier de formations complémentaires sur des thèmes annuels. L ’une de ces ren contres a lieu sous la forme d’une visite d’une journée, en juin. La seconde se tient systématiquement au CAUE. Elle est l’occasion de présenter le bilan des services de conseil et d’effectuer des formations portant sur le sens de la mission d’une part, et sur les évolutions du droit à l’urbanisme d’autre part. Mise en place de la mission de l’architecte-conseil extrait des conventions d’étude du territoire Préalablement à la mise en œuvre du service de conseil, il est important que l’architecte-conseil puisse prendre connaissance du territoire et de ses acteurs. En lien avec les élus et les services de la collectivité, il s’agit de lui permettre de parcourir le terri toire et de comprendre les enjeux de son développement et de son aménagement. L ’étude de territoire fait l’objet d’une convention spécifique. Elle se conclut par une synthèse mettant en avant les principaux enjeux relatifs à la qualité des paysages, des ensembles urbains et des architectures du territoire qui constitue un cadre à la mission de conseil architectural qui se développe en lien avec la collectivité. À cette fin, l’architecte-conseil, accompagné du CAUE, prend attache auprès des représentants de la collectivité dont il a la charge afin de s’imprégner du projet de territoire porté par les élus. La collectivité peut l’aider dans cette tâche en facilitant les ren contres avec les élus et les techniciens. L ’architecte-conseil parcourt le territoire et formalise sa propre compréhension de ce dernier en s’intéressant aux trois axes sui vants : caractère du paysage, qualité des ensembles bâtis, spé cificités architecturales. Il uploads/s1/ de-finition-architecte-conseil-2021.pdf
Documents similaires







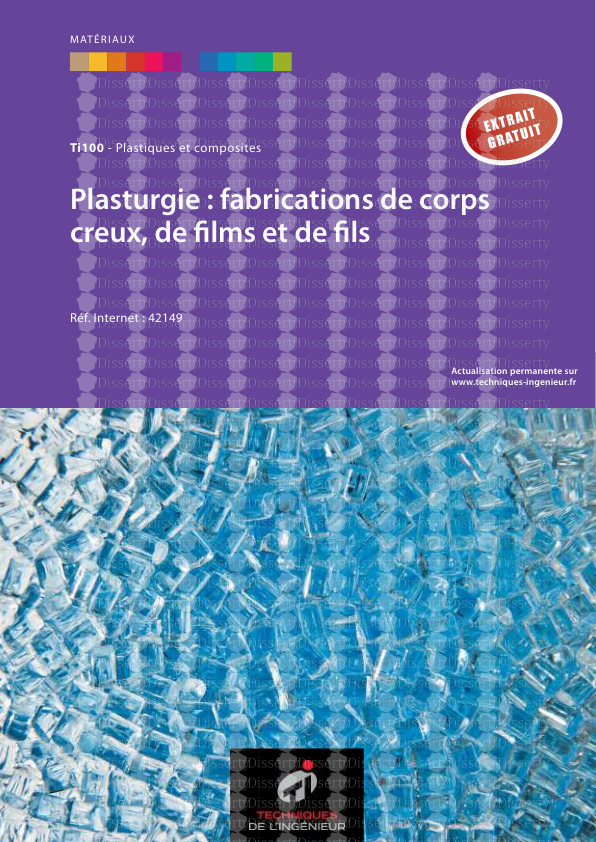


-
95
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 22, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 2.2172MB


