Préface Quatre pages, intitulées « Théorie de la décadence », ont contri- bué p
Préface Quatre pages, intitulées « Théorie de la décadence », ont contri- bué plus que tout le reste du livre à la réputation des Essais de psychologie contemporaine. Quatre lignes, même, sont dans la mémoire de tous ceux qui s'interrogent sur ce concept fluide et brûlant Un style de décadence est celui où l'unité du livre se décompose pour laisser place à l'indépendance de la page, où la page se décompose pour laisser place à l'indépendance de la phrase, et la phrase pour laisser place à l'indépendance du mot (p. 14)'. C'est de style, donc, qu'il est question, dans cette phrase à trois niveaux. Les écrivains lexicologues sont visés bien sûr Gon- court, Huysmans qui déplacent le mot, le recherchent, l'inventent le néologisme est un signe de décadence. Pourtant, ce ne sont pas eux qui ont suggéré cette « théorie », mais un poète décadent non pas dans la forme mais dans l'esprit, décadent par l'intelligence de la décadence. Pour Bourget et ses contemporains, Baudelaire est encore un être double un profil de poète « analyste » un autre de mystifi- cateur. L'auteur des Essais de psychologie s'intéresse avant tout aux Fleurs du mal, mais il n'oublie pas les « paradoxes outran- ciers » et les « mystifications laborieuses » de l'autre Baudelaire. Dans Le Parlement, où il tient une chronique, il nous le montre, élève à Louis-le-Grand, traduisant magnum proventum par « grande provende » pour épater ses maîtres et ses camarades, ou récitant des vers au beau milieu d'un bain public, ou sortant d'un 1. Je renvoie, entre parenthèses, aux pages de la présente édition. Essais de psychologie contemporaine confessionnal en traitant le curé d'imbécile'. Bourget fait la part du génie et « la part de mystification », et dans celle-ci la part de « la légende » les anecdotes « pullulent sur son compte, vraies ou fausses2 » et de ce que rapportent ceux qui ont connu Baudelaire. Banville pourtant lui fit grief de ses contributions à la légende il conteste, dans une lettre publiée au Gil Blas le 21 octo- bre 1883 (quelques jours après la publication des Essais de psy- chologie), les allusions de Bourget aux mystifications de Baude- laire, produisant son témoignage à lui Eh bien, mon cher poète, on vous a trompé comme dans un bois et, sur ce point, la part une fois taillée à la légende, rien ne demeure avéré et il ne reste rien du tout. J'ai été, moi (pardonnez ce haïssable moi), un des amis intimes j'ai eu la joie, l'inestimable fortune de rencontrer Baudelaire et de l'aimer, lorsqu'ilvenait d'avoir vingt ans depuis ce moment-là jusqu'à celui où il nous fut enlevé, je n'ai pas cessé de le connaître intimement, et je vous jure que son esprit robuste, précis, essentiellement français, et que sa chère âme ont toujours été pour moi clairs comme de l'eau de roche. Ah défiez-vous des gens qui ont connu Baudelaire' Banville et Bourget se séparent sur ce double du poète, son ombre légendaire. Mais au-delà, un autre désaccord apparaît, à partir duquel nous pouvons mieux comprendre le point de vue de Bourget, la position où s'est placé l'auteur des Essais de psycho- logie contemporaine. Banville appartient à un certain xix6 siècle romantique, idéa- liste le poète éclaire le monde. Bourget à un autre XIXe siècle, et son livre est un de ceux qui le font le mieux comprendre. En dépit de la permanence du pessimisme qu'il observe et sur laquelle nous reviendrons, et malgré toutes sortes de transmissions ou d'héritages, une rupture s'est produite dans le xdc6 siècle. Une nouvelle religion est apparue, que l'on nommera science ou réel, avec ses dogmes le scientisme, le réalisme, le positivisme. Le Bourget de 1880 mêle encore, dans une certaine mesure, ces deux XIXe siècles, mais il appartient au second. Plus tard, il séparera explicitement le xnce siècle «chimérique», qui commence en 1. "Au concours général », Le Parlement, 5 août 1880 et « Moqueurs et moqués », ibid., 22 septembre 1880. 2. « Moqueurs et moqués », ibid. 3. Banville, Lettres chimériques, Charpentier, 1883, p. 279. Préface 1789, et le XIXe siècle « scientifique ». Le siècle de Musset aboutis- sait « à la plus douloureuse et à la plus impuissante des anar- chies », et c'est contre cette douleur et cette impuissance que s'est produite la réaction de 1850. Les noms de Renan, de Taine, de Flaubert, de Dumas fils, des Goncourt, de Baudelaire sont parmi ceux qui symbolisent le mieux cet effort des lettres françaises pour se dégager du mirage romantique'. Bourget écrit ceci en 1922. Lorsqu'il étudiait Renan, Taine, Flaubert, Dumas fils, Goncourt ou Baudelaire, au début des années 1880, il n'insistait guère sur ce rôle rupteur. Son point de vue s'est radicalisé. Il a rallié ceux qu'il nommait alors avec méfiance, « les apôtres de la réaction ». On le voit évoluer, déjà, au fil de la longue genèse des Essais de psychologie. Le lien va lui apparaître de plus en plus étroit, par la notion même de décomposition, entre la décadence et la démocratie, qui accomplit sa « besogne d'éparpillement ». En 1880, il se sentait contemporain de son siècle Que nous haïssions la démocratie ou que nous la vénérions, nous sommes ses fils, et nous avons hérité d'elle un besoin impérieux de combat. Le XIXe siècle obscur et révolutionnaire est dans notre sang (.).Catholiques ou athées, monarchistes ou républicains, les enfants de cet âge d'angoisse ont tous aux yeux le regard inquiet, au cœur le frisson, aux mains le tremblement de la grande bataille de l'époque (p. 58). Ce Bourget de trente ans, qui ressemblait à Rastignac et à Julien Sorel, selon Élémir Bourges, avec quelque chose du dandy et de l'officier de hussards2, c'est l'auteur des Essais de psycho- logie contemporaine. Il n'est plus exactement un débutant, commence à marquer son territoire, à exercer une influence. Son premier article de critique a paru dans La Renaissance littéraire et artistique, le 28 décembre 1872' il a vingt ans. Dans les années 1870, il publie des vers dans diverses revues, et les réunit en recueils. De La Vie inquiète (1875) auxAveux (1882), où toute une 1. Quelques témoignages, t. I, p. 256 (« Réflexions sur le xtx" siècle », 1922 à pro- pos du livre de Léon Daudet Le Stupide xiif siècle). 2. Élémir Bourges, « Un critique M. Paul Bourget », le Gaulois, 18 octobre 1883, p. 1. 3. « Le roman d'amour de Spinoza », recueilli quarante ans plus tard, en 1912. dans le tome 1 des Pages de critique et de doctrine (p. 205-215). Essais de psychologie contemporaine section est intitulée « Spleen », on voit s'affirmer l'inspiration baudelairienne, parfois jusqu'au mimétisme Enfer ? Néant ? Effort nouveau ? Divin séjour ? Qui sait ton mot, ô dur voyage sans retour' ? Mais il suffit de citer ces deux vers, si imbus soient-ils des Fleurs du mal, pour que l'on comprenne que là n'était pas sa vocation. Parallèlement, il entreprend une carrière de critique et de chroniqueur, il collabore à La Revue des deux mondes (« Le roman réaliste et le roman piétiste », 15 juillet 1873, contre les naturalistes et Zola), au Siècle littéraire (« Notes sur quelques poètes contemporains », 1er avril 1875), à La Vie littéraire (un article sur Musset, 3 mai 1877 une longue étude, « La genèse du roman contemporain », 15, 22 août, 5 septembre 1878), au Globe, en 1879-18802. Bourget, toute sa vie, aura collaboré à de nombreux journaux et revues, écrit d'innombrables articles. Mais la collaboration décisive, la plus importante pour sa réputation et pour la concep- tion des Essais de psychologie contemporaine, est celle qu'il assure, d'une part, au Parlement, à partir du 1er janvier 1880, jusqu'au 27 décembre 1883, et qu'il poursuit jusqu'en 1886, de façon moins régulière, dans le Journal des débats, lorsque celui-ci absorbe Le Parlement3 d'autre part, à la revue bimensuelle fon- dée et dirigée par Juliette Adam La Nouvelle Revueoù, entre le 1. Dans un poème intitulé La Mort (Les Aveux), qui rappelle naturellement Le Voyage des Fleurs du mal. D'autres exemples de ce mimétisme baudelairien « Tu les voyais, mon âme (.)(Débauche), rappelant le début d'Une charogne; ou « Ma jeu- nesse ne fut qu'une longue agonie » (Spleen), calqué sur l'incipit de L'Ennemi « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». 2. Sur ces années de formation et ces collaborations de presse, il faut consulter le chapitre que leur consacre Michel Mansuy dans son livre Un moderne, Paul Bourget: de l'enfance au « Disciple » (Deuxième partie, chapitre M « Premières années de journalisme, 1879-1881 »). Je renvoie le lecteur, s'il veut en savoir plus sur « le premier Bourget », à ce livre fondamental. Mais je tiens aussi à remercier son auteur, Michel Mansuy, qui m'aouvert généreusement ses archives personnelles. 3. Voir l'article de I. D. McFarlane, « La collaboration de Paul Bourget au Parlement et au Journal des débats », Les Lettres romanes, 1er novembre 1957 et 1" février uploads/s1/ essais-de-psychologie-contemporaine 1 .pdf
Documents similaires




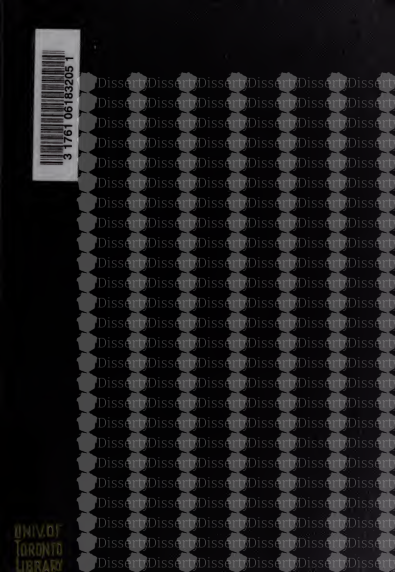





-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 26, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 3.1406MB


