The Library SCHOOL OF FHEOLOGY AT CLAREMONT WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLA
The Library SCHOOL OF FHEOLOGY AT CLAREMONT WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA par FLICHE : Membre de l'Institut nu de Jo 15cue des Lares de Montlier Pofenou à. de le à gs Lonres | de Rennes HISTOIRE DE L'ÉGLISE KXKKXK KKYK x IS TOIRE DE L ÉGLISE DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'A NOS JOURS D PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE … AUGUSTIN FLICHE & VICTOR MARTIN 9. EE : Du prenfier Concile du Latran à lavènement d'Innocent HI | (1423-1198) 4 par | un LRU 4 Doy nt s de Mon pellie Raymonde F a | Jean FO BLOUD & GAY. 1948 Theologu Hs brary SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California Universite et Southern Coliform. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE à ; # Pendant la pér'ode qui va du premier coneile du Latran (1123) à l'avène ment d’Innocent 111 (1198), l'orientation donnée à l’Église par Grégoire VII rbain IT se précise, s’amplifie et se développe. De plus en plus, le Saint-_ iège prend en mains la direction des affaires ecclésiastiques et, tout en conti nuant à favoriser l'essor de la vie religieuse dans les différents domaines _ de la pensée et de l’action, cherche à exercer sur le gouvernement des pays chrétiens une influence qui tend parfois à dépasser les limites du spirituel. n s’achemine ainsi vers une monarchie pontificale qui s'efforce de subor- donner les États aussi bien que les Églises à ses directions et qui trouvera n expression finale sous le pontificat d’Innocent III (1198-1216). Acceptée par les souverains du second quart du xur® siècle, cette évolution sera ensuite _ contrariée par des princes de tendances absolutistes, Frédéric Barberousse nri VI en Allemagne, Henri IT en Angleterre, Philippe Auguste en. rance, sans que s’amoindrisse pour ,cela l’élan imprimé aux organisations ses ou charitables. Be He : ae 5 CET SC 9 e e = 7 9e 3 i _ La période qui fait l’objet du présent volume n’étant que le prolongement de la précédente, les indications de bibliographie générale données. tomes VII et VIII s’appliquent à elle. On les complétera seulement sur quelques points. À 7 / dre Sens L =. Sources. _ Les collections de textes, répertoires et instruments de travail ne varient pas. On ajoutera aux ouvrages cités aux tomes VII et VIII le livre, récem- ent paru, de L. HazPHEn, {nitiation aux études d'histoire du moyen âge, s, 1940, où l’on trouvera de précieuses indications aussi bien sur les ils de documents historiques que sur les répertoires bibliographiques : les grands dépôts d’archives auxquels il y aura lieu de plus en plus de ourir, au fur et à mesure que l’on avancera dans la période médiévale. ?C - Av an £ À _L Sources ÉPisroLaIREs. — Ce groupe conserve -sa place prédominante. a correspondance des papes, en particulier celle d’Innocent LE (1130-1143), Adrien IV (1154-1159), d'Alexandre III (1159-1181), reste, en raison mêmé es caractères précédemment signalés, la partie la plus essentielle de la docu- ntation. Beaucoup de bulles ont été publiées dans la Patrologie latine de E (PL. L., CLXVI et suiv.), mais on peut déplorer l'absence d’éditions ues analogues à celles d’E. Caspar pour le registre de Grégoire VII. | en est de même pour les autres recueils épistolaires qui complètent utile- nt les bulles pontificales. Parmi eux figurent d’abord celui des lettres de saint Bernard ($. Bernardi epistolae) dont une bonne partie a été recueille du vivant de l’auteur par son secrétaire, Geoffroy d'Auxerre (P. L., CLXXXIL 7-716), et les 808 lettres de Thomas Becket publiées dans Materials for the History of Thomas Becket, édit. Roserrson, Londres, Rolls Series, t. V, VI IÏ. D’autres personnages ecclésiastiques ont laissé des correspondances tiles en renseignements: tels Hildebert de Lavardin, évêque cu Mans, archevêque de Tours, Étienne de Senlis, évêque de Paris, Henri de , archevêque de Reims, Arnoul de Lisieux, Pierre de Blois, ‘Étienne i, Jean de Salisbury. RCES CANONIQUES. — Le mouvement canonique, si ‘intense SOUS ‘ats de Grégoire VII (1073-1085) et d’Urbain II (1088-1099), s’est k ‘ 8 BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE ralenti au début du x siècle. Cf. P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu’au Décret de Gratien, t. Il, Paris, 1932, p. 127 et suiv. Vers 1140, une codification nouvelle est intervenue avec la Concordantia discordantium canonum de Gratien, plus connue sous le nom de Decretum, édit. E. Frispsere, Corpus . juris canonici, pars prior, Leipzig, 1879 ; pour son utilisation, voir G. MozLar, Introduction à l'étude du droit canonique et du droit civil, Paris, 1930. III. SOURCES DIPLOMATIQUES. — On consultera les mêmes recueils que pour la période précédente, notamment les Constitutiones et acta publica regum et imperatorum, t. I. Les actes de Lothaire [TT ont paru dans une autre série in-40 des M. G. H., les Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. VIII, 1927. Pour l'Angleterre, les Regesta regum anglo-normannorum de Davis s’arrêtent à 1154; pour le règne de Henri IT, on aura surtout recours. au Recueil des actes de Henri Il, roi d'Angleterre et duc de Normandie, concer- nant les provinces françaises, édité par L. Drerisre dans la collection des Chartes et diplômes de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1909-1916, 3 vol., et, en ce qui concerne l’Angleterre, au répertoire utile bien que déjà ancien de R. W. Evron, Court, Household and lünerary of King Henry I, Londres, 1878 ; pour la fin du xrre siècle, on se reportera à L. LanpoN, The ltinerary of King Richard I, Pipe Rolls Society, Londres, 1935. Pour la France, les règnes de Louis VI et de Louis VIT ‘n’ont pas encore paru dans la collection des Chartes et diplômes ; à défaut, on pourra: utiliser pour le premier de ces règnes : À. Lucmatre, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne, Paris, 1890, où un bon nombre d’actes sont analysés. IV. Sources PoLÉMIQUES. — Les grands problèmes relatifs à la constitution de l’Église et aux rapports de l’Églisé avec les États, malgré un certain ralen- tissement dans la controverse, ont continué à faire l’objet d’opuscules et de traités pendant le xn® siècle. On retiendra surtout les noms d’Honorius d'Autun, de Geroch de Reichersberg, de Jean de Salisbury, d’Otton de Frei- sing, d’Étienne de Rouén, de Giraud le Cambrien, qui sont les écrivains les plus saillants de la période, mais dont l’œuvre a été moins étudiée par les historiens modernes que celle des polémistes de l’âge précédent. Les éditions de ces écrivains et d’autres, moins importants, seront indiquées dans les chapitres qui les concernent. On aura recours avant tout, comme pour l’époque grégorienne, aux Libelli de lite imperatorum et pontificum, saec. XI et XII conscripti, t. IL et LIL. V. Sources NARRATIVES. — Quelques-unes des chroniques universelles ou nationales signalées au tome VIII (p. 9) s’étendent à la période qui suit le premier concile du Latran. D’autres sources du même ordre présentent un intérêt primordial pour l’histoire ecclésiastique du xn£ siècle. Les prin- cipaux historiographes sont le cardinal Boson et Jean de Salisbury avec son Historia pontificalis, pour la papauté ; Albert de Stade, Otton de Freising, Otton Morena pour les pays d’Empire; Richard le Poitevin, Robert de Torigny, Guillaume de Nangis, pour,.la France ; Orderic Vital, Guillaume de Malmes- bury, Eadmer, Henri de Huntingdon, Jean de Hexham, Gervais de Cantor- béry, Ralph de Diceto, Guillaume de Newburgh, enfin les Gesta Regis, œuvre anonyme mais de toute première valeur, largement utilisée par Roger de Hoveden, pour le royaume anglo-normand. Il faut ajouter à ces œuvres de premier plan des Annales comme les Annales Placentini et les Annales Ja- nuenses, des chroniques monastiques telles que le Chronicon S. Petri pipi Senonensis de Clarius, la Chronique de Morigny, le Chronicon Urspergense, des biographies : vies de saint Bernard par Guillaume de Saint-Thierry et -” Geoffroy d'Auxerre, vie de saint Norbert, vie de Louis le Gros par Suger, vies de saint Thomas Becket et de saint Hugues de Lincoln. La croisade BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 9 a donné lieu à une abondante littérature que dominent Odon de Deuil, Guil- laume de ‘Tyr, Richard de Caen. Les grands recueils où sont éditées ces œuvres ont été indiqués aux tomes VII et VIII, de même que les répertoires où elles ont été recenséés. II — Travaux. Les collections d'histoire de l’Église ayant trait à la période 1123-1198 ont été indiquées au tome VIII (p. 10), de même que les volumes des histoires générales ou nationales qui englobent les x1-xri® siècles. Dans l’Histoire générale sous la direction de G. GLorz, le tome IV, 17€ partie de l'Histoire du moyen âge, œuvre de E. Jorpax, est intitulé Allemagne et l'Italie aux XIIS et _ XIIIe siècles, Paris, 1939. Il n’y a rien à changer à ce qui a été indiqué-aux tomes VII et VIII pour les dictionnaires et autres ouvrages d'ensemble. La série des Jahrbücher der deutschen Geschichte fournit pour le xn® siècle comme pour la période grégorienne une documentation de tout premier ordre pour les rapports de la papauté avec l’Empire et avec les différents états occidentaux. On uploads/s1/ histoire-de-l-x27-eglise-9-1.pdf
Documents similaires








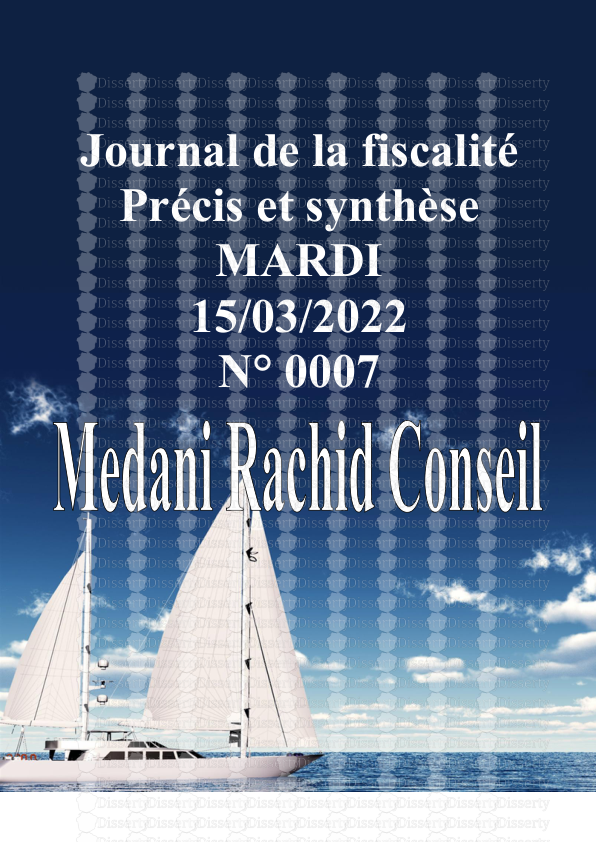

-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 02, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 16.0262MB


