Armand Colin L'ANALYSE DES ERREURS : UN BILAN PRATIQUE Author(s): Clive Perdue
Armand Colin L'ANALYSE DES ERREURS : UN BILAN PRATIQUE Author(s): Clive Perdue and Rémy Porquier Source: Langages, No. 57, Apprentissage et connaissance d'une langue étrangère (MARS 1980), pp. 87-94 Published by: Armand Colin Stable URL: https://www.jstor.org/stable/41681061 Accessed: 10-07-2019 20:31 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Armand Colin is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Langages This content downloaded from 193.194.76.5 on Wed, 10 Jul 2019 20:31:09 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Clive Perdue París VlII-Vincennes L'ANALYSE DES ERREURS : UN BILAN PRATIQUE ♦ L'analyse des erreurs systématiques - par opposition aux lapsus, lapsus linguae ou lapsus calami - nous donne accès, selon les termes de S. P. CORDER (1967, et dans ce numéro) à la « compétence transitoire de l'apprenant ». L'analyse des erreurs (AE) comporte le relevé d'erreurs parmi les productions des apprenants - les « don- nées textuelles » de CORDER 1973 - , leur description au moyen d'un cadre gramma- tical de référence commun à la langue « source » (Ll) et à la langue « cible » (L2) et la vérification au moyen de « données intuitionnelles » ultérieures 1 des hypothèses suscitées par la description. D'un point de vue chronologique, une telle analyse sou- lève trois séries de problèmes : 1) trouver l'erreur ; 2) décrire l'erreur ; 3) expliquer l'erreur, que nous examinerons tour à tour. Au début des années 1970, je me suis trouvé confronté à des préoccupations prati- ques, en l'occurrence la préparation d'un cours de grammaire anglaise pour franco- phones. Ayant affaire à des étudiants de première année d'université, donc frais émoulus du secondaire, j'ai d'abord voulu savoir quel était le degré d'homogénéité de cette population, et si les générations successives d'étudiants de première année avaient en anglais des connaissances - ou des lacunes - identiques. Pour parler comme à l'époque, les étudiants successifs « faisaient-ils les mêmes erreurs » et dans les mêmes proportions ? La préparation du cours supposait une réponse à ces ques- tions. Je me suis alors mis en quête de données textuelles. Au début de trois années univer- sitaires successives (1970 : groupe A ; 1973 : groupe B ; 1974 : groupe C), j'a demandé aux nouveaux étudiants de faire une petite rédaction en anglais sur divers sujets à caractère général, sans contrainte de temps excessive. Ils devaient rédiger d'abord un brouillon, puis une version définitive, ceci me permettant, lorsque ces consignes avaient été suivies, de comparer les deux états de leur rédaction pour y repérer des traces manifestes d'autocorrection. J'ai alors suivi l'algorithme de COR- DER 1971 (p. 25 dans ce numéro), de façon à établir une typologie d'erreurs syntaxi- ques pour chaque groupe, c'est-à-dire pour chacune des trois années. Il est apparu une forte corrélation, pour chaque catégorie d'erreurs, entre leurs fréquences respecti- ves dans les trois groupes A, B et C (la fréquence étant estimée selon le pourcentage de sujets faisant le type d'erreur considéré). On connaît les limites de ce type de cor- rélation, qui ne tient pas compte des stratégies d'éludage des apprenants, de la déter- mination des données par le type d'exercice proposé, etc. Pour y remédier, j'ai eu recours à un test de reconnaissance et correction d'erreurs 2 (que j'appellerai « test * Cet article est la traduction d'une communication présentée au Congrès TESOL (Boston, Mass., mars 1979) sous le titre : « Error analysis : a practical evaluation », et légèrement remaniée ici. 1. Pour les procédures de sollicitation de données, cf. dans ce numéro CORDER 1973 et Frauenfelder et Porquier. 2. Pour une présentation détaillée des résultats et une discussion sur les deux types de tests utilisés, voir Perdue 1977. 87 This content downloaded from 193.194.76.5 on Wed, 10 Jul 2019 20:31:09 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Holland », l'idée de ce test provenant de HOLLAND 1970) : les sujets devaient, en temps non limité, lire un texte parsemé de formes erronées, elles-mêmes extraites des données textuelles préalables ; puis réécrire le texte, en y corrigeant les formes qu'ils jugeaient erronées. Les résultats ont montré une forte corrélation entre les trois grou- pes : (a) quant aux erreurs identifiées et « bien » corrigées ; (b) quant aux erreurs identifiées et « mal » corrigées ; (c) quant aux erreurs non identifiées. De plus, les corrections proposées, aussi bien pour des formes erronées que pour des formes cor- rectes du texte initial, correspondaient dans l'ensemble aux formes recueillies anté- rieurement dans les données textuelles initiales. D'un point de vue quantitatif au moins, l'ensemble constitué par les trois groupes paraissait homogène. Disposant de ces résultats, il m'est apparu difficile de passer* de cette typologie d'erreurs - c'est-à-dire des listes d'erreurs dressées « mécaniquement » en référence à des règles (ou à des ensembles de règles) de la théorie « standard » (CHOMSKY 1965) - à une description plus adéquate, exploitable 3 pour un cours de grammaire. Dans une perspective d'explication des erreurs, il s'avérait très difficile de dépasser le simple pointage de formes interférentielles (influencées par le français) ou analogi- ques (influencées par des régularités internes de l'anglais). Il semble en effet que les visées interdépendantes d'une description des erreurs et d'une explication psychologi- que des erreurs - ce qui constituait l'objectif de l'AE « classique » - ne puissent être atteintes dans le cadre méthodologique de cette AE « classique ». 1. Première étape : trouver l'erreur Il s'agissait de dégager des erreurs systématiques. Dans la méthodologie proposée par CORDER, la dichotomie erreur /faute renvoie à la dichotomie chomskyenne compétence/performance (les locuteurs de L2, comme ceux de Ll, font des fautes). L'étude quantitative évoquée précédemment laissait de côté certains phénomènes qui n'étaient identifiés ni comme des erreurs ni comme des fautes (je les appellerai, selon JAIN 1974, « erreurs asystématiques »). Ainsi, certaines erreurs, systématiques dans les données textuelles, étaient corrigées par le même apprenant dans le test Holland. Un exemple : alors que dans les rédactions les apprenants omettaient souvent de faire l'accord après there, les trois-quarts d'entre eux, dans la phrase agrammaticale There was several minutes to wait du test Holland, corrigeaient there was en there were 4. Comment expliquer cette contradiction entre des formes systématiquement erronées dans les données textuelles et des intuitions correctes ultérieures ? H. G. WlDDOWSON (1975) en a proposé une explication : la compétence (compétence linguistique et compétence de communication) des locuteurs de LI et de L2 serait de même nature, l'asystématicité en L2 étant à relier à la variation stylistique (telle que la définit Labov 1972) en Ll. Si l'attention du locuteur, de Ll ou de L2, est centrée sur la forme - la « correction », au sens normatif du terme - il se référera aux règles qu'on lui a enseignées, c'est-à-dire au « bon usage » (angl. usage , selon 3. En admettant qu'une liste de formes, regroupées selon un critère externe, puisse être considérée comme une description. 4. Ce genre de phénomène (ainsi que les structures éludées par une forte proportion de la population dans la rédaction) explique la corrélation relativement faible (en moyenne : + 0,3) entre la rédaction et le test pour chacune des trois années. Si, comme Ta suggéré Anna KRUSE (communication personnelle), les deux tests administrés chaque année sont de nature très simi- laire - et je ne suis pas d'accord avec elle - on pourrait s'attendre à trouver une corrélation plus forte. 88 This content downloaded from 193.194.76.5 on Wed, 10 Jul 2019 20:31:09 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms WiddowsON). Si au contraire son attention est centrée sur le contenu de son activité langagière, il s'attachera essentiellement à l'efficacité de la communication (angl. use , selon WIDDOWSON). Pour expliquer ce phénomène, WIDDOWSON postule deux ensembles de règles chez l'apprenant : - des « règles de référence », qui renvoient à la norme enseignée, et font partie de la connaissance explicite de l'apprenant. Les formes engendrées par ces règles sont grammaticales si l'on se réfère au modèle de L2 ; - des « règles d'expression », « élaborées par l'apprenant », qui font partie de sa connaissance implicite de la langue. Les formes engendrées par ces règles ne sont pas forcément grammaticales si l'on se réfère au modèle de L2. Une stratégie globale de « simplification », selon WIDDOWSON, combinerait les facteurs psycholinguistiques qui déterminent, dans une situation donnée, le passage d'un ensemble de règles à l'autre. De ce point de vue, « les erreurs résultent des ten- tatives faites par l'apprenant pour adapter le « bon usage » linguistique aux exigen- ces de la communication » (WIDDOWSON 1975 : 9). Cette dichotomie référence/expression, qui prétend rendre compte de l'asystéma- ticité uploads/s3/ analyse-contrastive.pdf
Documents similaires
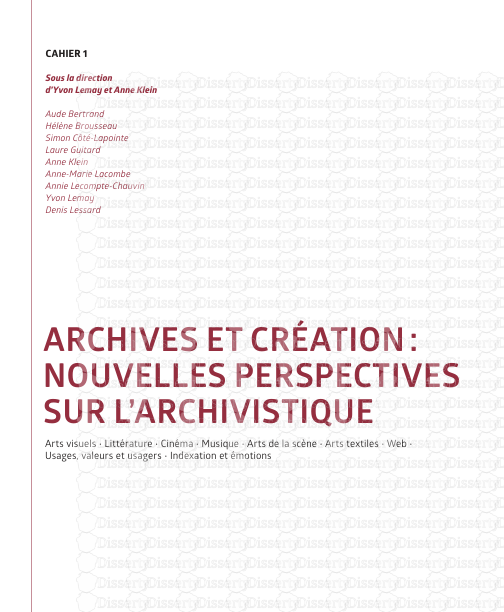









-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 10, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7595MB


